Article précédent
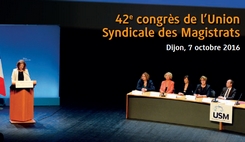

En juin 2016, un rapport sur la protection des magistrats dénonçait notamment « la montée en puissance de tentatives de déstabilisation émanant de la défense ». Le texte avait soulevé l’indignation des avocats et interrogé le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel sur l’existence d’une « guerre civile larvée » entre les deux professions. Le 4 octobre, Olivier Cousi et Nathalie Roret ont organisé un débat sur le sujet avec de prestigieux invités.
La bibliothèque trois fois centenaire de l’ordre des avocats de Paris, avec ses milliers d’ouvrages anciens et son atmosphère feutrée, est un lieu de réflexion idéal. C’est là que s’est tenu, le mardi 4?octobre au soir, le débat « Avocats et magistrats : guerre ou paix ? ». Les deux organisateurs, Olivier Cousi et Nathalie Roret, candidat au bâtonnat et vice-bâtonnat, y ont convié quatre éminents orateurs : la magistrate Colette Perrin, l’avocat Daniel Soulez Larivière, Philippe Bilger, ancien avocat général à la Cour d’assises de Paris et l’avocat pénaliste François Saint-Pierre.
Dans son introduction au débat, Nathalie Roret a posé une question symptomatique de la relation entre les deux professions aujourd’hui : « Pourquoi l’avocat n’a plus le libre accès au juge ? ». La candidate a en effet regretté qu’il ne puisse plus passer à l’improviste dans les cabinets d’instruction comme autrefois. Une tendance, qui, d’après elle, se confirmerait dans l’architecture du bâtiment du nouveau Tribunal de Paris « fait pour que les avocats et les magistrats ne se croisent plus ». Pour Nathalie Roret, qui tente un début d’explication, « la numérisation, le besoin de sécurité et notre société qui devient de plus en plus intolérante ne facilitent pas les échanges ». Et de conclure l’introduction au débat, parce qu’elle est en campagne avec Olivier Cousi : « le rôle du bâtonnier et du vice-bâtonnier est de recréer du lien. Passer d’une culture de la confrontation à une culture du contradictoire. Dans ce domaine, beaucoup d’amélioration seront mises en œuvre si on est élu : développer des relations plus étroites avec l’ENM [école Nationale de la Magistrature], organiser des cessions thématiques, inventer des lieux d’échanges dans les instances représentatives de la profession ».
« Le magistrat se sent agressé, déstabilisé »
Le premier intervenant n’a pas été le plus optimiste. Collette Perrin, magistrate « particulièrement inquiète pour l’avenir », a poussé « un cri d’alarme » et « craint pour les jeunes des deux professions ». Celle qui a eu notamment des fonctions commerciales dans sa carrière, précise, en faisant part de sa propre expérience, que ce n’est pas « propre aux affaires pénales ». « J’ai eu à connaître des tensions exacerbées, le magistrat se sent agressé, déstabilisé », a-t-elle indiqué.
Daniel Soulez-Larivière, lui, est moins catastrophiste. L’avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1965, défenseur de l’État français et de deux de ces agents dans l’affaire du Rainbow Warrior en 1985, considère qu’« il y a un antagonisme fonctionnel entre les deux professions ». Il poursuit en précisant que cet antagonisme est logique dans le cas des magistrats du parquet puisque c’est une partie au procès, en revanche, concernant ceux du siège « l’antagonisme ne devrait pas exister ». Daniel Soulez-Larivière a également largement cité le rapport sur la protection des magistrats à l’origine du débat. Le document explique « l’augmentation des menaces et des attaques à l’encontre des magistrats et de l’institution judiciaire » par « le renforcement de l’action judiciaire intervenu ces dernières années ». Mais, il évoque une autre raison, plus surprenante : « Ce phénomène [l’augmentation des menaces NDLR] est en outre renforcé par la montée en puissance de tentatives de déstabilisation émanant de la défense et prenant la forme de dépôts de plainte à l’encontre des magistrats instructeurs ou de campagnes médiatiques particulièrement violentes ». L’efficacité croissante de l’autorité judiciaire « pour perturber gravement l’activité de certains groupes criminels » a « incité les avocats à se spécialiser et à adopter une défense beaucoup plus agressive », ajoutent les auteurs.
Pour Philippe Bilger, qui a exercé pendant plus de 20?ans la fonction d’avocat général à la Cour d’assises de Paris, « le procédé du rapport est honteux, car il ne concerne qu’une minorité d’avocats ». Cependant, le célèbre tribun reconnaît que « la formation fondamentale au barreau pêche. Il faudrait des formations de politesse judiciaire, de gestion du pouvoir. À l’école du barreau et dans la magistrature il y a une faillite dans le domaine de la culture générale, or il en faut pour créer de l’humanité ». Et d’ajouter : « L’esprit de contradiction disparaît, car il y a un appauvrissement du langage. Il n’y a plus le goût de la contradiction ».
« Le système judiciaire est un mur »
François Saint-Pierre explique le glissement de l’esprit de contradiction vers un « esprit de confrontation » par des perquisitions et des écoutes téléphoniques de plus en plus nombreuses à l’encontre des cabinets d’avocat, autorisées par la jurisprudence de la Cour de cassation. « Cela a modifié notre façon de communiquer avec les gens », précise-t-il. L’avocat lyonnais prend ensuite l’exemple très précis des demandes de renvoi, « exaspérant » selon lui. Il s’explique : « On ne sait jamais jusqu’à l’audience si c’est accepté ou non » et conclut : « Le système judiciaire est un mur ».
(…)
Victor Bretonnier
Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n° 82 du 29 octobre 2016
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *