Article précédent
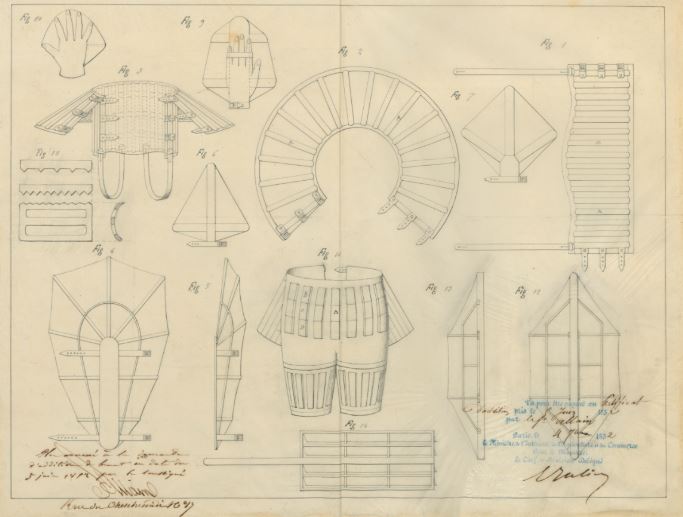

D’après un webinaire organisé par l’INHESJ
Fermeture des frontières, attestations de sorties, multiplication des contrôles, baisse de la demande et de l'offre... La crise sanitaire et le confinement ont bouleversé les pratiques des trafiquants et des consommateurs de stupéfiants. Mais malgré une chute estimée à plus de 30 %, le marché s’est immédiatement restructuré. De quoi pousser à s’adapter, à leur tour, les services qui luttent contre ce trafic de plus en plus organisé, polymorphe et évolutif, soulignent les deux spécialistes invités par l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ).
« Durant le confinement, les trafiquants eux aussi se sont confinés. Du moins, dans un premier temps, sous l’effet de la sidération provoqué par les annonces du gouvernement » observe Stéphanie Cherbonnier.
Invitée à intervenir lors d’un webinaire organisé par l’INHESJ, la contrôleuse générale de la police nationale et cheffe de l'office anti-stupéfiants dresse un bilan de l’évolution du trafic de stupéfiants durant les deux mois de quarantaine, et elle observe quatre phases.
Une première phase qui commence le 16 mars, caractérisée par la désorganisation des trafics, avec une rupture quasi-immédiate des approvisionnements, notamment les trafics de cannabis, dont le vecteur routier est le vecteur principal d’approvisionnement, depuis le Maroc et par l’Espagne. Les stocks sont alors estimés à 10 jours : « on est presque en flux tendu », commente Stéphanie Cherbonnier. C’est aussi l’arrêt de l’aérien pour le transport de cocaïne via le système des mules, notamment depuis la Guyane. Le territoire est donc, dans un premier temps, privé d’arrivée de produits, souligne la contrôleuse générale de la police nationale.
Deuxième phase : les trafiquants, revendeurs et consommateurs mettent en place une stratégie de contournement. « Nous avons constaté un recours important aux réseaux sociaux, en particulier Snapchat et WhatsApp, pour des commandes et des livraisons à domicile ou par un système de “drive” », développe la contrôleuse générale de la police générale, qui fait également état de l’accroissement de la culture « indoor ». Des phénomènes qui préexistaient à la crise, amplifiés par le confinement.
La troisième phase identifiée par les services de police est celle de la pénurie, qui s’accompagne d’une augmentation de la violence d’environ 20 % en France. « C’est une violence avec une logique de conquête de territoire, de prise de pouvoir sur certains points de vente », explique Stéphanie Cherbonnier, qui rapporte une explosion des tentatives d’homicides volontaires dans plusieurs grandes villes de province – Rennes, Strasbourg, Perpignan, Bordeaux. Autre conséquence de la pénurie : l’augmentation du prix des produits, entre 40 et 60 %, tous types confondus. « On a pu constater sur des messages envoyés aux consommateurs que la résine de cannabis était montée à des prix très très élevés », témoigne-t-elle. Hausse toutefois de moindre importance dans les zones frontières à l’instar de Perpignan ou de Lille, du fait de la possibilité d’aller s’approvisionner facilement en Espagne ou aux Pays-Bas, où les produits continuent à arriver, via des routes moins empruntées et moins contrôlées.
Enfin, la quatrième phase débute quelques semaines avant la fin du confinement : c’est la reprise. En témoignent des « saisies majeures réalisées sur des quantités importantes d’herbe de cannabis, transportées dans des ensembles routiers en provenance d’Espagne », et notamment le transport frigorifique, alimentaire, qui profite de la consigne permettant de laisser les frontières ouvertes pour approvisionner les supermarchés.
Au total, pendant cette période de confinement, le trafic de stups connaît un mouvement global de ralentissement important, évalué à 30 % en France. Traduction concrète : une baisse importante des saisies de produits, du nombre de mis en cause, et du nombre d’affaires élucidées. Mais tout cela est de l’histoire ancienne, de l’avis de Stéphanie Cherbonnier : aujourd’hui, les trafics ont bien repris leurs droits.
Plus d’un tour dans leur sac
« Je trouve qu’on ne prend pas suffisamment la mesure des stratégies de ces filières. » Économiste et spécialiste du crime organisé, Thierry Colombié estime que cette période a été « particulièrement intéressante » depuis son poste d’observateur, puisqu’elle a montré à quel point les réseaux pouvaient s’adapter à une situation inédite. « C’était la première fois qu’on se retrouvait avec des contraintes très fortes par rapport à la structure du marché. D’autant plus avec l’incertitude liée à la fin du confinement. Tout cela pose des problèmes logistiques face auxquels il faut ajuster ses stratégies. » « Ils ont fait preuve d’ingéniosité, c’est très clair, et d’une vraie capacité d’adaptation des modes d'approvisionnement et de distribution », ajoute Stéphanie Cherbonnier.
Thierry Colombié souligne qu’en janvier, alors que la pandémie commençait à faire parler d’elle mondialement, les trafiquants ont fait ce que font tous les commerçants qui anticipent une situation problématique : ils ont constitué du stock.
Stéphanie Cherbonnier acquiesce. Avant le confinement, illustre-t-elle, « des services territoriaux ont signalé des files d’attente » sur des points de deal. Or, tout rassemblement sur la voie publique ou à proximité attirait nécessairement les forces de l’ordre, il a donc fallu pour ces personnes « jouer de davantage de discrétion ».
« Nous aussi, nous avons dû nous adapter », avance la cheffe de l’office anti-stupéfiants. Car, certes, police et gendarmerie ont poursuivi leurs missions, mais leur présence dans la rue, notamment dans le cadre de la surveillance, apparaissait rapidement suspecte. « Il était compliqué d’avoir plusieurs véhicules dans un périmètre restreint, d’entrer dans les quartiers pour conduire des investigations. » Se posait aussi la question de la sécurité des agents eu égard au coronavirus : plusieurs d’entre eux ont été testés positifs, pointe Stéphanie Cherbonnier.
Difficile de savoir quel a été le niveau de stock des trafiquants entre le commerce de gros, le demi-gros, le détail, les filières par produits, les multiproduits, les filières et trafics annexes et connexes… Pour autant, selon Thierry Colombié, « tout cela révèle un ensemble très organisé », pour qui la crise serait presque bénéfique, puisqu’elle permet de tirer des leçons pour plus tard.
Des leçons à tirer
Des leçons, les services de police et de gendarmerie aussi en ont tiré, avoue Stéphanie Cherbonnier : « Cela nous a contraints à envisager de travailler différemment. Nous avons énormément développé l’activité de renseignement : le confinement nous a fait prendre conscience que cette activité n’était pas suffisamment développée, alors qu’il s’agit d’un vecteur essentiel pour capter de l’information, et, au-delà de sa collecte, ce qu’on en fait : avec qui on la partage, où doit-elle nous conduire. » Autre aspect développé pendant le confinement : le recours à la technique. « On nous a fortement incités à avoir recours à tous les outils qui nous sont offerts pour effectuer de la surveillance », rapporte la cheffe de l'office anti-stupéfiants. La coopération internationale, elle aussi, a été renforcée : la France a davantage dialogué avec l’Amérique du Sud (Colombie, Brésil), où l’on identifie beaucoup de départs de cocaïne, mais aussi avec la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne.
« Nous avons également constaté que la crise a bénéficié aux organisations les plus structurées », affirme Stéphanie Cherbonnier. Les filières qui disposaient d’une logistique plus importante ont ainsi pu mettre en œuvre des importations malgré le ralentissement des différents vecteurs : en conséquence, elles ont pris davantage de parts de marché que les petits réseaux. Toutefois, « les logiques de conquête de territoire évoluent, il est donc difficile de dire si cela va perdurer ou non. Rien n’est jamais pérenne en la matière, mais la crise a redessiné le paysage criminel. »
Thierry Colombié, pour sa part, souligne que la crise a révélé plusieurs phénomènes.
Déjà, celui de l’ubérisation. Selon l’économiste, si on parle d’« uberweed » et d’« ubercoke » depuis quelques années seulement, il s’agit en fait de l’héritage des réseaux de la French Connection, l’organisation criminelle de trafic de drogues la plus connue dans les années 70. « Rien n’est neuf dans le business ! assure le spécialiste du crime organisé. En France, c’est à cette époque que tout ou presque a été inventé. » L’ubérisation, à l’ère numérique, change les modalités « pratiques » : avec un téléphone portable, on peut choisir, commander, être livré à domicile… Ce qui favorise, indique-t-il, l’explosion des circuits courts.
Thierry Colombié rapporte par ailleurs le trafic de produits « dont on parle rarement » : la kétamine. Pour l’économiste, cela n’est pas anodin sur le plan géopolitique. Il précise que ce psychotrope est principalement produit depuis 15 ans par l’Asie, et arrive par la nouvelle route de la soie, cet ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine et l'Europe. Or, aujourd’hui, il existe une grosse production de kétamine aux Pays-Bas : il est ainsi possible de s’approvisionner dans l’espace Schengen. « En période de confinement, ceux qui recherchent des effets planants vont facilement vers les drogues récréatives, et donc la kétamine », constate Thierry Colombié.
Plus médiatisé, le cannabis a également été un révélateur de pratiques moins scrutées par les forces de l’ordre. « Au-delà des cités, dans les zones périurbaines et rurales, des réseaux qui existent depuis longtemps – d’habitude peu visibles et moins dans le viseur des services de police, car ils ne croisent pas d’autres objectifs comme ceux liés au financement du terrorisme –, apparaissent cette fois comme des acteurs majeurs : je parle des cannabiculteurs », évoque le spécialiste du crime organisé.
La cannabiculture dans le viseur
Thierry Colombié s’est intéressé depuis 25 ans au phénomène, qu’il juge « totalement sous-estimé » ; un des facteurs de son développement. Ainsi, une multitude de personnes s’adonnent à cette « culture de subsistance », qui permet de consommer gratuitement et constitue en même temps une activité de revente pour réaliser un petit profit. « Pour ceux qui s’adonnent au trafic, cela donne autant de points de bascule qui permettent à ces réseaux d’intégrer d’autres produits, et de court-circuiter les circuits urbains », considère l’économiste.
Selon plusieurs rapports, la cannabiculture représenterait entre 80 000 et 200 000 cultivateurs, un chiffre difficile à établir. « Si on considère que chacun produit un kilo de cannabis en moyenne, cela en fait 200 tonnes au total », raisonne Thierry Colombié. « Est-ce que ces réseaux approvisionnent les cités ? Ce sera, à mon avis, une tendance d’ici quelques années », augure le spécialiste, lequel présage que les cannabiculteurs prendront certainement davantage de parts de marché, peut-être même en surfant sur une tendance « bio », imagine-t-il. « Aujourd’hui, on a découvert avec l’alimentation qu’on pouvait s’approvisionner près de chez soi… Demain ce sera aussi probalement le cas avec des produits stupéfiants ! »
Stéphanie Cherbonnier s’inquiète quant à elle d’un accroissement de la cannabiculture intensive. Elle rapporte, depuis deux ans, l’explosion de « cultures indoor massives » ; une véritable « industrialisation de la production », dit-elle. « Je ne parle pas de quatre pieds de cannabis sur un balcon, mais de saisies majeures de plants de cannabis réalisées dans des maisons, des granges, avec 500 à 1 500 pieds de saisis », martèle-t-elle. Problème : de nombreux outils sont mis à disposition via le darknet et utilisés par des acteurs qui, de plus en plus, se « professionnalisent ». Résultat des courses, « Police et gendarmerie confondues, nous avons saisi en 2019 plus de 180 000 pieds, contre 138 000 l’année précédente », s’alarme la contrôleuse générale de la police nationale. Les zones rurales et périurbaines, notamment dans le nord de la France et à proximité des métropoles, sont principalement concernées. Si traditionnellement, l’importation de l’herbe de cannabis se fait depuis l’Andalousie, progressivement, Stéphanie Cherbonnier note une « internationalisation de la production sur le territoire français ».
La cheffe de l'office anti-stupéfiants alerte sur le risque de percevoir trop souvent le cannabiculteur comme un simple producteur local, un agriculteur un peu différent : « On se dit qu’ils sont moins structurés, moins liés aux organisations criminelles de haut niveau, puisqu’ils ne réalisent pas d’importation. Mais pour ce qui est des cultures importantes, il ne s’agit pas d’amateurs mais de structures criminelles organisées, qui produisent parfois en grandes quantités et génèrent d’importants profits. »
Pénurie, paix sociale
Ce n’est pas une surprise, l’état du trafic a un impact sur la paix dans les quartiers. Alors, pendant le confinement, comment se sont articulées pénurie et paix sociale ? Les services de police ont-ils dû laisser passer des marchandises pour « calmer » certains quartiers ?
Stéphanie Cherbonnier refuse de considérer qu’il y a eu un quelconque laxisme en la matière. « Au quotidien, nous avons continué à traiter un grand nombre d’affaires de ce type, d’autant que tout mouvement sur la voie publique était suspect. » La contrôleuse générale de la police nationale l’assure : il n’y a pas eu de baisse d’activité sur ce terrain-là. Seule a été recensée, rapporte-t-elle, une baisse des contrôles liés exclusivement aux stupéfiants, en raison du faible nombre de déplacements. « Mais nous avons beaucoup été mobilisés autour des informations qui nous parvenaient, de sources et de services étrangers, ainsi que sur une stratégie d’entrave pour empêcher l’entrée des produits », raconte Stéphanie Cherbonnier.
Thierry Colombié rappelle pour sa part que l’on a assisté ces dernières années à deux grandes crises liées à la problématique de l’approvisionnement, sur l’exportation du cannabis depuis le Maroc – crises qui ont eu un fort impact social. « En 2005, les émeutes en France sont parties de la mort de deux jeunes à Clichy-sous-Bois » alors qu’ils cherchaient à échapper à un contrôle de police, retrace-t-il. « Mais selon les trafiquants, ce qui avait mis le feu aux poudres était le fait que des milliers de dealers s’étaient retrouvés au “chômage technique”, car deux gros exportateurs avaient été stoppés par les services marocains un an auparavant, ce qui avait provoqué un effondrement de l’importation du cannabis en France. »
Thierry Colombié explique : les cités, sous tension permanente, ont besoin d’un flux de marchandises et d’argent pour subsister. Si des centaines voire des milliers de personnes ne peuvent plus vivre du trafic, cela ouvre alors la porte à de nombreuses tensions : entre eux, mais aussi à l’égard des services de police et de gendarmerie, et cela peut dégénérer en troubles à l’ordre public : « Il faut toujours considérer avec à-propos le fait que si des personnes ne peuvent plus vivre de leur business, c’est alors un problème d’ordre social », résume l’économiste.
Autre difficulté : les efforts pour restreindre l’importation de cannabis et de cocaïne depuis le Maroc concernent 800 000 personnes dans ce pays. « Si demain on venait par magie à faire en sorte qu’il n’y ait plus de trafic de stupéfiants depuis le Maroc, cela voudrait dire que les stocks deviendraient de plus en plus importants, ce qui poserait là encore un problème de paix sociale », s’inquiète Thierry Colombié. Il revient sur un fait qui l’a marqué : lorsque le confinement a gagné peu à peu l’Europe, l’Espagne puis le Maroc ont décidé de restreindre drastiquement leurs échanges commerciaux. Or, en avril, le Maroc a autorisé les bateaux espagnols à venir sur les eaux territoriales. « On pourrait considérer que c’est anodin, mais pour avoir discuté avec des trafiquants, ça ne l’est pas. Pour eux, c’est un message envoyé aux opérateurs organisant le trafic, en relation directe avec des services de renseignement au Maroc et ailleurs, qui font état de la pression que subissent les dealers en France. Si on ne veut pas que cela dégénère, on va envoyer un signal fort auprès des autorités marocaines pour que le produit puisse circuler », rapporte le spécialiste du crime organisé.
Toujours sur le ton de la confidence, l’économiste indique qu’une autre information lui a été rapportée. « Notamment à la frontière espagnole, il a été dit à un certain corps de police qu’il ne fallait pas trop fouiller les voitures qui remontaient depuis l’Espagne, après début avril. Y a-t-il eu un arbitrage fait en haut lieu pour éviter les troubles à l’ordre public alors que cela commençait à dégénérer dans certaines villes ? Je ne sais pas, mais la question mériterait d’être posée. »
L’Ofast, nouveau look pour une nouvelle stratégie ?
Face à ce trafic de plus en plus structuré, polymorphe et évolutif, les services de police et de gendarmerie sont-ils suffisamment armés pour lutter contre les trafics de stupéfiants ? « On sait très bien que lorsqu’on démantèle les réseaux, les points de deal sont repris. Avez-vous les moyens d’avoir un impact à long terme ? » interroge Christophe Soullez, chef de l'ONDRP et animateur du débat, à l’intention de Stéphanie Cherbonnier.
Cette dernière porte un regard plein d’optimisme sur l’Ofast (office anti-stupéfiants), version actualisée de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), dont elle est à la tête.
Elle revient sur sa création, dans le cadre du plan national de lutte contre les stupéfiants annoncé au mois de septembre 2019, qui promet une rénovation de la gouvernance. L’objectif est de mieux articuler les acteurs entre eux, car en la matière, il existe, rappelle Stéphanie Cherbonnier, « une multitude d’acteurs », de la douane à la police dans toutes ses composantes : sécurité publique, police judiciaire, police aux frontières, gendarmerie… Des acteurs « qui ont pu connaître et connaissent encore des concurrences malsaines pour la lutte contre le trafic de stups », regrette la cheffe de l’office anti-stupéfiants. « Or, quand on passe son temps à lutter contre les uns et les autres, on ne passe pas de temps à démanteler des organisations. C’est pour cela qu’il vaut mieux coordonner nos forces, et c’est l’esprit de la création de l’Ofast », se réjouit-elle. Office qui, depuis le 1er janvier, et un service à compétence nationale (SCN). « L’idée était de créer une forme d’agence directement rattachée au directeur central de la police judiciaire, chef de file de la lutte contre les stupéfiants en France, qui coordonne, et n’est pas là pour préempter les affaires des autres. » Car voilà la critique qui était adressée à l’ancien OCRTIS, accusé d’apparaître non pas comme un animateur de réseaux mais comme un concurrent dans la conduite des affaires. « On sort de cette logique concurrentielle en apportant une expertise à tous les services territoriaux qui peuvent en avoir besoin », indique Stéphanie Cherbonnier.
L’Ofast a donc pour mission de fournir un travail d’analyse, d'élaboration de l’état de la menace, et se positionne dans la prospective, les nouvelles tendances identifiées. C’est tout l’enjeu du pôle stratégie, qui a vocation à produire cette analyse. « Il s’agit d’un pôle que l’on fait monter en puissance en recrutant des profils d’analystes qui connaissent cette thématique et ont cette capacité à avoir une approche géopolitique des phénomènes, qu’il faut mettre en perspective. Par ailleurs, on diversifie les profils : attachés d’administration, contractuels… Ils sont importants car ils travaillent de manière différente, nous devons nous nourrir de cette approche inédite », développe la cheffe de l’office anti-stupéfiants.
Une autre évolution majeure à l’Ofast concerne la partie renseignement. Auparavant, renseignement et opérationnel étaient imbriqués, ils sont désormais scindés en deux activités distinctes. Des cellules de renseignement opérationnel seront d’ailleurs mises en place d’ici la fin de l'année : il s’agit, détaille Stéphanie Cherbonnier, de « capteurs de renseignements ». « On va travailler avec les territoires, pour exploiter ce renseignement et le redistribuer », expose-t-elle.
D’ici fin 2020, l’Ofast devrait compter 170 enquêteurs, 210 en 2021, et 240 fin 2022. Pour sa cheffe, il s’agit impérativement de « bien absorber la RH avant de la structurer ». « Il faut que l’on ait des missions très précises, que l’on sache quelle est notre cible opérationnelle, au plan stratégique, et cela demande beaucoup de travail », résume Stéphanie Cherbonnier, qui évoque un « gros projet ».
Saisir, c’est bien, identifier, c’est mieux
Si le nouvel Ofast semble plus armé que son prédécesseur, de nombreux points restent à améliorer en matière de lutte contre les stupéfiants.
Thierry Colombié déplore que trop peu de chercheurs travaillent sur le sujet. « Comment faire pour travailler de façon confortable, c’est-à-dire avoir accès à des méthodes indirectes (rapports) et directes (aller voir les usagers et les trafiquants) ? » interroge-t-il.
Ainsi, la France, contrairement à d’autres pays européens, « présente le handicap de ne pas produire de connaissance scientifique », réalisée par des personnes habilitées formées par l’université, « ni juges ni parties ». Pourtant, si tel était le cas, comme le font les Anglo-Saxons, nous y verrions « peut-être un peu plus clair sur le paysage actuel du trafic », assure Thierry Colombié, pour qui il est essentiel de « savoir comment lutter de façon efficace ». « Tant que la police aura le monopole, c’est un biais qui ne permettra pas de faire une photographie exacte de ce qui se passe », assure l’économiste.
Jusqu’à présent, dénonce-t-il, hormis quelques exceptions, il n’y a pas eu de débat autour de la question de savoir si la guerre menée contre la drogue depuis 50 ans était véritablement un succès ou pas. « Il faudrait au moins avoir cette pertinence de comprendre à quoi sert la lutte contre la drogue. Je ne dis pas qu’il ne faut pas que cette lutte existe, mais qu’il faut savoir en quoi toutes les mesures qui sont mises en œuvre peuvent un jour arriver à défaire les trafics de stupéfiants. »
Stéphanie Cherbonnier reconnaît l’absence d’étude formelle en France et le manque d’éléments chiffrés. « Les services de police et de gendarmerie n’ont pas une vision exhaustive de ce qu’est le marché. Certes, c’est notre objectif, avec le risque que cela relève d’un vœu pieu. Plus on connaîtra le marché, mieux on travaillera au démantèlement des structures. »
Un autre problème important, identifie Thierry Colombié, est que l’on parle surtout de trafic de stupéfiants en matière de géopolitique. Or, la cocaïne, pour être acheminée, passe nécessairement par la corruption : « un mot banni de notre vocabulaire, alors que c’est l’un des fers de lance du crime organisé », estime le spécialiste. Il précise qu’on ne sait toujours pas aujourd’hui ou très peu quels sont les gros circuits de blanchiment qui permettent d’envoyer l’argent au Maroc. « On a soulevé le tapis en 2012 avec l’opération Virus, grâce à trois policiers spécialisés dans la grande délinquance financière qui avaient à cœur de montrer comment le sujet pouvait être au moins évoqué et comprendre comment était blanchi cet argent. Cela a été quelque chose d’assez spectaculaire, on s’est aperçu que le trafic partait en Inde, qu’il y avait un trafic d’or associé, et que derrière, la délinquance financière servait à remplir les caisses d’entreprises au Maroc. Je veux bien qu’on lutte contre la drogue, mais pour le faire de façon efficace, il ne faut ne pas se cacher derrière le petit doigt à chaque fois pour expliquer telle affaire, etc. Sinon on ne va jamais y arriver », avance Thierry Colombié.
La cheffe de l’office anti-stupéfiants en est elle aussi consciente : il ne suffit pas « de faire des affaires judiciaires ». « On peut prendre des photos devant des tonnes de résines de cannabis, cela n’est pas suffisant. Saisir, c’est bien, mais il faut identifier les circuits de blanchiment et saisir les avoirs criminels », opine-t-elle.
Quant aux autres points à améliorer en matière de lutte contre les stupéfiants, Stéphanie Cherbonnier réclame une politique publique intensifiée. « On a une politique publique sur l’offre, soit la lutte contre les trafics, mais depuis combien d’années n’y a-t-il pas eu de campagne de prévention en France ? C’est un point sur lequel il faut travailler, afin d’agir dans les deux sens, et travailler aussi sur l'aspect consommation », appuie-t-elle.
Autre axe d’amélioration : le partage du renseignement. L’Ofast souhaite d’ailleurs intégrer au sein du pôle renseignement un personnel de l’administration pénitentiaire en lien avec le renseignement du bureau pénitentiaire, car, assure Stéphanie Cherbonnier, il s’agit d’une « mine d’informations ». « Les trafics ne s’arrêtent pas avec l’incarcération des trafiquants, il ne faut pas qu’il y ait de rupture dans le partage du renseignement », insiste-t-elle.
Par ailleurs, la cheffe de l’office anti-stupéfiants sait que le cyber doit être développé. En effet, jusqu’alors, le darknet, ou même les simples applications de type Snapchat, ont été insuffisamment pris en compte, déplore-t-elle. « Il faut recruter des personnels qui ont des compétences sur ce sujet pour conduire des investigations ».
Enfin, Stéphanie Cherbonnier regrette qu’en France, aucune loi ne prévoie le recours aux sources. Il existe bien, dit-elle, une Charte qui indique comment doivent être traités les informateurs, mais sur le sujet, le Code de procédure pénale est muet. « Or, on sait qu’il n’y a pas de lutte contre le trafic de stupéfiants sans informateurs. Certes la jurisprudence a posé certaines limites, mais il serait intéressant qu’on puisse les cranter dans un texte. »
Positive, Stéphanie Cherbonnier affirme qu’elle croit « au cercle vertueux ». À la communication entre les services, d’une part. « Il ne faut pas cacher ses enquêtes, jalouser celles de l’autre… Si on arrive à constituer une communauté des acteurs de la lutte contre les stupéfiants, on ne travaillera que mieux ». Quant aux outils, elle admet qu’il en manque. À l’Ofast, tous les dispositifs ne sont pas encore en place. Mais patience ! « Pour le moment, j’ai besoin de RH et de structuration. Pour le reste, j’ai besoin de recul », résume la cheffe de l’office anti-stups.
Bérengère Margaritelli
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *