Article précédent

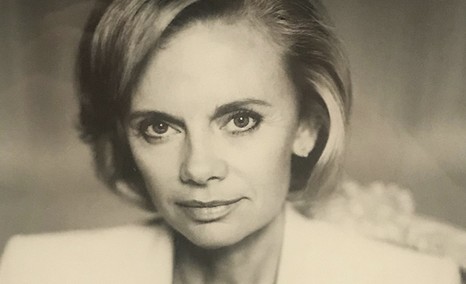
Une enfant des colonies
Élisabeth Vallier naît le 6 août 1946 à
Marrakech.
Sa grand-mère vient seule, à 18 ans, après la
Première Guerre mondiale, créer La Poste dans cette grande ville du Maroc.
Son père, Georges, s’engage à 22 ans dans l’armée
française en Italie et participe à la bataille de Monte Cassino en 1944. À son retour, il crée une
entreprise de conservation d’olives, d’huile d’olives, puis d’abricots. Il
épouse Jeannine Flecchia, d’origine piémontaise, mais née en Algérie.
Élisabeth témoigne du milieu où elle grandit :
« Très jeune, j’ai été révoltée par la bêtise épaisse des machos, assez
nombreux parmi les Européens du Maroc où je vivais. Je haïssais les
plaisanteries grasses et vulgaires, l’autoritarisme imbécile, l’obstination
bornée, la violence des propos, le mépris pour les plus faibles, les femmes,
bien sûr, mais aussi les Arabes et les Juifs. Le "macho-racisme" me
fit très tôt horreur ». (1)
La décolonisation va bouleverser la vie familiale.
Perturbée par des événements qui plongent ses parents dans la précarité, la
jeune fille constate que le monde est traversé d’oppositions. Elle ne comprend
pas que les communautés ne puissent vivre en bonne intelligence et en conçoit
un grand intérêt pour les relations internationales autour de la question à la
fois simple et fondamentale : pourquoi la guerre ?
Après l’indépendance du Maroc (1956), elle arrive en
France, où ses parents montent une nouvelle affaire agricole, des vergers, qui
subiront quelques années plus tard la concurrence des produits espagnols.
Forte d’une année d’avance, Élisabeth est douée à
l’école. Après son baccalauréat, elle aimerait aller à Paris pour embrasser une
carrière diplomatique. Elle garde en mémoire le modèle de cette femme
consul de France à Casablanca, élégante et impressionnante.
Mais ses parents la pensent trop jeune, et puisqu’elle
parle déjà bien anglais, pour avoir passé tous ses étés d’adolescente en
Angleterre, elle s’inscrit à la faculté des lettres de Montpellier en littérature
américaine. Elle rédige un mémoire sur Jack Kerouac et la Beat
Generation. Elle lit Faulkner, Salinger, Dos Passos, Henry James et Alan
Ginsberg.
En 1966, à l’âge de 20 ans, elle épouse
Jean-Louis Guigou avec qui elle aura un fils.
Elle dépose un dossier à Sciences-Po Paris et le refus
de son profil la révolte. Opiniâtre, elle passe à trois reprises le concours de
l’ENA et l’obtient, à 26 ans, au 10e rang, avec le sentiment
d’avoir accompli un parcours difficile mais aussi triomphé des préjugés. Elle
milite avec les 20 femmes admises (sur 150 élèves) pour que leur
promotion 1972 soit
baptisée d’un nom de femme : ce sera celui de la philosophe Simone Weil.
Élisabeth Guigou mène ensuite une carrière autour des
questions internationales, et plus précisément européennes, qui la passionnent.
Elle est aussi une femme engagée, qui milite depuis 1973 au Parti
socialiste où toute une génération aspire au changement. Douée, intelligente et
vive, elle travaille huit années, à partir de 1982, au cabinet de François
Mitterrand qui repère celles qui feront l’avenir (2).
« Il faut dire qu’avant d’entrer en politique,
je ne me suis jamais sentie brimée en tant que femme. » « Ma
fibre féministe, endormie dans le confort de la réussite professionnelle et du
bonheur personnel, se trouva aiguisée » par « le machisme
politique qui se déploie avec impunité et efficacité » en France plus
qu’ailleurs, témoigne-t-elle.
Garde des sceaux : la première femme place Vendôme 1997
Son parcours prend un nouveau tournant alors que
Jacques Chirac, président de la République, perd les élections législatives
après avoir dissout l’Assemblée nationale. Lionel Jospin devient le Premier
ministre d’une nouvelle cohabitation en 1997.
Ayant conquis une circonscription difficile dans le
Vaucluse, elle sait qu’elle sera ministre, mais ne s’attend pas à ce qu’on lui
propose la chancellerie. Elle n’est pas juriste, n’a pas participé au groupe
« justice » du Parti socialiste bien qu’elle en connaisse les
engagements pour l’indépendance.
Elle réfléchit à cette proposition : « Je
savais que c’était un poste difficile où tous, hormis Robert Badinter, avaient
été broyés » (3).
Elle accepte car le Premier ministre la veut auprès de
lui, en figure forte du gouvernement.
Pour prix de son engagement, elle exige un budget à la
hauteur des ambitions et le courage politique de concrétiser les changements
promis. Elle précise : « J’y vais parce que je préfère mener des
réformes que seulement gérer un grand ministère ».
Le secrétaire général de l’Élysée annonce un gouvernement composé d'un
tiers de femmes, 6 sur 18 (4), Élisabeth Guigou est la numéro 3 du
gouvernement.
Elle rejoint la place Vendôme à l’âge de 50 ans. Elle est consciente
de la rupture historique : elle est la première femme garde des Sceaux en
France.
Les photographies officielles, gardant la trace de la succession des gardes
des Sceaux, illustrent parfaitement l'arrivée des femmes, sur la toute dernière
ligne.
Son portrait officiel apparaît en bas à gauche, comme pour inaugurer une
nouvelle période.
Elle constitue son cabinet, dont la direction est
mixte : un homme, Christian Vigouroux, mais aussi une femme, Mireille
Imbert-Quaretta. « Je voulais des collaborateurs qui aient de la
personnalité et qui viennent d’horizons différents, qu’il y ait des femmes (…).
Cette diversité est pour moi gage de liberté (5) ». Son directeur
de cabinet indique : « elle occupait toute sa place de garde des
Sceaux, quand elle entrait quelque part c’était "la
patronne" (6) ». Sa directrice adjointe ajoute : « c’est
une intellectuelle, mue par des convictions profondes » (7).
Exemplaire, elle cherche constamment à nommer des femmes, et demande qu’on
lui en propose. Elle désigne la première directrice des Affaires civiles et du
Sceau, Danièle Raingeart de la Bletière, une directrice de la protection
judiciaire de la jeunesse, Sylvie Perdriolle ; des procureures générales.
Elle a conscience d’être au cœur de l’État et
d’imposer, en tant que femme, une autre façon de gouverner, sans hyperbole mais
avec son style : « Il faut imprimer sa marque et poser les bonnes
questions. Les administrations ne demandent que ça : des instructions (8) ».
N’étant pas issue du milieu de la magistrature,
Élisabeth Guigou expose sa méthode : « Je ne suis pas une experte
et je n’entends pas le devenir. Nous allons engager des réformes avec l’œil du
citoyen. » En rupture avec la période précédente, elle déclare :
« ce ne sera plus le ministère des Affaires, mais le Ministère du droit ».
Son cabinet, avec quatre femmes : Mireille Imbert-Carreta, Claude Etévenon-Galabru, Marie-Laure Robineau
et Anne-Marie Héloir– été 1997 – jardins de l’Hôtel de la Bourvallais
Une femme qui cherche à le faire oublier
« Est-il impossible d’être complètement femme, de
s’assumer comme telle, dans ses goûts, ses choix de vie, son apparence et de
faire de la politique ? » Élisabeth
Guigou pose la question avant d’arriver place Vendôme (9).
Blonde aux yeux bleus, fine, altière, d’apparence
froide et distante, son physique de « Barbie » lui est renvoyé d’une
manière ou d’une autre : la flatterie, la séduction, la domination.
Jacques Toubon, lors de la passation de pouvoirs sur
le parvis de l’Hôtel de Bourvaillais, le 5 juin
1997, s’exprime avec une goujaterie à la hauteur de sa misogynie : « Madame,
en termes d’image, vous n’aurez aucun mal à me succéder et à me surpasser. Ce
sera moins facile quant à la réalité de l’action. » Claude Goasgen,
député UDF, n’est pas en reste lorsqu’il lance de son banc : « elle
est encore plus belle en colère ».
« J’étais choquée, mais je m’étais déjà
frottée à cela. J’avais 50 ans et je connaissais bien le sexisme du milieu
politique. J’avais compris que si j’étais toujours confrontée à ce physique,
j’allais perdre du temps (10) », raconte-t-elle.
C’est à cette époque, pour faire de son corps un non-sujet, qu’elle adopte
le tailleur-pantalon gris/bleu marine, non sans que ce ne soit encore une
question, car les femmes n’avaient que récemment obtenu la possibilité de
pénétrer dans l’hémicycle en pantalon. « C'est sûr que, pour ne pas
choquer, les femmes qui font de la politique sont encore tenues à une grande
sobriété de comportement. Voilà pourquoi on porte toujours le même type de
vêtements classiques et neutres, donnant à penser qu'on a renoncé à notre
féminité (11). »? Puis elle coupe ses cheveux :
« cela m’a couté, je l’ai fait à contrecœur, mais c’était nécessaire ».
Pour faire face au sexisme collectivement, les femmes du gouvernement
décident de se soutenir, de s’entraider. Elles se réunissent chaque mois pour
échanger sur ce qu’elles vivent et réagissent de manière solidaire à chaque
remarque machiste par une manifestation de leur réprobation aux assemblées ou
dans la presse.
Une femme qui veut pourtant être nommée
Si Élisabeth Guigou cherche à lisser son image de
femme, elle refuse d’être invisibilisée par un vocabulaire faussement neutre,
toujours masculin. Si elle abandonne les vêtements, elle tient aux mots.
Chacun est tellement habitué à ce que le régalien et
la souveraineté soient incarnés par un homme, qu’un certain désarroi s’empare
des entourages lors de sa nomination : comment la nommer ?
Élisabeth Guigou a déjà son opinion sur le sujet et
considère la féminisation des titres et fonctions comme un enjeu. Elle sait que
la féminisation des métiers modestes, de service ou d’aide à la personne est
aisée : femme de ménage, couturière, boulangère, aide- soignante,
infirmière. Tout se complique lorsqu’il s’agit de métiers de pouvoir, qui
brusquement s’avèrent rétifs au féminin, ridicules avec un « e ».
Forte de sa nouvelle place, elle indique d’emblée
qu’il faudra dire Madame la garde des Sceaux et Madame la ministre. Elle
l’explique à l’Assemblée nationale : « il faut, si l’on veut que
les fonctions politiques et de direction s’ouvrent aux femmes, accepter de
féminiser le langage. » (12)
La conquête se poursuit au cours du conseil des
ministres du 17 décembre
1997, lorsqu’est évoquée la nomination de femmes en qualité de directeurs
d’administration centrale. Ségolène Royal s’en étonne et Jacques Chirac lui
donne raison. Il demande au secrétaire général du gouvernement de préparer un
décret nommant « ces dames » directrices, qui paraît au JO du
19 décembre. « Le
bastion masculin de la haute fonction publique vient de perdre son
privilège lexical (13) ».
Dans la foulée, la circulaire du 6 mars 1998 relative à la féminisation des noms de métiers,
fonctions, grades et titres permet à Lionel Jospin d’écrire que la
circulaire de 1986 (14) « n’a guère été appliquée jusqu’à ce
que les femmes appartenant à l’actuel gouvernement décident de revendiquer pour
leur compte la féminisation du titre de ministre. Elles ont ainsi engagé un
mouvement qu’il faut poursuivre afin que la féminisation des appellations
professionnelles entre irrévocablement dans nos mœurs. »
Un groupe de travail se constitue, pour concevoir un
guide d’aide à la féminisation édité en 1999 « Femmes, j’écris ton
nom », qui selon le Premier ministre, « doit faciliter une
démarche dont la légitimité n’est plus à démontrer ».
La sémantique n’est pas un paravent pour la garde de
Sceaux, qui va aussi faire avancer des textes fondateurs de l’égalité.
La révision constitutionnelle égalité femmes/hommes – Juillet 1999
Élisabeth Guigou porte la question de l’égalité entre
les hommes et les femmes sur le terrain normatif. Elle s’adosse aux travaux
d’universitaires et de philosophes, telles Michèle Perrot et Sylviane
Agazinski, qui montrent que l’argument universaliste sert en réalité la domination
masculine. Rappelant que les femmes sont la moitié de l’humanité et non une
catégorie, elles demandent non des mesures particulières pour les aider, mais
une évidente et légitime égalité sur tout sujet. Elle évite dès lors le débat
des quotas, en même temps que celui de la progressivité (commencer par 30 ou 40 %) en se tenant à un
discours de stricte égalité 50/50.
Extrait – discours du 15 décembre 1998
« C’est avec une grande émotion que j’ouvre ce
débat car je vous parle d’abord comme femme, comme "femme en politique" qui a le grand
honneur d’être la première femme garde des Sceaux. Je ne puis m’empêcher de
penser à toutes celles qui se sont battues parfois en donnant leur vie, pour
que les femmes se voient reconnaître leurs droits. Je pense d’abord à Olympe de
Gouges qui rédigea en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne. Je suis fière d’avoir l’honneur de vous proposer de modifier le
titre le plus noble de notre Constitution, le titre 1…. ce faisant nous allons
prendre une décision d’une portée symbolique considérable : la nation
souveraine ne sera plus une entité abstraite, mais elle sera incarnée par des
hommes et des femmes vivant dans leur siècle. »
Elle obtient le vote de la loi constitutionnelle du
8 juillet 1999 qui
ajoute à l’article 3 de la constitution un cinquième
alinéa : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », et à
l'article 4 un deuxième alinéa : « les partis et
groupements politiques contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au
dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la
loi ».
Cette loi est adoptée un an plus tard, le 6 juin
2000. Elle impose aux partis, lors des scrutins de liste, de présenter un
nombre égal de femmes et d’hommes, et instaure un mécanisme de retenue
financière en cas de non-respect. Pour éviter que les femmes soient placées en
fin liste, un système d’alternance une femme/un homme est conçu, et popularisé
sous l'appellation « listes chabada » (15).
Ainsi Élisabeth Guigou met en place un dispositif
complet, toujours en vigueur, pour assurer la parité en politique.
Si elle mène tous les combats cités du côté des droits
des femmes, elle s'avère être une garde des Sceaux très active sur le fond du
droit. L’œuvre législative est considérable, à titre d’exemple : lutte
contre les violences sexuelles faites aux mineurs, loi du 16 mars 1998 sur la nationalité,
loi contre la corruption, première liste des paradis fiscaux, loi du
15 novembre 1999 instituant le PACS.
Elle a aussi modifié la justice des mineurs ou le
contrôle indépendant des prisons (mission Canivet 1999).
La réforme de la justice
Élisabeth Guigou conçoit une réforme d’ampleur de la justice en France, qui
repose sur un triptyque : liens Chancellerie/parquet, statut du
parquet/Conseil supérieur de la magistrature, et enfin, protection de la
présomption d’innocence/droits des victimes.
L’indépendance de la justice – l’intervention dans les dossiers individuels
Illustrée par la rocambolesque affaire de l’Himalaya (16),
la nature des relations entre la ministre de la Justice et les magistrats du
parquet est fortement critiquée. Jacques Chirac, président de la République,
confie à Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation, la
présidence d’une commission de réflexion. Le rapport déposé en juillet
1997 fait les propositions équilibrées qui vont être utiles à la garde des
Sceaux pour sa réflexion d’ensemble.
Concernant les instructions individuelles, elle affirme d’emblée son choix
de principe de s’en abstenir, alors que l'article 30 du Code de
procédure pénale prévoit encore que le garde des Sceaux peut « dénoncer
au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et
lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure,
d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge
opportunes ».
Elle s’adosse au rapport de Mireille Delmas Marty,
professeure de droit de Paris I, qui propose, dès juin 1990, l’interdiction des
instructions du pouvoir politique dans les affaires individuelles. Elle
respecte cet engagement pendant tout son mandat, faisant ainsi progresser de
facto l’indépendance de la justice. Cette pratique est remise en cause
par plusieurs de ses successeurs.
Ce n’est que 16 ans plus tard que la loi du 25 juillet 2013 (17) interdit
au ministre de la Justice d'adresser des instructions individuelles aux
magistrats du ministère public.
Le statut du parquet – projet de loi constitutionnelle
Les modalités de nomination des membres du parquet
mettent aussi en doute leur impartialité. Élisabeth Guigou propose d’exiger un
avis conforme du CSM pour toute nomination d’un membre du parquet proposé par
le garde des Sceaux.
Elle va amener jusqu’au vote le 18 novembre
1998 par les deux assemblées dans les mêmes termes la loi sur la refonte
du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans sa composition et ses pouvoirs.
La convocation finale du Congrès est fixée au 24 janvier 2000 par Jacques Chirac. Cependant, le président de la
République, considérant l’hostilité de l’opposition18, prend la responsabilité
politique de l’annuler quelques jours avant, le 19 janvier.
Actant que « le blocage est avéré »,
il cherche à éviter un rejet du texte, qui doit être voté à la majorité des
trois cinquièmes, qui serait une première historique sous la Ve République.
Avec Catherine Tasca, présidente de la commission des
lois de l’Assemblée nationale entre 1997?et 2000, Élisabeth Guigou redit son
regret de ne pas avoir vu aboutir cette réforme 26 ans plus tard (19).
La loi renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes : la loi Guigou 2000
Enfin, le texte de procédure pénale n’est pas moins emblématique. Élisabeth
Guigou souhaite ne pas s’enfermer dans le choix entre des systèmes dits
« accusatoire » ou « inquisitoire » et plutôt concevoir un
texte équilibré mettant en balance les deux personnages du procès :
l’innocent toujours présumé et la victime souvent délaissée. Même si elle n’est
pas favorable à ce que les lois portent le nom des ministres, c’est pourtant
bien ce texte, adopté le 15 juin 2000,
qui reste dans esprits la « loi Guigou ».
Elle crée le juge des libertés et de la détention (JLD), qui a pour rôle de
statuer sur les mises en détention provisoire et d'autoriser certains actes
d'enquête intrusifs. Ce nouveau magistrat du siège, distinct du juge
d'instruction, est un garant privilégié des libertés individuelles, appliquant
des règles de détention provisoire précisées.
Elle cherche à mieux garantir la présomption d'innocence. Elle interdit la
diffusion d’images du prévenu menotté. Elle crée la Commission nationale de
réparation de la détention provisoire pour indemniser les personnes finalement
innocentées.
Elle introduit l’appel des arrêts des Cours d’assises et confie à une
nouvelle chambre de l’instruction le soin d’examiner les décisions des juges
d’instruction.
En octobre 2000, Élisabeth Guigou quitte la place Vendôme pour devenir
ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Son mandat de garde des Sceaux,
pendant trois?ans et demi, s’avère historique à tous points de vue et incarne
le mouvement vers le XXIe siècle.
Depuis, cinq femmes ont été gardes des Sceaux en France : Marylise
Lebranchu (2000-2002), Rachida Dati (2007-2009), Michèle Alliot-Marie
(2009-2010), Christiane Taubira (2012-2014) et Nicole Belloubet (2017-2020).
1) Livre Être
femme en politique – Plon - 1997.
2) Trois de ses
conseillères deviendront ministres : Élisabeth Guigou, Ségolène Royal et
Frédérique Bredin.
3) Livre Une
femme au cœur de l’État –
entretiens avec Pierre Favier et Michel Martin-Roland, Fayard, 2000, page 183.
4) Martine Aubry,
Catherine Trautmann, Dominique Voynet, Marie-Georges Buffet et Ségolène Royal.
5) Ibid note
3.
6) Entretien avec
l’autrice 16 septembre 2020.
7) Entretien avec
l’autrice 8 septembre 2020.
8) Laure Adler, Les
femmes politiques, Paris, Seuil, 1993.
9) Ibid note
1.
10) Entretien avec
l’autrice 19 février 2021.
11) Journal l’Humanité,
juillet 2000.
12) Compte rendu de la
séance du 15 décembre 1998.
13) « LeLa
ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms »
Bernard Cerquiglini, Seuil janvier 2019.
14) Circulaire du 11
mars 1986 Laurent Fabius.
15) Référence au film
de Claude Lelouch « Un homme et une femme » (1956).
16) Recherche en
helicoptère du procureur d’Évry
par le ministre de la Justice Jacques Toubon pour intervenir dans l’affaire
Xaxière Tibéri (1996).
17) Votée
sous le mandat de Christian Taubira, garde des Sceaux.
18) Michèle
Alliot-Marie présidente du RPR et Patrick Devedjan soutiennent un vote négatif.
19) Le Monde –
tribune du 19 septembre 2020.
Gwenola Joly-Coz,
Première présidente de la cour d’appel de Poitiers,
Membre de l’association « Femmes de justice »
Retrouvez tous les portraits de femmes pionnières, réalisés par Gwenola Joly-Coz
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *