Article précédent
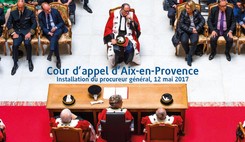

Gérard Sousi, président de l’Institut Art et Droit, qui propose régulièrement des débats intéressant les acteurs du monde de l’art, recevait ses membres. Ensemble, ils ont accueilli Bruno Dalles, directeur de Tracfin qui a exposé les missions de ses services. Ce dernier a appelé les professionnels du secteur à se tourner plus souvent vers l’administration du renseignement financier et à alimenter sa base de données.
Rappel
Tracfin a 27 ans, créé par un décret du 9 mai 1990 pour respecter les engagements internationaux de la France, nés au sommet de l’Arche de la Défense en 1989. En effet, le G7 dessinait un peu plus tôt une organisation antiblanchiment nommée groupe d’action financière (GAFI), fort de 40 recommandations, devenues depuis les standards internationaux de la lutte contre le blanchiment. L’un d’entre eux prévoit la création, dans chaque État, pour être conforme, d’une cellule de renseignement financier. La France a choisi de construire la sienne à Bercy, à l’origine au sein de la Direction générale des douanes et droits indirects, avec 10 agents. À l’époque, deux ministères se disputent le domaine : l’Intérieur et Bercy.
Le problème du blanchiment, c’est, à ce moment-là, l’intégration, dans l’économie légale, de fonds d’origine illicite concrétisés, pour la plupart, sous forme de flux d’argent liquide. Ensuite, le dispositif connaît de nombreuses étapes, jusqu’à 2017, autour de deux principes fondamentaux.
Premièrement : élargir le périmètre de la déclaration de soupçon. Au départ, la déclaration de soupçon concerne uniquement les opérations louches sur des fonds provenant de la criminalité organisée. À partir de 1993, on y inclut les fonds provenant de la corruption et la protection des intérêts de l’Union. Quand le dispositif antiblanchiment est créé, le délit pénal de blanchiment général, de tout crime ou délit, n’existe pas. Il faut attendre 1996 pour cela. À partir de 2010 seulement, suite à la transposition d’une directive européenne, le champ de la déclaration de soupçon prend la forme qu’on voit aujourd’hui. C’est-à-dire que toute activité illégale provenant d’une infraction est punie d’un an d’emprisonnement. Les délits génèrent des flux financiers. Donc tout délit est susceptible de justifier, en amont, une déclaration de soupçon si les fonds viennent de cette activité délictuelle. Auparavant, on considérait les fonds illicites issus de la criminalité organisée. En 2010, une nouvelle dimension de lutte contre le blanchiment apparaît : celle de la fraude fiscale grave. Bercy a défini 16 critères réglementaires alternatifs de gravité dans un décret du 16 juillet 2009. Depuis 2010, le périmètre de la déclaration de soupçon colle exactement avec celui de l’incrimination pénale du délit général de blanchiment. La quantité de déclarations a largement augmenté.
Deuxièmement : élargir le périmètre des professionnels assujettis aux obligations antiblanchiment. En 89-90, il se limite d’abord au secteur financier/bancaire suite à la crise, puis s’ouvre aux professionnels du droit et du chiffre. En 26 ans, l’analyse de risque a démontré que les fonds d’origine illicite cherchent des investissements, même s’ils ne rapportent pas, pourvu qu’ils échappent aux techniques de surveillance du système économique et financier. Le 2 juillet 1998, les professionnels de l’immobilier ont été ajoutés, puisque l’achat immobilier constitue un secteur à risque. En 2004, on complète par les avocats, les commissaires-priseurs, les antiquaires, les galeristes d’art. En décembre 2016, les activités de location ont été intégrées. Tous les nouveaux métiers du domaine financier font entrer autant d’acteurs dans le dispositif. Au 1er janvier 2017, on a adjoint les intermédiaires en financement participatif sur les plateformes de don. Les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs sont aussi concernés par le dispositif, de même que les agents de sportif, les casinos, le PMU, la Française des jeux...
Tracfin et le marché de l’art
Tracfin est alimenté par des déclarations de soupçon. Leur nombre est passé de 10 000 à 65 000 entre 2010 et 2016. 85 % d’entre elles arrivent des banques et des assurances. La proportion de celles émanant du secteur, pourtant à risque, de l’art est infime : commissaire-priseur (51), antiquaire (0), galeriste (0).
Pourquoi ? Le cadre juridique et réglementaire des obligations manque peut-être de clarté pour ces professions. Par ailleurs, la lutte contre le blanchiment, l’origine et la destination des fonds ne sont pas au cœur de ces métiers.
Or, relativement à la lutte contre le financement du terrorisme, la destination et l’utilisation des fonds sont fondamentales aujourd’hui. Le microfinancement du terrorisme est devenu le mode opératoire standard. (…)
C2M
Retrouvez la suite de et article dans le Journal Spécial des Sociétés n° 40 du 20 mai 2017
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *