Article précédent
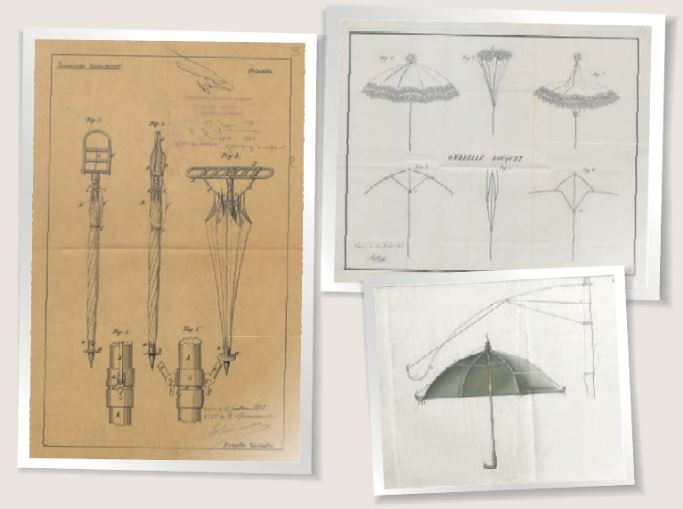

Un cycle de débats sur l’intelligence artificielle a été entamé à l’Hôtel de l’Industrie, souhaitant couvrir tous les thèmes du sujet. Il est initié par les associations Chercheur toujours, ADELI explorateurs des espaces numériques, SEIN, AFAS, et MURS (mouvement universel de la responsabilité scientifique). Lors de la première conférence le 3 octobre dernier, sont intervenus Juliette Mattioli, experte IA à Thales, membre de délégations françaises pour l’IA (G7), et Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la Sorbonne Université, site Pierre-et-Marie-Curie (LIP6), membre de l’Institut universitaire de France, ainsi que de la CERNA (Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d’Allistene) et président du Comité d’éthique du CNRS (Comets).
|
|
Jean-Gabriel Ganascia a tout d’abord posé une question centrale à ses yeux : « Sommes-nous toujours dans la modernité ou bien va-t-on au-delà avec l’intelligence artificielle ? »
Origines de l’intelligence artificielle
L’Homme se demande depuis longtemps si une machine peut penser. Pour une poignée de philosophes, la pensée tient d’une opération et donc « penser, c’est calculer ». Pour Leibniz surtout, tout se produit par calcul dans la nature, et notamment la pensée. L’adhésion à ce postulat entraîne donc la possibilité de construire un instrument pensant. Mathématiser la logique pour l’incorporer à des systèmes mécaniques, électroniques ou informatiques a concrétisé cette vision ultérieurement. L’économiste anglais Charles Babbage (1791-1871), précurseur de l’informatique, a imaginé le concept de l’ordinateur. Trop cher, trop complexe, il n’a jamais pu le construire de son vivant. Ada Lovelace, mathématicienne, l’assiste. Elle invente des programmes pour cet équipement du futur. Selon Ada Lovelace, véritable visionnaire, l’appareil traitera autant les mathématiques que la musique et le texte. Bien plus tard, en 1948 et 1950, le cryptologue Alan Turing écrira deux articles dans lesquels il pose la question du sens de la pensée pour un outil. Il s’intéresse à la création d’un système qui puisse la simuler. Il estime qu’un tel équipement doit acquérir des quantités de connaissances par lui-même. Mémorisation, réseau neuronal, évolution de l’espèce, Alan Turing dresse un parallèle avec l’homme pour concevoir cet appareil. Il ne parle cependant pas d’intelligence artificielle. Cette expression est formulée en 1955 par John McCarthy et Marvin Lee Minsky, tous deux professeurs de mathématiques, qui fondent cette discipline scientifique. Rappelons que le premier ordinateur électronique apparait neuf ans plus tôt en 1946. Leur intention est de l’utiliser pour mieux comprendre l’intelligence en se basant sur sa décomposition analytique. Ils souhaitent diviser toutes les caractéristiques de l’intelligence en fonctions élémentaires que l’ordinateur puisse simuler. Jean-Gabriel Ganascia énumère les fonctions de base reproductibles par l’intelligence artificielle, qui se classent en cinq catégories :
• la mesure, d’informations à travers des capteurs, qui sont interprétées, c’est-à-dire la perception ;
• la description des informations dans la mémoire, appelée la représentation des choses même en leur absence, l’abstraction. L’extraction de connaissance à partir de ce stock constitue un apprentissage ;
• l’exploitation des informations mémorisées et des connaissances permet de raisonner ;
• perception, connaissance et raisonnement doivent communiquer ensemble et avec l’Homme ;
• la décision et l’action.
Cette nouvelle science nous aide à mieux comprendre l’intelligence. En imitant nos différentes facultés, elle a généré les sciences cognitives. Exemples : le web, la biométrie, la reconnaissance de la voix…
Jean-Gabriel Ganascia et Juliette Mattioli
Les mythes, les peurs
La science de l’intelligence artificielle utilise la machine pour mieux comprendre l’intelligence. Elle simule artificiellement des capacités de l’intelligence. Mais le grand public prend l’expression dans son sens littéral et il la transforme en intelligence fabriquée de façon artificielle. Ressurgissent alors des peurs et des mythes anciens comme « recréer l’Homme ». Ainsi Pygmalion tombe amoureux de sa sculpture qui prend vie, le Golem fait d’argile s’anime et donne lieu à des aventures magiques, l’Andréide, née dans l’esprit du poète Villiers de L’Isle Adam, est une femme parfaite disant toujours la vérité…
L’opinion publique entend l’intelligence artificielle comme un terme de science-fiction, alors qu’il s’agit d’une expression choisie par des professeurs pour désigner une discipline parfaitement définie. À l’inverse, si les robots impressionnent, nul ne craint la robotique. Or, paradoxalement, ce nom est tiré d’êtres fictifs, très exactement des travailleurs artificiels, inventés dans une pièce de théâtre de 1920 écrite par Karen Chapeck. Depuis l’antiquité, le double de l’homme est ressenti comme une menace. Dans de nombreuses cultures, une malédiction s’abat sur celui qui tente de construire une réplique de l’homme. Il se place dans une position sacrilège, celle d’un dieu.
La perte de son emploi au profit d’un robot est une autre peur, actuelle. L’idée que le travail risque de disparaître se propage. De même, le robot-soldat SALA (système d’arme létal autonome), doté de la capacité de reconnaissance faciale, effraie, bien qu’il ne décide pas de sa cible. Il est tellement craint par notre société que le Parlement européen recommande à la communauté européenne de ne pas financer les industriels qui intègrent de l’IA dans les équipements de défense. Cependant, cette dernière étant partout, cela revient à ne plus soutenir nos industries d’armement.
La crainte la plus pesante est celle du dépassement de l’homme et de la fin de l’Humanité. Selon Yuval Noah Harari, historien, les techniques de l’intelligence artificielle vont prédire le risque et nous permettre d’anticiper sur notre propre défaillance ou d’agir mieux que nous-mêmes. En conséquence, des responsabilités seront confiées aux ordinateurs, moins sujets aux erreurs. Dans son livre Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, le célèbre historien explique que la civilisation a suivi trois étapes. La première est celle des religions. L’Homme ne comprend pas le Monde et il invente des dieux pour l’expliquer. La deuxième est celle de l’Humanisme. L’Homme comprend et se place au centre de tout. La troisième est le dataïsme. Les machines sont meilleures que l’Homme et deviennent responsables.
Enfin, le mythe de la singularité technologique préoccupe également de nombreux adeptes de l’anticipation. Ils redoutent que, l’IA se retourne un jour contre nous. La puissance de calcul s’accroît de façon exponentielle. Alors, pour éviter que l’ordinateur devienne plus intelligent que l’Homme, on peut tenter de renforcer les capacités humaines. C’est ce que propose Elon Musk avec une de ses sociétés qui développe des implants cérébraux et des dispositifs pour améliorer la mémoire et l’intelligence. On peut également s’hybrider à la machine. C’est l’idée de Ray Kurzweil, directeur scientifique chez Google. Il compte télécharger l’esprit sur ordinateur (mind uploading) et éventuellement le réincarner dans un robot. Pour Gabriel Ganascia, toutes ces hypothèses se basent davantage sur des fantasmes que sur la réalité.
L’éthique et le développement du numérique
Parallèlement aux peurs irrationnelles existent de vrais dangers. La
puissance colossale des techniques d’intelligence artificielle peut poser des
problèmes, notamment d’ordre éthique.
La tentation est grande de croire que l’IA, avec une multitude de data
se substitue à la théorie, mais elle est fausse, affirme le professeur. Par
ailleurs, pour un logicien, l’apprentissage de la machine repose sur
l’induction, c’est-à-dire le fait de passer du particulier au général. Or, cela
suppose de l’uniformité, de la constance dans le temps et dans l’espace :
ce qui est vrai ici et maintenant le sera toujours ailleurs et plus tard. Ce
principe n’est pas universel.
Par ailleurs, corrélation et causalité sont souvent confondues. Exemple : les crèmes solaires sont corrélées au cancer de la peau. Elles ne provoquent pas la maladie pour autant. L’IA repose beaucoup sur des données personnelles. Leur collecte apparaît comme une intrusion des acteurs principaux d’Internet dans la vie privée. Leur modèle économique parvient à vendre du gratuit, de la publicité invisible ciblée. L’optimisation du taux de retour des publicités dépend directement de la finesse et de la quantité de données analysées. Les objets connectés, aujourd’hui, participent avec leurs capteurs à enrichir toute ces bases d’informations.
Concernant l’automatisme et la décision, qui est responsable ? La
machine ou l’Homme ?
Le professionnel qui, demain, ne suivra pas la décision de l’algorithme
sera-t-il assuré ? De même, si le contrat d’assurance est établi
sur-mesure en fonction d’une analyse d’informations spécifiques au client, la
mutualisation ne risque-t-elle pas de disparaître ? La décision de la
machine est opaque, on peut s’en inquiéter d’autant plus que la société évolue
au gré des concepts véhiculés par le numérique. De la sorte, amitié ou
confiance, toutes les relations, tout le tissu social sont concernés.
La science de la donnée (data science) se définit par l’analyse des données à travers des techniques statistiques. L’intelligence artificielle dite connexionniste ou statistique essaie d’inférer un modèle à partir de ces informations. Dans cette approche se trouve l’apprentissage automatique. Ses inconvénients résident dans sa gourmandise en espace mémoire et dans l’incompréhension que l’Homme a de ses algorithmes. Autre concept, l’intelligence artificielle dite symbolique repose sur des modèles au moyen desquels elle raisonne et résout des problèmes complexes. Elle aide à la décision. C’est le domaine du good old fashion AI, celui du système expert. Cette solution coûte cher. Finalement, les deux voies se combinent de plus en plus et aboutissent à une intelligence artificielle hybride.
C2M
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *