Article précédent

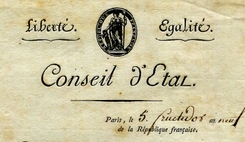
Le Conseil d’État a incontestablement joué un rôle central dans l’œuvre napoléonienne. Dès après le coup d’État du 18 brumaire, le grand théoricien de son temps en matière constitutionnelle, Sieyès, proposa d’introduire un Conseil d’État dans les nouvelles institutions. Bonaparte s’empara de cette idée qui allait mettre un terme à la période « sans Conseil » – c’est-à-dire sans que l’autorité gouvernementale soit accompagnée d’un organisme administratif permanent, spécialisé et susceptible d’être consulté à tout moment – qu’avait été la Révolution. Des débats sur la forme, le caractère et le rôle qui devaient lui être donnés s’ensuivirent jusqu’à ce que le Premier consul, désireux d’en finir, soumette brusquement aux commissions créées par la loi du 19 brumaire le texte de la Constitution de l’an VIII, adopté tel quel le 13 décembre 1799 et ratifié par plébiscite quelques semaines plus tard.
Le Conseil d’État renaissait. Il n’était pas ressuscité à l’identique de ce qu’il avait été auparavant – les historiens ont de toute façon bien montré que de Philippe Le Long à Louis XVI, le « Conseil », quel que soit son nom, n’a cessé de se transformer au gré des évolutions de l’État monarchique – mais plutôt recréé comme le sont, dans la croyance hindouiste, les morts réincarnés en d’autres formes de vie.
La Constitution du 22 frimaire chargeait le Conseil d’État, « sous la direction des consuls », de rédiger les projets de loi, défendre ces projets devant le Corps législatif, rédiger les règlements d’administration publique et « résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». Son article 41 précisait par ailleurs que les conseillers d’État seraient nommés et révoqués à volonté par le Premier consul.
Le Conseil d’État fut, dès l’origine, organisé en sections – finances, législation, guerre, marine et intérieur ; ses quarante premiers membres, parents de Napoléon, généraux, amiraux, anciens conventionnels, savants ou acteurs du coup d’État de brumaire, avaient tous le « grade » de conseiller d’État, ceux d’auditeur et de maître des requêtes n’ayant été respectivement créés qu’en 1803 et 1806 ; Bonaparte, Premier consul puis Empereur, le présidait. Aussi en fit-il, dans la pratique, un organe incontournable de son gouvernement : c’est au Conseil d’État que furent rédigés les grands codes dont nous avons hérité, au premier rang desquels figure le Code civil ; c’est parmi les membres du Conseil d’État que Napoléon choisit ses ministres, ses ambassadeurs, ses préfets, ses administrateurs, tous les hommes – les temps ont de ce point de vue changé – qui dirigèrent le pays sous ses ordres pendant quinze ans. C’est en d’autres termes au Conseil d’État, comme il le dit un jour à Roederer en lui suggérant de refuser sa nomination au Sénat, que de grandes choses étaient à faire.
Le Conseil d’Etat napoléonien aujourd’hui
Du Conseil d’État napoléonien dont je viens d’esquisser le tableau à grands traits, que reste-t-il aujourd’hui ? Quels liens existent encore entre ce Conseil tout entier subordonné au chef de l’État et le Conseil d’État actuel, juridiction suprême de l’ordre administratif, garante de l’État de droit et institution chargée de rendre des avis indépendants sur tous les projets de loi, d’ordonnances et de décrets les plus importants ?
Il reste l’organisation en sections, bien que leur nombre, leurs compétences et leurs dénominations aient changé ; il reste les trois grades, même si les fonctions dévolues aux conseillers d’État, aux maîtres des requêtes et aux auditeurs aient sensiblement évolué. La survivance de ces grades témoigne toutefois d’une particularité fondamentale de la composition du Conseil d’État : je veux parler du brassage des générations, de l’esprit de compagnonnage qui y règne entre les conseillers les plus chevronnés et les jeunes auditeurs. Auditeurs qui ont été créés pour être, comme le disait Locré, de « vrais magistrats et de vrais administrateurs », et qui forment aujourd’hui encore un vivier de talents utiles à l’intérieur comme à l’extérieur du Conseil, après qu’ils y ont été formés à ses métiers de très haute technicité.
Il reste aussi, je le crois, un état d’esprit : comme le rapporte Tony Sauvel, « Bonaparte avait vu d’emblée dans le Conseil, non pas un corps fait pour entendre des discours, mais un corps fait pour travailler », loin de l’emphase et de la grandiloquence. Il règne encore au Palais-Royal ce dédain pour les grandes phrases et les formules toutes faites, cet esprit de travail, cette atmosphère sérieuse et rigoureuse qui n’empêche pas la camaraderie, cette austérité qu’en ce qui me regarde, j’ai toujours fort prisée, et qui contraste avec les ors de certaines salles. Un ton particulier semble corrélativement avoir survécu : lorsque Roederer note que Bonaparte a d’emblée « établi dans le Conseil d’État une discussion vive et familière, exempte des inconvénients attachés aux discussions des tribunes », que la parole y est « à l’orateur qui éclaire » et « le ton (…) tel qu’il doit être pour aider au mouvement de l’esprit sans exciter celui des passions », j’y vois une description parfaite des discussions qui ont lieu chaque semaine au contentieux ou en Assemblée générale. Au Conseil d’aujourd’hui comme dans celui d’hier, la conviction des autres ne s’emporte que par sa réflexion et son travail personnels : les postures y sont dénuées d’effet, et nul ne songerait à convaincre en véhiculant les idées des autres ou les suggestions de groupes d’intérêts.
Il reste, enfin, deux idées essentielles, plus anciennes que Napoléon mais qu’il a remises au goût du jour en l’an VIII. La première, c’est celle d’un Conseil à la fois multiple et unique. Sous le Consulat et l’Empire, le Conseil d’État exerça en même temps des fonctions gouvernementales, administratives et juridictionnelles. L’équilibre entre ces attributions a ensuite beaucoup varié, mais de cette notion de pluralité a découlé ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler le « dualisme fonctionnel » du Conseil d’État, c’est-à-dire la réunion en son sein de missions consultatives et juridictionnelles. La seconde idée – Bernard Pacteau y voit « l’intuition majeure » de l’an VIII – est la position particulière assignée au Conseil d’État dans les institutions : auxiliaire du chef de l’État et de son gouvernement certes, mais auxiliaire qui leur reste extérieur. C’est cette position incertaine qui a progressivement permis au Conseil d’État de devenir le principal censeur de l’administration. C’est cette ambiguïté problématique qui a nourri les tensions ayant émaillé son existence, comme le dynamisme avec lequel il n’a cessé d’évoluer.
L’émancipation du Conseil d’Etat
Car en 200 ans, le Conseil d’État a bien changé, pour le meilleur. De ce point de vue, le changement le plus fondamental est son émancipation du pouvoir politique, vis-à-vis duquel il a progressivement acquis – dans les faits et dans les textes – une indépendance et une autonomie totales. Et s’il est vrai que son histoire, au cours du XIXe siècle, ne fut pas exempte de retours en arrière, en particulier d’épurations, elle se caractérise par une succession de ruptures organiques et fonctionnelles d’avec l’administration, dessinant ce que le doyen Hauriou a pu appeler un phénomène d’« abnégation ».
Le décret du 21 juillet 1806 créant la commission du contentieux, instituant une véritable procédure contradictoire et ouvrant la saisine du Conseil d’État aux justiciables, lui permit de se spécialiser et marqua la première étape de sa transformation en une véritable juridiction. Dès cette époque, ses avis rendus en matière contentieuse furent presque toujours suivis par l’Empereur, qui disait lui-même que pour les signer, il n’était « qu’une griffe ». Durant les six décennies qui suivirent la chute de l’Empire, sous la pression des libéraux qui s’étonnaient – à juste de titre – que le Conseil d’État reste trop lié au gouvernement, cette « juridictionnalisation » ne cessa plus de s’accentuer, et de nombreuses réformes conduisirent à ce que la barrière séparant le juge de l’administration fut toujours plus haute : ainsi, par exemple, l’ordonnance du 12 mars 1830, qui prévoyait que les membres d’un comité ayant délibéré sur la décision d’un ministre faisant l’objet d’un recours contentieux ne participent ni à l’examen du recours, ni à la rédaction de l’avis ; ainsi que la loi du 21 juillet 1845 qui interdisait au Roi de refuser de suivre un avis contentieux du Conseil d’État sauf en cas de circonstances exceptionnelles. La IIe République instaura pour sa part, avec la loi du 3 mars 1849, une véritable justice déléguée : le Conseil d’État se mit à rendre ses décisions en dernier ressort, « Au nom du Peuple français ». Napoléon III rétablit un système de justice retenue mais l’idée survécut. Aussi la France était-elle mûre, à la chute du Second Empire, pour consacrer l’indépendance de la justice administrative : c’est ce que fit la « grande » loi du 24 mai 1872, dont l’article 9 énonçait : « le Conseil d’État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative ». Elle consacrait aussi la dualité de ses fonctions ainsi que, de manière notable, la séparation des juridictions administrative et judiciaire qu’au total, ni les Révolutionnaires, ni Napoléon, ni la IIe République, ni Gambetta ne remirent en cause.
Parallèlement à ces réformes, un ensemble de coutumes se sont dessinées, mettant en cohérence le statut des membres du Conseil d’État et ses fonctions de juge indépendant et impartial. À compter de 1872, leur inamovibilité est acquise et, sauf à la Libération, jamais un gouvernement n’y dérogera. En interne, l’avancement à l’ancienneté, qui garantit une promotion exclusive de tout favoritisme, devient rapidement la règle. Ces coutumes sont profondément enracinées dans les esprits et dans la pratique : c’est ce qui fait toute leur force, car l’on sait qu’il est souvent plus aisé de biffer un texte que de changer les comportements.
Quoiqu’il en soit, l’indépendance de la juridiction administrative est aujourd’hui protégée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes : le Conseil constitutionnel, par deux décisions de 1980 et 1987, l’a érigée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République, et la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’a pleinement reconnue dans ses arrêts Kress et Sacilor-Lormines de 2001 et 2006.
En comparant le Conseil d’État napoléonien et le Conseil d’État d’aujourd’hui, on est ainsi frappé par le chemin parcouru, par l’importance de ses transformations : chacune d’elles exprime les avancées de la démocratie dans notre pays. Elles nous rappellent aussi que le Conseil d’État n’a jamais été le fruit d’une construction théorique abstraite ; que pour le comprendre, ce n’est pas dans les traités de science politique ou dans nos constitutions qu’il convient d’aller voir, mais dans l’histoire, dans la pratique, dans les coutumes, dans les conventions. Il y a là, j’en conviens, quelque chose de perturbant pour nos esprits cartésiens. Mais ce n’est qu’ainsi, en acceptant de lever le voile des apparences, que l’on pourra saisir à sa juste valeur la contribution essentielle du Conseil d’État à l’État de droit.
Bruno Lasserre,
Vice-président du Conseil d’État
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *