Article précédent
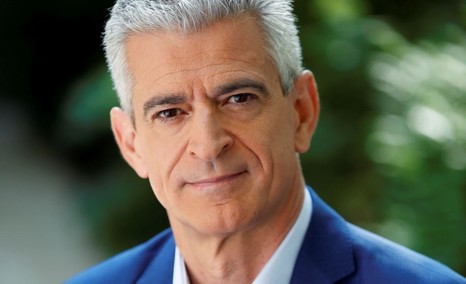

Fougueux et enlacés, tendres et amoureux, charnels et
sensibles, ils sont nus. Complètement nus. Dépouillés de vêtements et de
bijoux. Afin de les rendre intemporels. Universels… Éternels !
Dans un inoubliable baiser…
Un Baiser exposé au musée Rodin à Paris. Maintes fois
dupliqué.
C’est une œuvre en terre cuite réalisée en 1882. C’est
également un chef-d’œuvre de marbre. Un chef-d’œuvre conçu par un grand
sculpteur qui déclara un jour à Picasso : « Commencez par signer, que je sache
dans quel sens ça se regarde ! ».
Mais un chef d’œuvre réalisé dans le marbre par un
sculpteur beaucoup moins connu.
Le grand sculpteur, auteur de l’esquisse et de la terre
cuite est Auguste Rodin, fils d’un agent administratif de la préfecture de
police.
Mais c’est un sculpteur collaborateur de Rodin, qu’on
appelle un praticien, Jean Turcan, fils d’un emballeur de farine, qui réalise
en marbre la reproduction fidèle du modèle en terre cuite finalisé par son
maître.
La journaliste Julia Cartwright décrit cet enlacement
magique et sensuel en 1884 dans le journal The
Magazine of Art comme « l’instant même
du baiser », ajoutant qu’il y a « tant de pureté et une telle recherche
d’art et d’humanité ».
À l’origine, c’est une histoire d’amour légendaire et
adultère qui inspire une autre histoire d’amour légendaire et adultère,
laquelle inspire une troisième histoire d’amour symbolisée par un baiser devenu
mythique.
Le Baiser, Auguste Rodin
Le chevalier et la reine… adultère, amour héroique et
sacrifice… une légende
La première est l’histoire du chevalier Lancelot du Lac
et de la reine Guenièvre, qui se déroule au temps des Chevaliers de la Table
Ronde et qui symbolise l’amour courtois. La légende veut que Lancelot soit un
descendant de Joseph d’Arimathie, le personnage biblique cité par les quatre Évangiles, qui
intervient dans la péricope de la phase finale de la Passion et de la mise au
tombeau, participant à la descente de la croix et à l’inhumation du Christ.
Dans la légende, il aurait recueilli le sang de Jésus dans un calice ou un
vase, le Saint Graal. Lancelot, enlevé par la fée Viviane au cœur de la forêt
de Brocéliande, élevé dans un merveilleux palais au fond d’un lac, devenu
chevalier à la Cour du roi Arthur, tombe éperdument amoureux de l’épouse de ce
dernier. Le roi Arthur surprend les amants et condamne son épouse adultère au
bûcher. Mais Guenièvre est sauvée par Lancelot qui part en exil après avoir
obtenu le pardon du roi. La reine est finalement épargnée.
Paolo et Francesca …une histoire vraie... romancée
Paolo Malatesta, originaire de Ravenne, et Francesca da
Polenta, originaire de Rimini, sont deux personnages réels ayant vécu en
Romagne (Italie). L’histoire raconte que le frère de Paolo avait désigné
celui-ci comme procurateur afin d’obtenir l’accord de Francesca pour qu’elle
l’épouse. Si le mariage a bien lieu entre le frère et la jeune femme, cette
dernière est en réalité tombée amoureuse de Paolo, bien plus jeune et bien plus
beau que l’époux, lui aussi rapidement séduit et épris. Le
mari tue les deux amants alors qu’ils lisent
l’histoire de Lancelot et Guenièvre.
Un amour dantesque en
enfer… une comédie plutôt divine
« Amor condusse noi ad una morte… ». Dans le chant V du
poème « L’Enfer », Dante Alighieri introduit dans sa « Divina Commedia »
l’histoire de Paolo et Francesca, prétexte idéal pour symboliser le péché de
luxure qui conduit à la mort et à la porte de l’Enfer.
Les trois parties de la « Divine Comédie », intitulées «
cantiques », sont composées chacune de 33 chants. Dante, pour qui la terre est
au centre de l’univers, qui aspire à rencontrer la Sainte Trinité, qui est
inspiré par le conflit des Guelfes et des Gibelins, y décrit, pour les
Chrétiens, ce qui advient après la mort.
Les luxurieux, Paolo et Francesca, précèdent les
gourmands et les avares en enfer, où tous les pécheurs subissent les tourments
les plus variés ! Les amants coupables sont punis par un tournoiement de vents
incessants : « L’infernal ouragan, qui
jamais ne s’arrête, emporte les esprits dans sa course rapide, et, les roulant,
les froissant, les meurtrit » (poème L’Enfer, chant V vers 11, traduction
Lamennais 1863).
La porte de l’enfer
En
1880, Auguste Rodin, qui a presque quarante ans, est sollicité par le
gouvernement pour concevoir une porte décorative ornée de personnages mettant
en scène la Divine Comédie de Dante. Un arrêté ministériel confirme
cette commande publique.
Le
célèbre sculpteur va mettre plus de dix ans à réaliser ce qui va devenir son
principal chef-d’œuvre. Il crée 250 groupes
de figures, parmi lesquels Le Penseur, Ugolin, Fugit Amor, et… les
fameux amants italiens, Paolo et Francesca, symbolisant la luxure dans l’Enfer
de Dante, ballotés par les vents.
En
imaginant tous ces groupes, Rodin crée un véritable répertoire de personnages
et de thèmes dans lequel il va puiser au long de sa carrière, et d’où sortiront
nombre de bronzes individuels.
En
outre, il ne se contente pas de reproduire les personnages de Dante car il
s’inspire vigoureusement des Fleurs du Mal de Baudelaire*.
Le baiser
Le Baiser, qui n’est donc à l’origine que l’un des
nombreux motifs de la Porte de l’Enfer, change de place et évolue dans le décor
de la porte.
Il finit par en être séparé, remplacé par un groupe de
deux amants, afin de devenir un groupe sculpté autonome que n’aurait pas renié
Baudelaire écrivant dans « La
métamorphose du vampire » : « Je
remplace, pour qui me voit nue et sans voiles,
La lune, le soleil,
le ciel et les étoiles ! »
ou encore dans « Les bijoux » : « La très-chère était nue, et, connaissant mon cœur, Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores… ».
En 1888, le gouvernement commande à Rodin une version
plus grande en marbre pour représenter le talent français lors de l’Exposition
universelle de Paris de 1889. Rodin la réalise en terre cuite, mais, ne sachant
pas tailler le marbre (ce qui lui fut reproché avec véhémence par plusieurs
critiques artistiques), fait sculpter la version marmoréenne par Jean Turcan.
C’est ainsi que naît le Baiser tel que l'on peut aujourd'hui admirer.
Dante les associait à la luxure et au péché. Rodin a sorti Paolo et Francesca de l’Enfer, les
transformant en missionnaires universels d’une sensualité ardente et émouvante,
acteurs d’une Saint-Valentin permanente.
Ses deux amants de terre puis de marbre s’embrassent
avant de s’embraser et se courbent pour rapprocher leurs corps.
Rodin, en faisant parler les courbes, fait chanter les
corps. En silence, sans trompette et sans cor. Toujours et encore.
* Concernant l’interdiction par la
justice des Fleurs du Mal, voir notre 28e chronique dans le JSS n°
6 du 21 janvier 2018.
Étienne Madranges,
Avocat à la cour,
Magistrat honoraire
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *