Article précédent

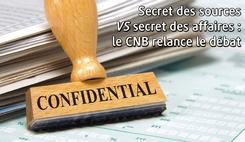
La loi sur le secret des affaires est-elle venue mettre en péril le travail des journalistes et des lanceurs d’alerte ? Alors que ces derniers avaient fait entendre leur mécontentement contre un texte menaçant, selon eux, la pérennité du droit à l’information, notamment dans une tribune pour Le Monde, l’Université d’été du Conseil national des barreaux (CNB) a relancé le débat début septembre, et croisé les regards d’avocats, journaliste et magistrat.
|
|
Cette année, le CNB a souhaité alimenter la controverse. À l’occasion de son Université d’été, le 6 septembre dernier, le lanceur d’alerte Antoine Deltour est revenu sur son rôle dans l’affaire Luxleaks. Témoignant d’un « déséquilibre entre une poignée de lanceurs d’alerte et des multinationales parmi les plus puissantes », ce dernier a estimé qu’il valait mieux « essayer de renforcer et de protéger les quelques contrepouvoirs qui existent plutôt que de renforcer les surpuissances ». De quoi ouvrir la voie à la table ronde co-organisée par l’Université par le Syndicat des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature et le Syndicat National des Journalistes, intitulée « Secret des sources/secret des affaires : quels enjeux, quelle déontologie ? »
L’avocat Jérôme Karsenti, chargé d’ouvrir le débat, s’est étonné d’un paradoxe entre « une société qui revendique de plus en plus un besoin de transparence en matière environnementale, de santé publique, de sécurité alimentaire, etc. » et l’existence d’un « nouveau secret », celui des affaires. L’avocat, membre de la Commission Libertés et droits de l'homme du CNB, a surtout souligné l’exigence citoyenne en matière de transparence politique et d’éthique, citant le cas de « François de Rugy, épinglé pour des repas qui hier étaient légion », et s’est interrogé : « Comment se fait-il que cette demande s'accommode si bien d’une opacité de plus en plus forte du monde des affaires ? » Ce dernier a avancé l’hypothèse que le lieu du pouvoir avait certainement changé : « Ce qui était lieu de pouvoir politique, lieu de l’opacité, du secret, de l’intérêt politique, tend à disparaître, et on voit que le secret des affaires prend toute la place. Est-ce à dire que le lieu du secret est le lieu du pouvoir ? Et que le pouvoir est le lieu des affaires ? »
Pour davantage développer cette nouvelle forme d’opacité dont il a fait le constat, Jérôme Karsenti s’est appuyé sur une enquête ayant eu lieu quelques années auparavant. En 2014, la journaliste néerlandaise Jet Schouten, qui s’inquiétait de la manière dont les implants étaient certifiés au niveau européen, avait, lors de ses investigations, réussi à faire passer un filet de mandarines pour un implant vaginal, et obtenu un marquage « CE ». Elle avait alors alerté le consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ), qui s’était mis à son tour à enquêter sur ces « Implant files ». Jet Schouten avait par ailleurs demandé au seul organisme français habilité à certifier les implants de bien vouloir lui adresser la liste des implants certifiés et non certifiés, afin de comparer dans quels cas ils l’étaient ou non. Face au silence de la société, la journaliste ainsi que Le Monde ont interrogé la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), au titre de la communication des documents publics, en mai 2018. Ce à quoi la CADA a rétorqué, six mois plus tard, et quatre mois après le vote de la loi sur le secret des affaires, que les documents demandés étaient couverts par le secret des affaires. Pour Jérôme Karsenti, il s’agit d’une « réponse inquiétante, qui ne vient pas d’une société d’économie mixte, mais d’une institution comme la CADA ». « Alors qu’elle était jusqu’alors un contrepouvoir public à l’opacité de l’administration, la Commission a refusé la communication de documents au nom d’une disposition catégorielle, ce qui m’inquiète sur la porosité de nos institutions », a alerté l’avocat.
Le secret des affaires « au détriment d’autres libertés publiques » selon les uns...
Jérôme Karsenti l’a rappelé : si le secret des sources est considéré historiquement comme une pierre angulaire de la liberté de la presse, il a fallu attendre, en France, la loi Dati de 2010 pour le consacrer. Or, selon l’avocat, cette loi a beau être « essentielle », elle n’en est pas moins « imparfaite » – et la loi Bloche, censée la peaufiner, a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel, a-t-il déploré.
D’un autre côté, le secret des affaires, voté par la loi française du 30 juillet 2018 à la suite d’une directive européenne, est un « principe nouveau qui s’étend, et qui tend à prendre toute la place, au détriment d’autres libertés publiques », a considéré Jérôme Karsenti, qui a indiqué avoir déjà dénoncé ce risque « aux côtés de nombreux syndicats et associations », auprès des parlementaires, au moment de la transposition de la directive secret des affaires : « Or, nous n’avons pas été entendus : la loi ainsi rédigée est une copie quasi exacte de la directive européenne. »
De quoi donner du grain à moudre à la journaliste Dominique Pradalié, qui a dépeint la loi de 2018 comme une « loi de circonstance faite pour protéger les grands lobbies mis en difficulté face à des pratiques plus que douteuses », adoptée selon une « procédure d’urgence, via une seule lecture à l’Assemblée, au Sénat, qui n’a pas permis d’apprécier à quels types de libertés elle touchait ». La secrétaire générale du Syndicat national des journalistes a par ailleurs soutenu que si elle adhérait à l’existence même du secret en question, pour pouvoir se protéger de ses concurrents, il n’était en revanche pas normal, selon elle, que le secret industriel et commercial ait été transformé en secret des affaires, lui conférant des airs « de “loi mafieuse”, comme cela a pu être dit dans la presse ». « Incluse dans le Code de commerce, elle relève ainsi des tribunaux du même nom, et non pas, par exemple, de la 17e chambre de Paris, qui a une très grosse jurisprudence en la matière », a fait remarquer Dominique Pradalié. « Or, les juges des tribunaux de commerce sont des juges consulaires dont l’objectif est de protéger le commerce, et les journalistes refusent de passer devant ces tribunaux », a-t-elle considéré. L’avocat Kami Haeri, pour sa part, s’est voulu rassurant : « Si un article vient à être publié, ce sera devant la 17e chambre qu’un débat, souvent favorable à la liberté d’informer, se déroulera. »
De son côté, l’avocat Antoine Comte s’est montré prudent : la loi sur le secret des affaires est récente, et la jurisprudence peu abondante. S’il lui semble donc hâtif d’en tirer des conclusions, l’avocat a reconnu que la loi sur le secret des affaires semblait d’ores et déjà « poser problème sur le secret des sources, sur la capacité de faire des enquêtes pour que la liberté de la presse puisse s’exercer et aboutir à communiquer aux citoyens des informations, même si ces informations déplaisent ou sont gênantes ». Antoine Comte a en effet jugé que la loi sur le secret des affaires apportait « une restriction à la loi de 2010 » et que les parlementaires s’étaient attachés à « ne protéger qu’en apparence la liberté de la presse ». L’avocat a pointé que les articles L. 151-8 et L. 151-9 du Code de commerce, qui prévoient des exceptions à la protection du secret des affaires, précisent « à l’occasion d’une instance » : « C’est donc toujours à l’occasion d’une instance que le secret des affaires n’est pas opposable aux journalistes », a-t-il souligné. « À ce stade, on n’a aucune garantie qu’en amont d’une instance éventuelle, il n’y ait pas un obstacle opposé par le secret des affaires à des enquêtes. » À l’instar de la décision de la CADA dans le cadre des « Implant files » : « Dans ce cas, il n’y a pas d’instance en cours, on n’est pas dans la configuration prévue par la loi de 2018, on est dans la phase en amont. On est donc dans la période où on fait des investigations, et on se prend le secret des affaires “dans les dents”. En résumé, la loi sur le secret des affaires, en l’état, et hors instance, présente un obstacle à la liberté de la presse, contrairement à ce que voulaient les parlementaires », a conclu l’avocat.
Si le secret des affaires n’est inopposable aux journalistes qu’à
l’occasion d’une instance, cela est bien légitime, a toutefois protesté
Kami Haeri. « Si ce n’était pas pendant l’instance, cela reviendrait à
dire qu’un journaliste aurait la capacité de collecter une information dont
même un procureur ou un juge, sous le contrôle d’un autre juge, doit justifier
l’obtention, en produisant un commencement de preuve.
La demande d’information, équivalente à une réquisition judiciaire,
n’obéirait-elle donc à aucune forme de défense, de contrôle ? », a
lancé l’avocat.
… Un régime « équilibré », respectueux d’une hiérarchie, selon les autres
À contre-courant des craintes exprimées par les précédents intervenants, Kami Haeri s’est dit « surpris par la dimension incantatoire » de ces dernières. « La loi de 2018 dit simplement qu’un certain nombre de secrets peuvent être protégés, avec des exceptions. Comment pourrait-elle être un cache-sexe de turpitudes de l’entreprise ? », a-t-il questionné. Et de préciser qu’il n’avait jamais vu une entreprise soulever le secret des affaires en opposition à une perquisition, et que la loi n’était, de toute façon, pas opposable au régulateur pénal. « La défense n’est proposée que dans un rapport horizontal, dans des situations où l’on essaie, sous couvert d’un vague préjudice né ou à naître, de venir collecter des informations. Les dispositions réservent donc un droit qui me semble absolu au bénéfice de la liberté d’expression et de communication », a fait savoir Kami Haeri.
Le secrétaire général du Syndicat de la magistrature, Vincent Charmoillaux, a lui aussi salué un régime juridique « équilibré ». « Tout un nombre d’exceptions sont prévues dans le texte et laissent à penser qu’il n’y a pas trop de risques de voir des lanceurs d’alerte être condamnés », a assuré le secrétaire général du Syndicat de la magistrature, qui ne voit pas non plus de conflit de principe entre secret des sources et secret des affaires. Au contraire, il distingue « une hiérarchie claire » entre les deux, puisque le secret des affaires a une apparition récente, sur la base de la directive de 2015, « qui prévoit plein de limites et de dérogations », tandis que le secret des sources revêt « un haut niveau de protection, au moins au niveau de la CEDH », a-t-il jugé, en référence à l’arrêt Goodwin de 1996. Hiérarchie qui n’empêche pas le bien-fondé de chacun des deux principes : « Ce n’est pas une question de dire “pour ou contre le secret des affaires”. Ce dernier existe et est légitime. Il y a bien un intérêt à ce que des entreprises ne se fassent pas dépouiller de leur savoir-faire et de leurs innovations. La question est plutôt que le secret des affaires doit rester à la place qui lui est donnée par les textes : celui d’un principe de valeur secondaire. »
En effet, Vincent Charmoillaux a insisté : le secret des affaires sert à lutter contre l’espionnage industriel et l’appropriation frauduleuse d’innovations, « et non pas à protéger des acteurs privés ». Un axe également défendu par la présidente du Cercle Montesquieu et directrice juridique Laure Lavorel, qui a certes admis que la loi pouvait « avoir des effets collatéraux » dont il fallait que « l’on arrive à mesurer l’impact », mais qui a surtout tenu à souligner l’objectif de protection du patrimoine de l’entreprise par la loi. Selon cette dernière, les entreprises seraient souvent démunies pour protéger leurs informations commerciales au sens large : leur savoir-faire. « Dans les nouvelles technologies, en Europe, il est compliqué de passer sous forme de brevet, donc on est sur la propriété intellectuelle. Et il est important pour la compétitivité des entreprises que des lois permettent de mieux appréhender la protection du patrimoine de l’entreprise. »
Données des entreprises : « Il était important de retrouver une souveraineté judiciaire »
Laure Lavorel en a profité pour rappeler que la question du secret des affaires n’était pas « l’une des dernières mesures sorties du chapeau pour protéger les entreprises », mais qu’elle datait de plus de 25 ans, puisqu’en 1994, déjà, l’OMC avait rédigé un texte. Celui-ci, ratifié par la plupart des pays internationaux, n’a pourtant jamais été réellement mis en œuvre.
Alors que les États-Unis, déçus par l’absence d’effets de cette nouvelle règle, adoptent deux actes pour lutter contre l’espionnage économique, en France, en parallèle, c’est en 2012 qu’une première initiative parlementaire souhaite codifier et réglementer le secret des affaires, avec l’intention de protéger le patrimoine de nos entreprises. « Il est intéressant de relever, pour donner de la perspective, que ce projet prévoyait des sanctions pénales », a souligné la présidente du Cercle Montesquieu, puisque le projet de loi, très restrictif, devait sanctionner alors toute divulgation. Ce dernier n’aboutit pas, et, en 2014, un deuxième projet de loi, également proposé par des parlementaires, est mis sur la table : il prévoit cette fois des sanctions civiles et pénales, mais c’est encore un texte qui sanctionne violemment. Enfin, troisième tentative : une proposition, dans la loi Macron, ne reprend plus les sanctions pénales, et se concentre sur les sanctions civiles et commerciales. Mais ce projet est là encore abandonné, et la France n’aura, à titre national, plus d’initiative sur la question.
Laure Lavorel a donc insisté sur le fait qu’aujourd’hui, si la loi de 2018 est une pure retranscription de la directive européenne, elle permet cependant « de mettre en perspective la volonté du législateur français, qui a beaucoup évolué », et « la réalité des faits » : « par rapport aux précédents projets de loi, la loi ne me semble pas très contraignante. Elle l’est car elle contient des mesures civiles et commerciales, mais plus du tout de sanctions pénales », a précisé la présidente du Cercle Montesquieu.
Au-delà, pour cette dernière ainsi que pour Kami Haeri, la loi sur le secret des affaires était nécessaire : il fallait donner aux informations une protection complémentaire dont d’autres pays bénéficiaient déjà. « Avec la globalisation, les entreprises françaises ont été soumises à deux phénomènes : des outils ont été confiés à des entreprises étrangères pour venir attaquer à des fins tactiques les entreprises françaises, et des régulateurs étrangers de plus en plus puissants qui bénéficient de règles d’extra territorialité se sont invités dans la vie économique française, a pointé l’avocat. L’information est devenue reine, et un questionnement mondial s’est constitué : comment protéger ces informations et ces procédés ? » Laure Lavorel a opiné : « On a une loi américaine, le Cloud Act, qui permet l’accès direct sur certaines des données des entreprises, et il était important qu’on retrouve en France une forme de souveraineté judiciaire. » Pour cette dernière, la loi de blocage française n’a « jamais été appliquée de la manière dont elle aurait dû l’être » par les tribunaux, et ne constitue pas aujourd’hui « un bouclier suffisant » pour protéger le patrimoine des entreprises. « L’idéal n’étant pas de ce monde, au Cercle Montesquieu, on considère que cette loi est une avancée sérieuse, intéressante, dans la protection des intérêts de l’entreprise, et elle permet d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises. »
Kami Haeri a ajouté qu’avec la directive sur le secret des affaires, la France avait ainsi harmonisé son arsenal législatif. « Avec Sapin II, nous nous sommes dotés d’un certain nombre d’outils et d’obligations, nous avons créé une agence française anticorruption », a-t-il salué, invitant à « laisser quelques années à cette nouvelle série de règles pour voir comment elles vont transformer la société, qui commence déjà à se transformer positivement ».
Éviter des « procédures-bâillons » aux journalistes
Peu
convaincu par l’idée de deux lois qui s’opposeraient, Vincent Charmoillaux a
toutefois identifié un autre problème : le dommage causé par la procédure
lancée par l’entreprise contre le journaliste. Une « tendance
contemporaine assez forte », a regretté le magistrat, que l’on
retrouve par exemple dans le problème de « l’usage assez large »
de la garde à vue pendant la manifestation des gilets jaunes, ou, plus
généralement, du placement en garde à vue pendant 48h « sur la base
d’éléments faibles et peu exploitables judiciairement parlant », pour
finalement, logiquement, classer sans suite, a illustré le magistrat. « En
suivant la même logique, en tant que juriste, on serait tenté de dire, à un
journaliste ou à un lanceur d’alerte : “Bon, on vous a reproché une
atteinte au secret des affaires, mais vous n’avez pas été condamné, donc il n’y
a pas de problème !”, ou bien “Certes, on a porté atteinte à vos sources
avec une perquisition, mais la procédure a été annulée, donc tout va
bien !” ». Or, pour Vincent Charmoillaux, il s’agit du « royaume
du fait accompli » : ce n’est pas parce qu’il y a absence de
condamnation au terme de la procédure que la procédure n’est pas dommageable.
« Il ne faut pas oublier que le journaliste s’est retrouvé entravé sur
la base d’une procédure liée à l’échec, ou alors, à l’inverse, qu’il s’est
abstenu d’exercer une liberté pour éviter de se retrouver dans cette
situation : qu’il n’a pas rédigé tel article car il ne voulait pas prendre
le risque d’être perquisitionné, qu’il s’est abstenu de publier pour ne pas
avoir à supporter un contentieux très coûteux pendant des années sur la base du
secret des affaires, quand bien même il aurait eu raison à la fin. »
Pour le magistrat, le problème résiderait donc dans l’atteinte à l’exercice des droits. À son sens, il s’agit ici de « la plus grosse insuffisance » de la protection des sources et de la loi sur le secret des affaires. « Il n’y a pas de garanties suffisantes pour éviter cet usage par un certain nombre d’acteurs de procédures qu’ils savent vouées à l’échec, où l’objectif n’est pas de gagner, mais de dissuader, ou de casser les pattes des adversaires. » Vincent Charmoillaux a donc estimé nécessaire d’instituer des garde-fous et des sanctions « pour éviter des procédures-bâillons ». « Il n’est pas suffisant d’avoir raison à la fin », a-t-il martelé.
Un avis partagé, sur ce point, par Dominique Pradalié, qui a pointé du doigt la dissymétrie des moyens entre le journaliste et l’entreprise : « Quand vous êtes journaliste ou lanceur d’alerte, et que vous vous retrouvez en pleine procédure, c’est de l’énergie, du temps – 6 à 7 ans environ, 10 ans pour Denis Robert –, de l’argent, car vous devez prendre un avocat... Puis vous avez une hiérarchie qui va vous dire qu’elle n’a pas les moyens de suivre, donc comment allez-vous sortir votre information ? Pour un journaliste qui veut juste exercer sa profession, c’est dur ! »
À l’inverse, Kami Haeri a considéré que les journalistes étaient loin de se trouver dans une situation d’infériorité par rapport aux entreprises, et que les médias avaient un tel poids que la confrontation de la vie des affaires et de l’éthique était devenue, a-t-il affirmé, de la soft law. En effet, a expliqué l’avocat, les entreprises, de plus en plus, se mettent à suivre une série de normes qui ne sont pas de droit écrit, qui n’ont pas vocation à s’appliquer, mais qu’elles considèrent légitimes. « La déflagration dans la vie des entreprises d’une atteinte à des normes éthiques fondées sur des règles non écrites est au moins aussi importante aujourd’hui que la violation de normes éthiques », a-t-il assuré. Et de témoigner : « Quand je défends une entreprise et qu’on m’annonce qu’une ONG a décidé de noter sa responsabilité sociale et environnementale, l’entreprise s’interroge sur sa chaîne de valeurs, sur ses sous-traitants à l’étranger, et le dispositif qui se déploie dans l’entreprise afin de vérifier, contrôler, corriger, et d’essayer d'harmoniser, est très important. Les entreprises sont aujourd’hui très impressionnées par l’image qu’une ONG renvoie, et quand elle les interpelle, c’est un véritable branle-bas de combat ». Kami Haeri a donc indiqué qu’il ne pensait pas « que la loi de 2018 soit à l’origine d’un affaiblissement des médias, ni que la loi constitue un nouveau déséquilibre entre les puissants et les “plus fragiles” ».
Quid du préjudice à l’intérêt général ?
« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources » a rappelé Antoine Comte, citant la loi de 2010. L’avocat en a profité pour rappeler l’origine, selon la Cour européenne des droits de l’homme, du secret des sources : il s’agit d’un moyen pour que les enquêtes se fassent, et pour que les personnes qui détiennent des informations les donnent, sans risques de s’exposer à des poursuites. « Donc c’est un moyen de l’enquête, de la recherche, de l’exercice de la liberté de la presse. »
Dominique Pradalié l’a également martelé : la procédure qui peut ainsi s’ensuivre n’est pas seulement préjudiciable aux personnes relais de l’information, mais à l’intérêt général tout entier : « On va devoir s’acharner, nous, journalistes, chercheurs, lanceurs d’alerte, à prouver qu’on est innocents. Donc on aura raison à la fin. Mais pendant ce temps-là, les dégâts continueront. Et quatre, cinq ans sur l’environnement ou la santé, je ne vous fais pas un dessin », a asséné la journaliste. « Le problème, ce n’est pas que pour les journalistes, c’est aussi pour les citoyens ! Comment vont-ils savoir si ce n’est pas par nous ? Comme les parlementaires n’ont pas pu attaquer la loi de 1881, ils ont trouvé un moyen pour la transformer complètement. Aujourd’hui, on n’a donc le droit de rien faire, sauf ce qui est permis. »
Alors que Kami Haeri a affirmé qu’il ne voyait pas en quoi ce dispositif de protection mis en place par la loi sur le secret des affaires privait « n’importe lequel d’entre nous du droit d’être informés, ou n’importe quelle personne qui aurait vocation à collecter une information au titre de l’activité de journaliste d’aller solliciter cette information, de mener l’enquête », la secrétaire générale du Syndicat des journalistes n’en a pas démordu : le défi des journalistes d’investigation est bien aujourd’hui de savoir « comment réussir à travailler malgré la loi de 2018 ».
Bérengère Margaritelli
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *