Article précédent
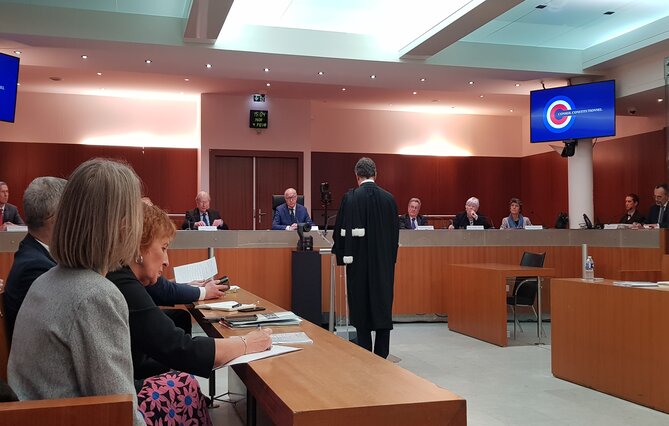

INTERVIEW. La chercheuse Andreea Gruev-Vintila, qui a participé à la rédaction de l’amendement n°29 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, adopté le 28 janvier 2025 par l'Assemblée nationale, est l’autrice du livre Le contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale[1]. Pour le JSS, elle rappelle à quel point le droit comparé, les leçons tirées des lois étrangères et la jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers ont été essentiels à l’élaboration de ce travail, insistant aussi sur la nécessité de former les professionnels du droit.
JSS :
Y a-t-il eu un déclic qui vous a poussée à vous questionner sur le contrôle
coercitif il y a quelques années ?
Andreea Gruev-Vintila : En janvier 2015, la France venait de vivre les attentats. A l’époque, j'étais l’une des seules psychologues sociales françaises qui avait produit des travaux empiriques sur la question du terrorisme, notamment après le 11 septembre 2001. C’est dans ce contexte qu’avec l’université Paris Nanterre, je porte ANR XTREAMIS, un projet scientifique sur l'antisémitisme, la xénophobie et l’islamophobie, impliquant en parallèle onze universités de pays concernés par la radicalisation violente. Ce projet a déclenché une réflexion approfondie sur la violence dans l’espace public, mais aussi privé. Parce qu’on se rend compte que le nombre de victimes des attentats de 2015 correspond quasiment à l'équivalent de ce qu'on appelait à l'époque « les morts violentes au sein du couple » comptabilisées par le ministère de l’Intérieur. Ce qui était alors surprenant pour moi, en tant que psychologue sociale, c’est que pour ces victimes-là, nous n'avions jamais constaté une mobilisation sociale comparable aux quatre millions de personnes qui ont manifesté pour protester contre les attentats terroristes. Ce décalage m'a interpellée.
JSS : Comment
s’est construite votre approche du contrôle coercitif ?
A. G.-V. : Cette
différence m’a alertée sur le décalage entre la représentation sociale de la violence conjugale et sa
traduction juridique d’une part, et sa réalité pour les femmes et les enfants
victimes, d’autre part. En 2016, nous
nous représentions la violence conjugale surtout comme violence physique -
« Monsieur maîtrise mal ses émotions », imputée à la « prise
d’alcool ou de substances ». Mais moi, j’entendais des victimes, en
très grande majorité des mères, qui décrivaient une réalité complètement
différente, faite de terreur absolue et permanente, de captivité et
d’épuisement : « bien sûr que j'ai déposé plainte, mais ils m’ont posé
des questions auxquelles j’étais incapable de répondre tant elles étaient en
décalage avec mon vécu ». Typiquement, on leur demandait de dater des
événements, alors que pour elles, c'était tous les jours et chronique.
JSS : C’est
donc en Ecosse que vous avez trouvé des réponses ?
A. G.-V. : A
l'occasion d'un voyage en Écosse début 2016 pour XTREAMIS, je découvre que ce
pays est, pour sa part, déjà en train d'incriminer le contrôle coercitif. Mes
collègues y travaillaient avec Evan Stark, sociologue des violences conjugales
dont l’ouvrage[2] était
le fondement d’une loi novatrice écossaise. Je suis rentrée en France, ce livre
dans la poche, et nous avons entamé des recherches pour comparer la
représentation sociale de la violence terroriste à celle des féminicides. A ce
moment-là, on a réalisé à quel point, à l’instar des génocides, la violence
conjugale est un processus qui commence par l’isolement des victimes et se
poursuit par une longue série d’actes qui passent sous le radar du droit. La
question qui se pose est la même : que font les tiers, l’entourage, les
institutions et l’Etat ?
JSS : Vous
avez directement travaillé à la rédaction de l’amendement n°29, que vous avez
qualifié, à son adoption, de « fruit d’un énorme travail collectif ».
Pouvez-vous nous en raconter la genèse ?
A. G.-V. : Ce
travail est en effet le fruit d’une réflexion transdisciplinaire. Au printemps
2023, lorsque la mission gouvernementale sur l’amélioration du traitement
judiciaire des violences conjugales, qui m’avait auditionnée, se déplace à
Londres, j’ai proposé à Dominique Vérien, sénatrice, et Émilie Chandler, alors
députée, de rencontrer Evan Stark, Cassandra Wiener, professeure de droit, et
Emma Katz, ma collègue experte sur l'impact du contrôle coercitif sur la
relation mère-enfant. Deux mois plus tard, le Plan rouge VIF est remis et
recommande la traduction juridique du contrôle coercitif. Grâce à Isabelle
Rome, j’avais aussi rencontré la magistrate Gwenola Joly-Coz, avec qui j’ai
partagé une résonance intellectuelle puissante et qui m’a annoncée qu’elle
envisageait une audience pédagogique[3]. C’est
dans ce contexte global qu’un groupe de travail, dont je fais partie, s’est
constitué progressivement autour de la sénatrice Dominique Vérien.
JSS : Comment
s’est organisé le travail de rédaction ?
A. G.-V. : Fin novembre 2024, lorsque Dominique Vérien nous réunit, avec mon collègue le Pr. Benjamin Moron-Puech de l’université Lyon 2, nous étions bien avancés puisque nous avions déjà envisagé la rédaction des amendements civils. Benjamin m’a présenté Alice Dejean de la Bâtie de l’université de Tilburg pour le volet pénal. Nous avons travaillé à la lumière du droit comparé, de l’analyse psychosociale de l’impact des lois étrangères, du terrain français, des avancées scientifiques, de la jurisprudence qui commençait à s’accumuler, de l’expertise internationale et des leçons apprises des autres pays, à l’image de l’Ecosse, de la Belgique, du Canada ou de l’Australie. Ce travail a été validé par des parties prenantes complémentaires, tels que des praticiens du droit, des victimes, des enfants co-victimes devenus grands, des associations d’aide aux victimes et de défense des droits des enfants. Nous voulions proposer un amendement global et inclusif. Lorsqu'en décembre 2024, Aurore Bergé a ouvert la voie avec la proposition de loi 669, Emilie Chandler m’a mise en contact avec Sandrine Josso, qui l’a brillamment porté.
JSS : En quoi
la traduction juridique du contrôle coercitif était-elle nécessaire ?
A. G.-V. : La loi
française, et en cela elle est pionnière, mobilise une approche transversale en
droit pénal et civil. Elle pénalise le contrôle coercitif, certes, mais elle
l’intègre surtout en droit civil, pour répondre à la plus grande majorité des
victimes, disproportionnellement des femmes et des enfants. En France, 82 % des
femmes victimes[4] de
violences conjugales sont des mères. Dans quatre cas sur cinq, des enfants sont
concernés. La reconnaissance du contrôle coercitif révèle la réalité de la
violence conjugale vécue par la victime comme captivité plutôt qu’agression,
par un schéma de comportement que l'agresseur met en place pour obtenir son
obéissance en la piégeant, en la privant de liberté, en l’isolant ou encore en
contrôlant ses ressources vitales.
« Nous voulions proposer un amendement global et inclusif »
- Andrea Gruev-Vintila, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, chercheuse en psychologie sociale
A. G.-V. : La
jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers, mais aussi de celle de Douai,
identifient très bien l’étendue du contrôle et les contraintes qu’il est
possible de mettre en place sur la nourriture, le sommeil, les relations
sociales, les activités… Ce qu’Evan Stark nommait précisément la
micro-régulation de la vie quotidienne : un système de règles imposées par
l’agresseur, que les victimes adultes et enfants doivent respecter sous peine
de représailles ou de contraintes, dans un état de peur chronique, parfois
permanente.
JSS : Des
comportements qui ne s’arrêtent pas toujours avec la séparation…
A. G.-V. : Je
précise que si ces comportements sont évidemment objectivables avant la
séparation du couple, celle-ci n’apporte ni sécurité, ni liberté aux victimes.
On constate en effet qu’à la séparation, l’agresseur fait évoluer ses moyens et
les registres de contrôle : n’ayant plus d’accès à la victime par la proximité,
il utilise tout autre moyen à sa disposition. Quand il sent que la seule façon
de punir sa partenaire est de saboter sa relation avec l’enfant, il peut se
servir de procédures judiciaires relatives aux droits parentaux, du déficit de
formation des professionnels, voire blesser ou tuer les enfants.
JSS : Les
victimes ou les associations de victimes que vous côtoyez espéraient-elles
cette délictualisation du contrôle coercitif ?
A. G.-V. : L’espoir
est énorme pour les victimes. Celles-ci nous racontent qu’elles entament
parfois leur septième, huitième ou dixième année de procédure. Qu’elles ont vu
douze, quatorze voire seize juges aux affaires familiales ou des juges des
enfants, qu'elles ont dépensé plusieurs dizaines de milliers d’euros, et même
plus, pour défendre leur sécurité et leurs droits ainsi que ceux de leurs
enfants. Le harcèlement judiciaire qu’elles subissent est un moyen pour les
agresseurs de prolonger le contrôle coercitif post-séparation en les épuisant
physiquement, psychiquement et financièrement. Ce qui signifie attaquer la
victime aussi dans sa fonction parentale, en l’empêchant de dédier ces
ressources à l’enfant. En fait, ils ne privent pas seulement la mère de ses
ressources, ils privent également l’enfant de la mère qu’elle voudrait être,
comme l’ont très bien identifié Gwénola Joly-Coz et Eric Corbaux dans les
arrêts de janvier 2024. J’ai d’ailleurs rencontré des femmes qui voulaient
déménager à Poitiers, afin d’être protégées !
JSS : De quoi
faire en sorte que les juges y voient plus clair dans certaines
situations ?
A. G.-V. : En
fait, il faut bien comprendre que les victimes ne portent souvent pas plainte.
Les mères s’adressent avant tout aux juges aux affaires familiales pour obtenir
une protection pour elles et leurs enfants. Ces femmes nous racontent que si
elles ne sont pas parties, ce n’est pas parce qu’elles étaient sous emprise,
mais bien parce qu’elles étaient empêchées : si elles partaient, l’enfant
serait confié un week-end sur deux au père et elles ne seraient plus là pour
faire tampon. En France, nous avions donc besoin non seulement d’incriminer le contrôle coercitif, mais aussi
d’équiper le juge civil pour identifier les situations où un agresseur
principal agit à bas bruit sous le radar du droit.
JSS : Avez-vous
rencontré des difficultés ou des obstacles, lors de la rédaction de cet
amendement ?
A. G.-V. : Je
dirais qu’un des plus grands défis était pragmatique : traduire juridiquement
une réalité de terrain ainsi qu’une réalité psychosociale majeure, en intégrant
des approches interdisciplinaires, interprofessionnelles et la société civile.
Nous avons heureusement été accompagnés en ce sens par de formidables experts.
J’identifie un autre obstacle : celui de mener de front et dans la durée ce
travail intense de médiation scientifique en parallèle de nos enseignements,
recherches et tâches d'intérêt général à l’université à plein temps. La
satisfaction est grande, certes, mais cet investissement est coûteux et doit
être reconnu par nos instances.
JSS : Des
critiques ont été émises sur la rédaction de cet amendement, jugé pour certains
comme « imprudent », du fait du champs large qu’il induit.
Typiquement, le présumé coupable de contrôle coercitif peut avoir exercé
« des actes administratifs ou numériques ». Qu’en pensez-vous
?
A. G.-V. : En tant
qu'universitaire, c'est notre travail de recevoir des critiques. Elles nous
permettent d’améliorer ce que nous produisons. Je salue donc le retour qui peut
nous être adressé. Nous devons être capables d’y répondre pour protéger les
victimes et respecter le droit français et ses principes. La définition de
l’infraction spécifique sera améliorée au Sénat. Il y a aussi des compromis :
le droit français fait du contrôle coercitif un délit, là où l’Ecosse en fait
un crime, puisqu’il s’agit d’atteinte aux droits humains fondamentaux. Mais le
risque de la classification en crime, c’est que l’affaire passe aux assises et
qu’il y ait donc peu de condamnations. En optant pour le délit, la loi sera
peut-être plus opérationnelle. Grâce aux alertes des victimes, nous pensons
également qu’il faut améliorer les circonstances aggravantes.
JSS : L’amendement
30 a été déclaré irrecevable…
A. G.-V. : Cet amendement sur la formation des professionnels a été considéré comme irrecevable financièrement en commission des lois au nom de l’article 40 de la Constitution. C’est un grand regret. A nos yeux, la formation est indispensable pour tous les professionnels qui travaillent avec des auteurs de violences et les victimes : magistrats, experts, forces de l’ordre, protection de l’enfance, pénitentiaire… C’est par ailleurs une demande de la Convention d’Istanbul[5]. L’amendement 30 attribuait aussi aux universités la responsabilité d’assurer le caractère scientifique des formations, qui, jusqu’ici, n’est pas assez clair.
À lire
aussi : Violences
intrafamiliales : l'Assemblée nationale adopte une définition du contrôle
coercitif
Nous ne préparons nos étudiants ni en droit, ni en santé, ni en psychologie, ni en sciences de l’éducation à la question des violences basées sur le genre, qui est pourtant un enjeu majeur de santé publique et de sécurité. Cet amendement était donc « gagnant-gagnant » pour tout le monde. Je précise qu’il était également assorti d’une proposition d’évaluation de la loi et de son application. Son rejet est donc un double regret. Cette loi fait sens, mais son évaluation sera nécessaire pour que l’on puisse l’améliorer. En tant qu’universitaires, nous savons qu’elle n’est pas en marbre. Pour exemple, l’Angleterre et le Pays de Galles ont dû réviser leur loi.
JSS : Quelles
sont, selon vous, les prochaines avancées à acter, dans le domaine du contrôle
coercitif ?
A. G.-V. : J’insiste
sur la nécessité de la formation sur le contrôle coercitif et les stéréotypes
de genre pour tous les professionnels concernés par la question des violences
conjugales, notamment les magistrats et leurs partenaires. Les collègues
d’Ecosse, où la loi est exemplaire, soulignent son importance capitale. La
formation est indispensable parce que c’est elle qui transforme les pratiques
en profondeur. Concernant les prochains travaux, nous étudions l’impact du
contrôle coercitif sur la santé bio-psycho-sociale des enfants et des femmes.
De même que le rôle des tiers et de l’entourage dans le rétablissement ou non
de leurs droits et de leur santé. Avec des partenaires étrangers, nous avons
déposé, enfin, un projet pour étudier l’impact du contrôle coercitif sur les
populations vulnérabilisées ou minorisées et pour comprendre comment la loi
leur répond.
Propos recueillis par Laurène Secondé
[1]Le
contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale. Des avancées
scientifiques aux avancées juridiques d’Andreea Gruev-Vintil, 2023,
éditions Dunod.
[2]Coercive control.
How men entrap women in personal lives
[3]Le 29 novembre
2023, la Cour d’appel de Poitiers organise une audience dédiée au jugement de cinq
dossiers de violences intrafamiliales. Pour chaque dossier, la Cour applique le cadre du contrôle coercitif en
établissant le lien entre les comportements quotidiens des accusés et la
restriction qu’ils produisaient sur la vie et les droits humains des victimes.
[4]Chiffres
2019 du ministère de l’Intérieur
[5]Convention
du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l'égard des femmes et la violence domestique, mai 2011 https://rm.coe.int/1680084840
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *