Article précédent
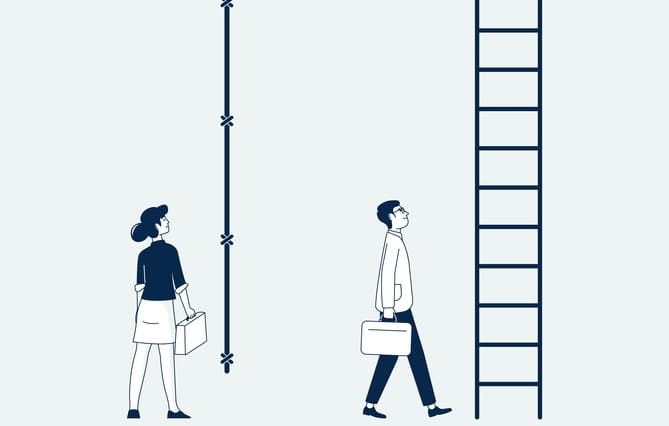

Le Premier ministre, François Bayrou, a annoncé vouloir reprendre l'étude des cahiers de doléance mis en place lors de la crise des gilets jaunes. Mais l’analyse de ces contributions citoyennes n’a en réalité jamais cessé : depuis plusieurs années, des équipes de recherches se penchent dessus, un peu partout en France.
« Nous devons reprendre l'étude des
cahiers de doléances. » Lors
de son discours de politique générale, le 14 janvier, le Premier ministre
François Bayrou a annoncé vouloir « répondre au cri qu’ont
fait entendre les Gilets jaunes sur nos ronds-points il y six ans », qui a été selon lui « négligé ».
Une annonce qui n’a pas manqué de faire
réagir plusieurs chercheurs et chercheuses, qui n’ont
pas attendu François Bayrou, ni même Michel Barnier avant lui, pour étudier ces
fameux cahiers, lancés d’abord à l’initiative d’élus locaux.
Alors que les « gilets jaunes »
organisaient, en novembre 2018, leur première journée de mobilisation contre la
hausse du prix des carburants, plusieurs mairies mettaient à disposition de
leurs administrés des « cahiers de doléances et de propositions ».
« Avant l’ouverture
du "grand débat national”, les premières initiatives ont émané de l'Association des maires ruraux de France et de l'Association des maires d'Ile-de-France, qui ont ouvert des cahiers
dans le cadre d’opérations “mairie ouverte”. Ces derniers ont été soumis à une analyse,
dont la synthèse a été remise à Emmanuel Macron
par ces associations elles-mêmes, et ce n’est qu’après que le président a intégré cette idée au grand
débat national », recontextualise Manon
Pengam, maîtresse
de conférences en sciences du langage à Cergy Paris Université.
« Souvent, il est dit que les cahiers de doléances sont ceux des gilets jaunes, or ce n’est pas le cas. Les gilets jaunes ont pu en ouvrir eux-mêmes sur des ronds points, mais cela est différent du dispositif institutionnel du grand débat national qui comprenait ces cahiers citoyens et d’expression libre », tient-elle à préciser. Il est en tout cas important, à ses yeux, de « balayer l’idée reçue selon laquelle les cahiers seraient cachés, inaccessibles, que ça a été volontairement enfoui » : « Ce n’est pas vrai et cela blesse par ailleurs beaucoup les archivistes », insiste-t-elle, tandis que l'Association des archivistes français y consacrait justement un communiqué en décembre dernier.
En
réalité, l’étude de ces cahiers, qui comprennent plus de 200 000 contributions
provenant de 17 000 communes, n’a jamais
cessé, et se poursuit encore aujourd’hui un peu
partout en France. Numérisés, transcrits sous l’égide de la Bibliothèque
nationale de France (BNF) et conservés aux Archives nationales dans leur
version numérique, ces cahiers ont été remis aux archives départementales, où
tout un chacun peut les consulter dans leur quasi-intégralité.
Alors qu’une
synthèse du « grand débat » a été réalisée par des opérateurs privés
en 2019, plusieurs universitaires s’y sont
également intéressés à leurs propres frais. Les équipes de Sabine Ploux,
chargée de recherche au CNRS et de Catherine Dominguès, chercheuse au LASTIG
(Laboratoire en sciences et technologies de l'information géographique), ont
réalisé plusieurs travaux sur
la base des fichiers numérisés
conservés
aux Archives nationales, tandis que se sont aussi multipliées les initiatives
départementales.
En Gironde, des
travaux ont débuté dès 2020, à l'initiative de gilets jaunes, de citoyennes et
citoyens, accompagnés de plusieurs universitaires, parmi lesquels Magali Della
Sudda, chercheuse en science politique au CNRS. Marion Bendinelli, maîtresse de
conférences en sciences du langage à l’université
de Franche-Comté, a quant à elle analysé les cahiers du Jura,
tandis qu’une autre équipe a décortiqué ceux
de la Somme, et
Manon Pengam les contributions de la Creuse, où elle réside. «
J’avais évidemment une curiosité
naturelle pour ce que gens du territoire avaient pu écrire à ce moment-là, dans
un contexte national intense », confie la chercheuse.
A l’été 2022, Manon Pengam se rend aux archives départementales de Guéret, où se trouvent à la fois les cahiers du grand débat national et des « mairies ouvertes ». Un total de 300 contributions, à ramener à la densité de l’un des départements les moins peuplés de France. La maîtresse de conférences en sciences du langage commence par prendre en photo ces cahiers, qu’elle numérise, puis qu’elle transcrit en texte brut pour pouvoir mener des analyses statistiques. « Moi je suis linguiste, donc ça ne m'intéresse pas de normaliser le texte. Je souhaite conserver tous les écarts à la norme orthographique, syntaxique, les majuscules, les éléments soulignés ou barrés… Ça suppose de faire attention à tous ces codes, et de les transformer ensuite informatiquement, grâce à un système de codage », détaille-t-elle.
Face à l’ampleur
de la tâche, Manon Pengam a fini par lancer un appel citoyen dans le journal
local La Montagne : « Ça a bien résonné,
une quarantaine de personnes a répondu tout de suite ! »,
raconte-t-elle. Une vingtaine de citoyen·ne·s ont finalement intégré le projet,
après avoir été formé·e·s à la transcription par la linguiste. Comme en
Gironde, l’analyse des cahiers s’est
alors transformée en recherche participative, « ce qui a
pris énormément de sens », aux yeux de Manon Pengam : « Je suis passée d’un travail
très solitaire à une émulation collective, avec des gens du territoire qui pour
certains avaient participé aux Gilets jaunes ».
Au travers d’une
analyse de discours et d’une
analyse linguistique, la maîtresse de conférences en sciences du langage a d’abord identifié les mots récurrents. En Creuse, « On a des résultats qui sont à
la fois peut-être attendus, mais en même temps très éloquents. Par exemple, le
nom commun "retraite" est le plus fréquent du
corpus »,
décrit-elle. Malgré des contributions issues de publics différents, certains
thèmes reviennent régulièrement : l’instauration
d’un référendum d’initiative
citoyenne, le rétablissement de l’Impôt sur
la fortune (ISF), le pouvoir de vivre, la précarité énergétique, l’isolement social, le manque de services de soins… «
La santé est une problématique très importante en Creuse, où l’on
doit souvent faire beaucoup de route pour trouver un médecin. La question des
transports aussi. Il y a deux semaines, une petite ligne de TER qui était pourtant
fréquentée a d’ailleurs fermé »,
met en avant Manon Pengam.
Dans les cahiers creusois se mêlent ainsi des doléances interpersonnelles, qui s’adressent directement à Emmanuel Macron, des témoignages, mais aussi des propositions très concrètes. « Certaines contributions ressemblent beaucoup à des professions de foi, avec des listes à puce, ce qui tord le bras à l’idée que les citoyens ne formuleraient pas de réelles propositions politiques », commente Manon Pengam.
À
lire aussi : Agression
de l’élue de Saint-Denis Oriane Filhol : trois ans de prison ferme pour le
commanditaire
Même
constat à propos de l’analyse du
corpus remonté aux archives nationales, dans lequel « la revalorisation
des retraites et retour de l’ISF ont
été abordés de façon
assez massive », fait remarquer la chargée de recherche
au CNRS Sabine Ploux. Les travaux de son équipe ont également permis d’établir
une classification géographique des contributions : « Il y
a eu des cartes de participation établies en fonction de la population. On voit
que les communes plus rurales ont proportionnellement davantage
contribué que les communes plus importantes ».
Grâce à l’analyse
« textométrique et spatialisée des cahiers citoyens »[1],
réalisée par Catherine Dominguès et Laurence Jolivet, chercheuse en sciences de
l'information géographique, on apprend ainsi que les communes ayant le plus
participé se situent le long d’un axe
nord-ouest, au sud-est et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).
Parmi les contributeurs les plus prolixes : Paris, la Charente-Maritime, le
Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, encore les Bouches-du-Rhône.
Réalisées par des prestataires dans un
temps relativement court, les transcriptions versées aux archives nationales
ont toutefois leurs limites. « Le fait qu’il
y ait beaucoup d’écritures différentes a engendré une
qualité de transcription assez faible »,
détaille Catherine Dominguès. D’où la nécessité de poursuivre l’étude des
cahiers. Et surtout d’y mettre
des moyens, au-delà des effets d’annonce. « Mon travail n’a pas été
financé. J’ai commencé à ouvrir les archives
juste avant d’avoir mon poste à
Cergy. Je venais de finir ma thèse et j’avais un
peu de temps, mais je n’ai pas eu
de moyens alloués au projet », déplore Manon Pengam.
Dans une récente tribune publiée par La Croix, elle regrettait avec d’autres
collègues que les organismes de recherche publique n’aient
« jamais été associés
aux analyses » - la restitution des cahiers ayant été
confiée en 2019 à un consortium de prestataires privés mené par le cabinet
Roland Berger. Elles et ils poursuivaient : « En revanche,
palliant l’absence de financement public, les
conseils départementaux de Gironde, des Landes, de Haute-Vienne et récemment la
région Bretagne se sont engagés à différents niveaux pour financer les
transcriptions, les recherches et la diffusion ».
Alors qu’Emmanuel
Macron s’était engagé à rendre publiques les contributions du « grand
débat national », cette promesse - fil conducteur du récent documentaire Les
Doléances d’Hélène Desplanques
pour France Télévisions - reste en suspens. Un projet de plateforme pourrait
voir le jour, à condition d’y associer
le service public de la recherche et de l’enseignement
supérieur, appuie Manon Pengam : « On ne souhaiterait pas
que ce projet soit pris en charge par des cabinets privés qui ont déjà raflé
2,5 millions d’euros sur le
traitement des données en 2019, alors que pas un centime n’est
allé à la recherche », alerte-t-elle. Avec ses collègues, elle
a fait un petit calcul : « Cette somme représente 75
années de thèse. Ça vous donne un ordre d’idée des
disparités de moyens avec lesquelles on travaille ».
Rozenn Le Carboulec
[1] Catherine Dominguès et Laurence Jolivet. Analyse textométrique et
spatialisée des Cahiers citoyens. In JADT 2024: 17th International Conference
on Statistical Analysis of Textual Data, Bruxelles, Belgique, 2024.
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *