Article précédent
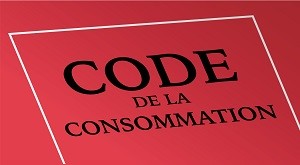

« La cuisine française est la meilleure du monde ! Cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres, lorsque l’humanité plus sage, mettra le service de la broche au-dessus du service de l’épée », écrivait Anatole France en 1914. C’est dire combien en France nous sommes fiers de notre savoir-faire culinaire, au point que la passion pour la bonne chère est quasiment une vertu cardinale. Élément de notre identité nationale, la cuisine française fut au faîte de sa gloire en 2010, lorsque l’UNESCO a décidé de classer le « repas gastronomique des Français » comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Celle-ci a été au coeur des débats lors du colloque « Droit(s) et gastronomie » organisé à la BnF le 17 novembre 2017 par son département Droit, économie, politique, l’Institut de recherche pour un droit attractif (Université Paris 13) et le Centre de recherche juridique Pothier (Université d’Orléans). Les problématiques étaient nombreuses : la gastronomie est-elle un art ? Si oui, mérite-t-elle une protection par le droit de la propriété intellectuelle ? Quels sont les enjeux en matière sanitaire et de consommation ?
Plaisir gastronomique et santé ne sont en effet pas antinomiques. On réfléchit aux conséquences de l’alimentation dans les principales maladies chroniques qui déterminent les enjeux majeurs de santé publique de la société contemporaine. Les consommateurs achètent massivement des produits industriels transformés. Ils cuisinent de moins en moins et leur budget pour les courses s’amenuise. Les repas se déstructurent, les prises alimentaires à toute heure sont banalisées. Ces comportements, particulièrement observées dans les couches sociales les plus défavorisées préoccupent les nutritionnistes. Les médias abordent quotidiennement le sujet de l’impact du régime dans l’hygiène de vie. Cette question inquiètent depuis l’origine de la civilisation. Père fondateur de la médecine, Hippocrate le grand, il y a 2 000 ans, énonçait : « que ton alimentation soit ta première médecine ». ujourd’hui, les politiques nutritionnelles de santé publique ont besoin d’accorder une large part au droit dans leur réflexion.
Quoi qu’il en soit, s’il est vrai qu’« Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » (Socrate), en ces périodes de fêtes, nous pensons également, à l’instar d’Henri IV, que « Bonne cuisine et bon vin, c’est le paradis sur terre ».
C2M et Maria-Angélica Bailly
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *