Article précédent
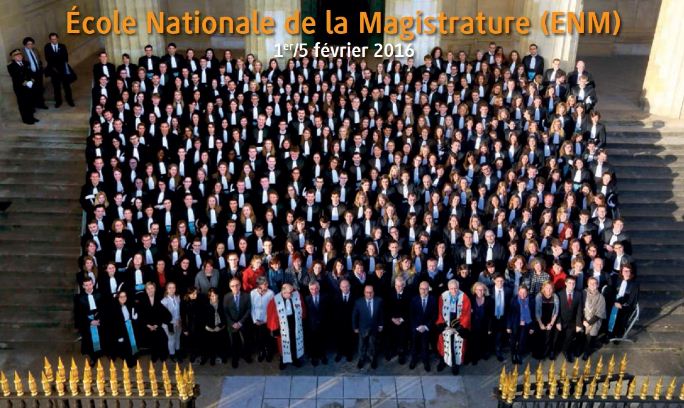

Journal Spécial des Sociétés : Pouvez-vous nous présenter l’ENM ?
Xavier Ronsin : L’ENM (Ecole nationale de la magistrature) a été fondée en 1958 sous le nom de « Centre national d’études judiciaires ». L’ENM recrute et forme les auditeurs de Justice afin d’assurer le recrutement des futurs Magistrats. C’est une école d’application où nous apprenons aux auditeurs de Justice un savoir-faire et un savoir-être. Comment présider une audience, prendre une décision, quels sont les gestes professionnels… Mais aussi comment se comporter avec les justiciables ou avec les avocats. L’Ecole prépare à des métiers, forme de manière continue, à des spécialisations mais aussi des reconversions. Nous formons les Juges consulaires, les délégués du Procureur, les conciliateurs de Justice, mais aussi les Magistrats étrangers. Nous sommes aussi chargés de former, en formation initiale, les conseillers prudhommaux qui seront élus en 2018 dans le cadre de la loi Macron.
JSS : Comment s’y passe le recrutement ?
X.R. : Le recrutement se fait sur concours. Les candidats sont étudiants ou professionnels en reconversions. Lors du recrutement, nous vérifions le niveau juridique des candidats.
Plusieurs voies d’accès existent : ce peut être sur concours, ou sur dossier. Cela dépend de la durée de la formation. La plus longue et la plus complète dure 31 mois et est ouverte aux étudiants des facultés de droit ou d’IEP (Instituts d’études politique) ainsi qu’aux fonctionnaires qui vont passer un concours spécialisé, et enfin à des personnes qui ont une expérience de vie dans le privé équivalente à huit ans. Pour postuler, les étudiants doivent être titulaire d’un Master 1, et les fonctionnaires justifier d’une expérience de vie dans le privé de huit ans.
A cela, s’ajoutent les recrutements que l’on nomme « article 18-1 » de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Ce sont des professionnels qui justifient non seulement d’une maitrise en Droit mais aussi de quatre années d’expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique ou social. Ces candidats déposent une candidature au tribunal de leur ressort et suivent une série d’entretiens pour être admis sur titre.
Il y a aussi une troisième voie d’admission. Il s’agit là de recruter directement dans la magistrature. On fait alors référence aux candidats « article 22 ». En 2016, ils seront 33 dans ce cas.
JSS : Quels sont les profils que vous recherchez ? Y a-t-il un type de candidat particulier ?
X.R. : Nous cherchons évidemment les meilleurs profils en termes de compétences juridique. Magistrat est un métier qui doit attirer les plus brillants. C’est pour cela que le concours est très sélectif et la commission de recrutement très exigeante.
Nous n’avons pas de profil type car nous cherchons des candidats sur l’ensemble des territoires de la République. On recherche des juristes qui ne soient pas exclusivement issus de la région parisienne et des beaux quartiers.
Parmi les parcours en reconversion, 22% sont d’anciens avocats, 26% viennent d’autres professions judiciaires (d’anciens greffiers par exemple) et 52% sont des juristes issus du secteur privé ou public qui exerçaient des fonctions administratives. En ce qui concerne les étudiants, on fait en sorte qu’ils viennent de toutes les facultés de droit. Pour cela, nous misons beaucoup sur les classes prépa « égalité des chances ». Trois classes sont actuellement financées et comportent chacune 18 élèves. En tout, ce sont 54 élèves qui ont été choisi sur critères sociaux et méritocratique. On les prépare non seulement au concours mais on leur donne aussi une bourse afin qu’ils n’aient pas à travailler en parallèle. En somme, nous appliquons une politique proactive et volontariste pour faire en sorte qu’une diversité de candidats se présente à nous.
JSS : Quelles qualités doit avoir un futur Magistrat ?
X.R. : Nous avons « intellectualisé » 13 compétences fondamentales du Magistrat : être capable d’identifier et de mettre en œuvre les règles déontologiques qui s’appliquent ; être capable de synthétiser ou d’analyser un dossier ; identifier un cadre procédurale et le respecter ; savoir s’adapter à toute situation ; savoir adopter aussi bien une position d’autorité que d’humilité en fonction des circonstances ; savoir gérer la relation, l’écoute et l’échange ; savoir préparer et conduire une audience ou un entretien judiciaire dans le respect du contradictoire ; être en capacité de susciter des accords ou de concilier des parties ; savoir prendre des décisions fondées en droit et en fait inscrites dans un contexte et empruntes de bon sens mais surtout exécutables ; savoir motiver, formaliser et expliquer sa décision ; savoir prendre en compte l’environnement institutionnel national et international de la décision de justice ; travailler en équipe et enfin savoir organiser, gérer et innover.
A l’école, nous cherchons des juristes passionnés de Droit mais pas exclusivement. Nous nous attachons aussi à sélectionner de « belles personnalités ». Le métier de Magistrat est un métier de décision, d’écoute et d’analyse. Il faut donc pour cela que les candidats soient tournés vers l’action, la décision, qu’ils aient une volonté certaine de rendre la justice, d’apaiser ou de dénouer un conflit.
JSS : Quelles carrières offre la magistrature ?
X.R. : La magistrature offre une diversité de carrières. L’immense majorité des élèves deviendra Juge généraliste ou spécialisé, Juge d’instance, Juge d’application des peines ou substitut du Procureur. Bien sûr, tout le monde commence par un poste « de base », qui impliquera tout de même de grandes responsabilités. Le classement de sortie permet de hiérarchiser ses choix. Il définira le poste que l’on va occuper en première affectation. Toutefois ce poste ne définit pas la carrière. La carrière dépend ensuite, non seulement du désir de la personne d’évoluer ou non vers plus de responsabilités, mais aussi de ses compétences. Un juge nommé dans un tribunal est indépendant. S’il ne présente aucune demande de mutation, il pourrait rester dans son tribunal toute sa vie. Ces cas-là sont rares, mais c’est possible.
JSS : Vous êtes vous-même Magistrat, quel regard portez-vous sur la profession ?
X.R. : Par rapport à ma génération, la formation a gagné en professionnalisme. Avant, nous étions plus centrés sur un partage d’expérience avec les enseignants.
En 30 ans, le droit s’est extrêmement complexifié. Un auditeur de Justice qui sortait de l’ENM avait plus de facilité à maitriser les contentieux que maintenant. Au bout de cinq ans, il était déjà capable d’aborder tous les contentieux sans difficulté. Aujourd’hui, le droit est beaucoup trop complexe pour cela. Progressivement, cela entraine un phénomène de spécialisation et même d’hyper spécialisation. Aujourd’hui, pour changer de fonction, on a besoin d’une formation (que l’Ecole dispense par ailleurs). Le droit était donc plus simple, et les règles applicables étaient moins complexes.
Ensuite bien sûr, la profession a connu une massification extrêmement importante des contentieux et cela dans tous les domaines. La gestion de tout ce flux et l’obligation parallèle de maintenir un haut standard de décisions judiciaires est beaucoup plus prégnant aujourd’hui que dans le passé.
Aussi, le regard exigeant de la société sur le fonctionnement de la Justice est allé croissant. Auparavant, le procureur n’était pas, ou moins en tous cas, soumis à l’obligation sociale d’expliquer pourquoi il avait pris telle ou telle décision.
JSS : De nombreux syndicats dénoncent le manque de Magistrats. Quelle est votre opinion sur la question au regard du contexte actuel très tendu ?
X.R. : Les causes des tensions actuelles sont polyphoniques.
Nous faisons face à une situation très paradoxale. Depuis mai 2012, nous n’avons jamais autant recruté de Magistrats ni obtenu autant de budgets de renforcement de la justice. Le problème qui se pose est particulier. Le « gros bataillon » d’élèves étant formé sur deux années et demie, les premiers effets commencent seulement à se voir. Depuis cette année, nous avons accueilli la plus grosse promotion de l’histoire de l’Ecole. 366 auditeurs de Justice ont fait leur rentrée à l’Ecole. Il y a donc une tension importante entre les départs à la retraite et le renouvellement.
Mais il y a aussi une explication ailleurs. Depuis les lois et l’application d’une jurisprudence de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), de nouveaux champs de compétences ont été confiés aux juges qui ont considérablement alourdis leur charge de travail. Par exemple, l’hospitalisation sous contrainte a nécessité que le juge les confirme. Ce qui n’était pas le cas auparavant. Il faut aussi composer avec l’engorgement des chambres sociales d’appel.
Xavier Ronsin est Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) depuis le 17 février 2012. Issu de la promotion 1980 de l’ENM, il a successivement été Juge d’instruction à Lorient de 1982 à 1988, premier Juge d’instruction à Chartres de 1989 à 1990, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Roanne de 1991 à 1994, Substitut général à Angers de 1994 à 2002, Avocat général à Rennes de 2004 à 2008, en charge notamment de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) en matière de criminalité organisée et de délinquance économique et financière, puis Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes de 2008 à 2012.
Il exerce également les fonctions de Chef de service, Adjoint au Directeur de l’administration pénitentiaire de 2002 à 2004. Membre en 2001, puis en 2007, des comités d’orientation de la loi pénitentiaire mis en place auprès du garde des Sceaux, il devient en 2003 Expert auprès du Conseil de l’Europe et à ce titre membre du comité pénologique. Il est l’un des rédacteurs des Règles pénitentiaires européennes, adoptées en janvier 2006 par le Comité des Ministres de la Justice des 47 pays du Conseil de l’Europe.
Il confirme cet engagement européen en représentant la France au sein du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants, et en participant à diverses missions d’inspection des lieux de privations de liberté à l’étranger. En 2009, il devient membre de la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH).
Propos recueillis par Marie-Stéphanie Servos mercredi 3 février 2016
Retrouvez la suite de l'interview de Xavier Ronsin et notre entretien avec Sandrine Papy reçue major du 3ème concours d’accès à l’ENM, celui réservé aux salariés du secteur privé, dans le numéro 13 du Journal Spécial des Sociétts du 17 février 2016
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *