Article précédent
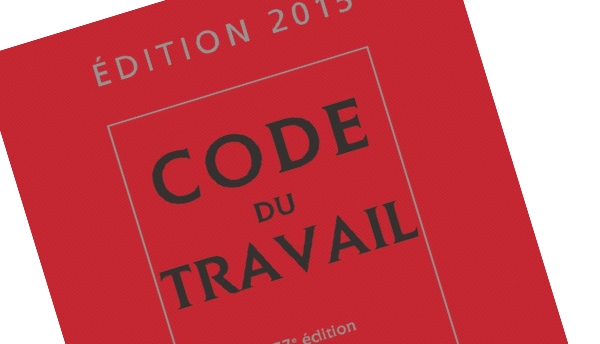
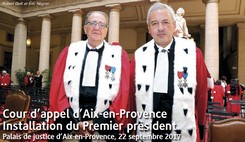
Vendredi 22 septembre, Éric Négron a été solennellement installé dans les fonctions de Premier président de la cour d’appel d’Aix, capitale des comtes de Provence. Il succède à ce poste, à Chantal Bussière, appelée à rejoindre le Conseil supérieur de la magistrature. Luc Fontaine, Premier président de chambre a chaleureusement salué l’action de la Première présidente honoraire. Il a ensuite retracé le parcours professionnel du nouvel arrivant avant d’aborder l’histoire de la ville et le quotidien du tribunal.
Robert Gelli, procureur général, a souligné les volumes importants traités par Aix, « cour au deuxième rang des cours françaises derrière Paris ». Il a annoncé sa foi dans les atouts de la région et de ses institutions. Le procureur général voit une dyarchie qui va « jouer à deux voix la partition des chefs de cour dans l’harmonie et la confiance ». Éric Négron a longuement remercié avant de préciser ses intentions. Il remarque pour les juridictions méditerranéennes plusieurs distinctions propres au territoire : une démographie en expansion, une affluence estivale de population colossale, des litiges particuliers issus des activités maritimes et touristiques, un taux de contentieux plus lourd qu’ailleurs et une moyenne d’âge élevée chez les opérationnels travaillant dans les tribunaux. Fort de ces constatations, le Premier président adresse une invitation aux cours voisines : « Je souhaite travailler avec mes collègues de Montpellier et de Nîmes pour porter auprès des décideurs parisiens des dossiers qui nous sont spécifiques… ».
Le Premier président de la cour d’appel d’Aix s’est également exprimé sur le financement de la justice du XXIe siècle, sur la position que le justiciable devrait y occuper et sur le développement de la communication. Puis, il a défini le profil d’un Premier président : c’est un responsable qui « doit s’assurer que les juridictions de son ressort disposent des moyens de fonctionnement… » ; c’est le garant de l’indépendance et de l’impartialité des juges ; et c’est, enfin, le référent déontologique.
C2M
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *