Article précédent
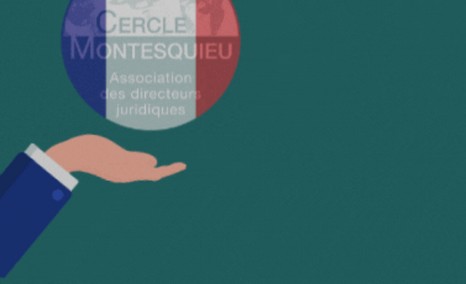

À l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, l’association Femmes de justice
a organisé son assemblée générale en partenariat avec Acteurs Publics sur le
thème des femmes et du pouvoir. Lors de la seconde table ronde dédiée
à la place des femmes dans les hauts lieux du pouvoir, la sénatrice Laurence
Rossignol et la colonelle Karine Lejeune, lesquelles évoluent toutes deux dans
des sphères qui ont longtemps été l’apanage des hommes, sont revenues sur leur
expérience au sein de ces univers.
« Le président de la République est un homme,
le Premier ministre est un homme, le président de l’Assemblée nationale est un
homme, le président du Sénat est un homme » liste Laurence Rossignol lors
du colloque organisé par l’association Femmes de justice, en partenariat avec
Acteurs Publics, le vendredi 11 mars, au tribunal judiciaire de Paris. Laurence
Rossignol, actuellement sénatrice et vice-présidente du Sénat, présidente de
l’Assemblée des femmes depuis 2019, a été ministre de la Famille, de l’Enfance
et des droits des femmes dans les gouvernements de Manuel Valls II et de
Bernard Cazeneuve. La sénatrice est également membre de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances, mais aussi secrétaire nationale chargée
des droits des femmes et de la parité au sein du Parti Socialiste.
Elle
regrette par ailleurs que lorsqu’il s’agit de prendre des décisions lourdes et
sérieuses, de nouveaux lieux de pouvoir informel se forment, comme le Conseil
de défense et de sécurité nationale, où la majeure partie des membres sont des
hommes… à l’exception de Florence Parly, la ministre des Armées.
Même constat de prépondérance masculine à la gendarmerie, bien que, désormais, le pourcentage de femmes ait franchi le palier des 20 % (contre moins
de 7 % il y a 25 ans) et continue d’augmenter. Malgré tout, dans le corps
des officiers et sur les postes à responsabilité, seulement 8 % des postes sont occupés par des femmes, constate Karine
Lejeune. « Pour faire un général, il faut
20 ans. Au départ, on n’avait pas le vivier, car il n’y avait pas suffisamment
de femmes, mais cela fait 35 ans maintenant, on devrait commencer à avoir
constitué ce vivier » déplore-t-elle. La colonelle
précise que l’augmentation du nombre de femmes n’est pas due à la civilisation
de certaines fonctions : il y a bien de
plus en plus de femmes dans toutes les unités. En effet, 18 % du total des femmes ont un statut militaire.
Karine
Lejeune représente la 4e génération
de sa famille à être entrée dans la gendarmerie. Elle a été commandante du
groupement de la gendarmerie de l’Essonne et a également dirigé la section de
prévention de la délinquance à la direction générale de la gendarmerie. La
colonelle a aussi été la première porte-parole de la gendarmerie nationale.
Actuellement, elle est auditrice au centre des hautes études militaires et à
l’Institut des hautes études de défense nationale.
L’arrivée
des femmes dans les hautes fonctions est un long processus
L’accès des femmes aux sphères du pouvoir « n’est pas un mouvement spontané, mais une conquête » constate Nathalie Ancel, vice-présidente de l’association Femmes de justice, magistrate, procureure de la République adjointe près le tribunal judiciaire de Créteil et modératrice de cette table ronde ; car le pouvoir s’est développé dans tous ses aspects sans les femmes.
En 1987, Isabelle Guion de Méritens
est la première Saint-Cyrienne à rejoindre la gendarmerie. Elle devient alors
la première femme à obtenir le rang d’officier de gendarmerie, puis le rang de
colonelle en 2006, et enfin d’officier général de gendarmerie en 2013, rapporte
Karine Lejeune. Une féminisation bien tardive.
Hormis les parcours de
« premières », les lois ont également aidé. Suffisamment ? Pour
Laurence Rossignol, le bilan est mitigé. La sénatrice ne doute pas du bien fait
apporté
par la loi du 8 juin 1999, mais estime que les limites commencent à être
atteintes. À
la fin du XXe siècle, plusieurs façons de parvenir à l’égalité étaient possibles, comme les quotas, mais la parité
était le seul moyen « d’imposer par la loi une plus juste représentation des
femmes »,
explique la sénatrice. Cette dernière raconte qu’elle entend régulièrement des
hommes lui dire :
« Heureusement qu’on a voté la loi sur la parité, ça nous
protège de vous ! »
Selon Laurence Rossignol, la parité a
ouvert certaines fonctions, mais pas les portes du pouvoir. Le patriarcat a
remonté les lieux de pouvoirs un peu plus haut ; conséquence, les femmes sont
toujours exclues.
Imposer son regard de femme
Laurence Rossignol propose de renverser notre vision des
choses. Pour elle, il est indispensable que des femmes pratiquent les
politiques publiques différemment, afin de les concevoir et de les exercer
autrement. La sénatrice insiste sur l’importance de ces éléments, car tant que
l’on ne fait pas ça, le système se reproduit par lui-même. « D’ailleurs, qu’est-ce qui justifie que les sujets sociaux soient perçus
comme mineurs ? » se questionne la sénatrice.
Ce sont pourtant des sujets qui touchent au quotidien des citoyens. De l’avis
de Laurence Rossignol, la parité, ce n’est pas vouloir conquérir les finances
ou la voirie, mais faire comprendre que les sujets sociaux sont aussi
importants : « ne pas
laisser aux hommes déterminer ce qui est important ou pas. Ce que nous faisons
et ce que nous aimons est noble ; s’occuper des
gens, c’est noble. »
Karine Lejeune revient sur son expérience comme première
porte-parole de la gendarmerie : «
Forcément, j’étais porte-parole parce que j’étais une femme : c’est bien
d’envoyer des femmes sur les plateaux, et puis cela remplit les quotas pour le
conseil supérieur de l’audiovisuel. », ironise-t-elle. D’ailleurs, en 2018,
c’est à nouveau une femme nommée à ce poste : Maddy Scheurer.
Karine Lejeune s’arrête sur le choix de l’intitulé de la
table ronde : « l’arrivée des femmes dans
la sphère masculine », pour désigner ce qui est habituellement appelé « des femmes dans des métiers d’homme ».
La colonelle rétorque généralement face à cela qu’elle ne
fait « pas un métier d’homme, mais un métier
d’autorité, de protection et de sécurité », et insiste
sur le fait que « c’est tout à fait
différent ».
Karine Lejeune partage les trois recettes qu’elle
applique lorsque les femmes sont en minorité. Le premier conseil est de rester
soi-même : « j’ai toujours refusé de me
masculiniser, ce que certaines pionnières se sont senties obligées de faire
pour survivre ». La deuxième chose est de ne rien laisser passer face « aux
petits propos sexistes, aux “petites” blagues ». Son troisième conseil est de
trouver des alliés, que ce soit chez les femmes, mais aussi chez les hommes : « Un certain nombre d’hommes sont prêts à
prendre position pour nous et à monter au créneau, mais pour cela, il faut
qu’on ait réagi au préalable. Ils le feront seulement s’ils sentent qu’on a
besoin d’avoir ce soutien. »
Tina Millet
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *