Article précédent

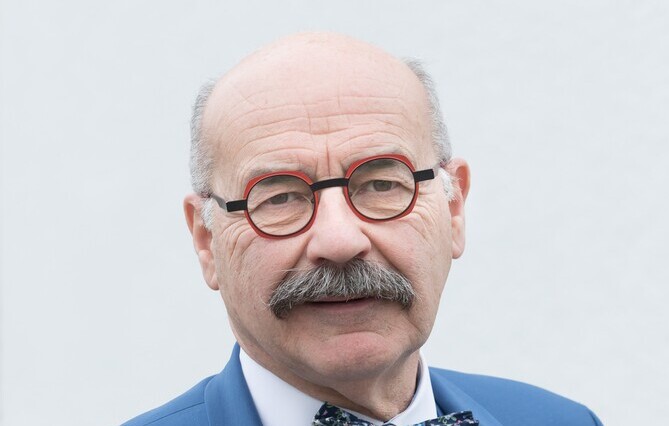
Après un bref intérim, conséquence
de la démission de Sonia Arrouas en décembre dernier, Michel Peslier a
officiellement pris la tête de la CGJCF jeudi 23 février, suite au vote du
conseil d’administration qui a déterminé l’intégralité de son nouveau bureau.
Du changement à la tête de la
Conférence générale des juges consulaires de France (CGJCF) ! Réuni le 23
février dernier, le conseil d’administration a élu à sa tête Michel Peslier,
président du tribunal de Laval depuis 2020.
Originaire de Mayenne, Michel
Peslier est juge consulaire depuis 2011. Parallèlement, il occupe le poste de directeur
général Audit et Affaires juridiques dans le groupe agro-alimentaire Lactalis, et
pilote ainsi une vingtaine d’auditeurs et 131 juristes répartis sur les cinq
continents.
Il remplace donc l’ancienne
présidente Sonia Arrouas, élue en janvier 2021 avant
de démissionner en décembre 2022 alors qu’elle était mise en cause pour un
manque d’impartialité. « Elle va ainsi pouvoir assurer sa défense en
toute indépendance », précise un communiqué.
À lire aussi : Congrès national des
tribunaux de commerce : quelles avancées pour les juges consulaires ?
Les vice-présidences ont
également été remaniées : Chantal Lenoir, présidente du TC de Compiègne,
et Xavier Aubry, président du TC de Versailles, seconderont Michel Peslier.
Laurent Granel et Claude Gasser restent respectivement secrétaire général et
trésorier, et complètent ainsi le bureau qui devrait garder cette composition
jusqu’en 2026.
La nouvelle équipe souhaite
en premier lieu « restaurer la confiance avec les pouvoirs publics et
les partenaires afin d’accompagner les propositions du
garde des Sceaux pour la justice commerciale ».
D’autres chantiers sont également évoqués, comme une meilleure efficacité et
une plus grande rapidité dans les décisions, une aide pour le recrutement des
juges, la transition vers un « tribunal de commerce digital »
et la préservation d’une justice de proximité.
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *