Article précédent

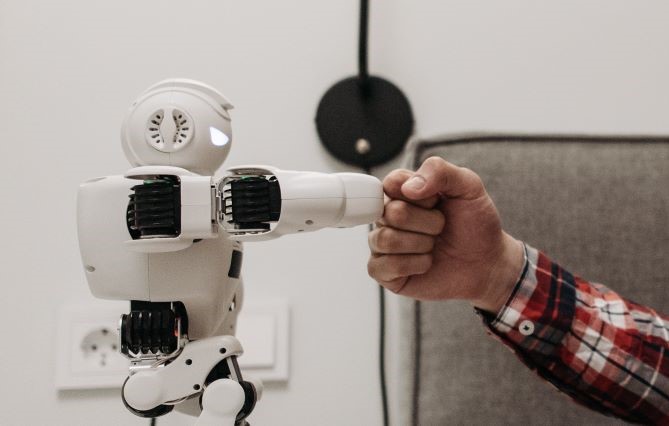
Le monde moderne se robotise, la réflexion
humaine laisse place aux ordinateurs, de quoi inquiéter de nombreuses
professions, dont celles du droit. L’AFED et L’IERDJ se sont réunis à Nice
mercredi 18 octobre pour le débat « Structures de marchés et modèles
d’affaires dans le monde du droit : entre adaptations et transformations face
aux enjeux numériques », qui évoquait ces craintes et l’avenir du
domaine.
Croiser le regard de juristes et d’économistes,
tel était le but de la conférence organisée, le mercredi 18 octobre à Nice, par
l’Association française d’économie du droit (AFED) et l’Institut des études et
de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ). Il s’agissait de mettre sur
la table une crainte partagée, celle de la place de l’intelligence artificielle
(IA) dans le marché du droit. L’entreprise Goldman Sachs a annoncé dans son
étude de 2023 que 44% des obligations des professionnels du droit pourraient
être réalisées par de l’IA générative. Cette intelligence n’est plus cantonnée
à l’accomplissement d’automatismes. Les utilisateurs font maintenant appel à sa
créativité. À son opposé, l’IA analytique applique uniquement des recettes
conçues par l’humain. Les données du droit sont déjà depuis 1966 dans des
bases, en France. Et depuis 1998, la plateforme Légifrance regroupe tous les
textes de lois françaises.
Un marché du droit, pas seulement des
professions, « j’ai du mal à imaginer qu’il existe », s’étonne
Aurore Hyde, professeure de droit privé à l’université de Reims Champagne-Ardenne
et présente à la conférence. Pour elle, le droit reste un service public. Qu’un
client paye son avocat, c’est logique. Mais pour les données, c’est moins
évident. Pourtant aujourd’hui, elles font partie du marché du droit,
commercialisées par abonnement auprès d’éditeurs, et, peut-être prochainement,
par des services d’IA générative. Denis Berthault, directeur du développement
chez LexisNexis, affirme que « ça coûte cher de vendre du droit ».
Il estime le marché à 1,5 milliard d’euros avec 130 000 praticiens en France.
Les plateformes d’intelligence juridique actuelles les plus avancées permettent
de vérifier les textes ou encore d’accéder à certaines jurisprudences.
De son point de vue, s’il s’agit de vendre le
droit via l’IA générative, cela sera onéreux. Car cette technologie demande des
serveurs et une gestion constante, deux impératifs chers. Sans maintenance
évolutive des machines ni mise à jour, une plateforme peut vite devenir
obsolète. Aurore Hyde en a fait l’expérience : « J’ai demandé à LegiGPT
[un ChatGPT spécialisé dans la loi, ndlr], mis à jour en avril 2022, un texte
mis en vigueur en novembre 2022, il m’a dit qu’il était encore en cours de
validation ». Finalement, sans un entretien permanent, le système perd
en fiabilité. La recherche dans un livre juridique dont la date d’édition est
connue – encore faut-il que le lecteur y fasse attention – ne pose pas ce
problème.
« On imagine que le droit quotidien
pourrait changer la donne des cabinets d’avocats », suggère Bruno
Deffains, professeur en sciences économiques à l’Université Paris-Panthéon-Assas.
Il souligne l’« émergence d’un nouveau type d’arbitrage » par
l’IA générative avec un mix des compétences Homme/IA. Pourtant, cette vision
semble peu « satisfaisante », à part si « on imagine
un gain de productivité ». C’est-à-dire mobiliser les serveurs sur des
tâches chronophages jusqu’à « éventuellement anticiper la demande des
prochains clients », pour gagner du temps et le consacrer aux
obligations à « valeurs ajoutées ». Frédéric Marty, économiste
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), complète cette
hypothèse en évoquant deux avenirs. Un dans « un monde immatériel où il
s’agirait de concilier variété et prévisibilité par l’IA », ou un
autre dans « un monde industriel avec une capacité à prédire et une
économie d’échelle ».
Les enjeux de l’entreprise de droit questionnent,
vers quel fonctionnement ce marché se dirige-t-il ? Bruno Deffains affirme que
« la crise du Covid a fait gagner quelque temps mais que tout va aller
très vite maintenant ». Il se demande si les acteurs juridiques vont
contribuer à l’innovation ou vont être passifs. Denis Berthault différencie les
besoins des différents professionnels du droit : « Je pense que
les magistrats ont besoin de solutions jurisprudentielles de qualité, la
meilleure jurisprudence sur le sujet, alors que l’avocat veut avoir tout pour
trouver la solution qui défendra le mieux son client. » Pour Aurore
Hyde, un point reste essentiel : le contact humain. Malgré toutes les
suppositions technologiques, le droit reste un service et non un bien, « il
y a une part de l’Homme qui est irréductible » .
Certaines professions du droit ne pourraient pas
être remplacées par de l’intelligence artificielle générative ou analytique
« parce que les clients ont besoin des interactions humaines ».
La professeure en droit privé met en avant ce point en répondant à l’économiste
sur le droit de la famille. « Les clients ont besoin d’être compris,
aidés et soutenus par leur avocat », explique-t-elle. Elle
ajoute : « Que les cabinets obtiennent raison par un livre ou par
une intelligence artificielle, les clients s’en moquent. »
Si l’idée d’acheter de l’IA générative juridique
est admise, il faut la réguler, et donc la contrôler. Frédéric Marty commente
ce point crucial, où la régulation de l’algorithme, des professions du droit,
mais aussi des marchés, est à étudier. Un algorithme doit faire des mises à
jour. Elles sont indispensables si l’on veut que l’intelligence artificielle
exécute un compte rendu juridique valable. Mais la confiance envers cette
dernière reste fragile. Aurore Hyde témoigne qu’elle a posé l’énoncé « mon
salarié m’a insulté » à LegiGPT. L’algorithme a énoncé exhaustivement
tous les textes de lois, « mais à aucun moment il n’a demandé le
contexte », dit-elle. Or, suivant les circonstances, les sanctions ne
sont pas les mêmes. Il faudrait donc que l’IA soit aussi pointilleuse que
l’humain ne l’est en cherchant une réponse avec un livre juridique.
L’autonomie du professionnel interroge également.
Frédéric Marty avance un potentiel « service à la carte »
venant d’une IA personnalisée pour réguler la concurrence. Si tous les avocats
utilisent la même intelligence, il n’y a plus de personnalisation pour le
client. En réalité, ce dernier consulte un robot par le biais d’un humain. La
professeure de l’université Reims Champagne-Ardenne Aurore Hyde adhère à cette
idée : « Déjà entre juristes hautement qualifiés, on n’est pas
d’accord sur la bonne jurisprudence, par exemple sur le droit des contrats. »
Tessa
Biscarrat
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *