Article précédent

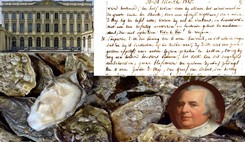
|
|
L’huître, un sujet de fable. Le castelthéodoricien Jean de la Fontaine l’opposa, tandis qu’elle bâillait sous un doux zéphyr, à un rongeur qu’elle piégea dans « L’huître et le rat », puis, dans « L’huître et les Plaideurs », la fit avaler par un juge improbe départageant malicieusement deux plaideurs qui se la disputaient.
L’huître, indispensable sur une table royale, dont l’absence due à un retard d’acheminement des bourriches à Chantilly amena le maître-queux François Vatel, affolé à l’idée de ne pouvoir l’ouvrir à temps pour la cour et les invités du Prince de Condé, à s’ouvrir la poitrine d’un coup d’épée pour se suicider dans le château cantilien.
L’huître, un délice vital pour un monarque au physique de gros
mollusque.
Qu’en rien la gourmandise n’offusque. Un chef d’État débonnaire, sexagénaire, à
l’appétit extraordinaire, considéré par certains comme le souverain du retour
en arrière. Frère d’un roi décapité que le manque d’huîtres rend dépité. Louis
XVIII, né Louis-Stanislas, comte de Provence, exilé outre-Quiévrain, puis roi
de France pour un règne serein, décrit par Victor Hugo dans « Les
Misérables » : « Ce roi impotent avait le goût du grand
galop ». C’est bien au galop qu’en Flandre, pendant les Cent-Jours, ce
roi de France mange des huîtres à gogo. Le savoureux produit de l’ostréiculture
d’Ostende pour atténuer la contrariété de la villégiature flamande. Car,
momentanément chassé en 1815 par
l’Empereur s’échappant de l’Ile d’Elbe, il trouve asile à Gand. Et l’exil lui
va comme un gant, dans cette cité du nord située au confluent de la Lys et de
l’Escaut… tant qu’il y trouve des huîtres !
Louis s’installe au centre de Gand le 30 mars 1815 à 17 heures chez le comte Jean-Baptiste d’Hane de Steenhuyse. Rembruni d’avoir perdu ses pantoufles qui avaient pris la forme de ses pieds…car elles ont été dérobées pendant le voyage ! Le comte, chambellan du roi des Pays-Bas, marié à la comtesse Isabelle Rodriguez d’Evora y Vega, est le gouverneur de la Flandre orientale. Louis a déjà séjourné dans le passé dans le bel hôtel particulier de son ami Jean-Baptiste qui offre régulièrement l’hospitalité à des souverains d’Europe. La demeure (qui se visite toujours) est imposante avec sa splendide façade du 18e, ses boudoirs et cabinets, sa salle de bal, ses somptueux papiers-peints, ses plaques de cheminée armoriées, ses fresques. Louis s’y sent bien. Il est veuf. Son épouse, Marie-Joséphine de Savoie, fille du roi de Sardaigne, est décédée en 1810.
Le jour de son arrivée chez le comte, il dîne à 18 heures et avale un copieux repas. Il se fait ensuite servir « un cent d’huîtres », provoquant l’admiration des badauds qui s’agglutinent, car la salle à manger, située au rez-de-chaussée, est visible de la rue. L’anecdote est relatée dans un document conservé en Belgique. La bibliothèque universitaire de Gand possède en effet une chronique manuscrite d’une centaine de pages, publiée en 1831, rédigée en 1815 par un journaliste qui, rendant compte de la présence de Louis XVIII et de sa cour à Gand, évoque notamment la gourmandise du monarque. On y trouve, à la date du 30 mars 1815, la phrase « Hij Z.M. van zeer gœden appetijt, naer andere spijzen geheeten te hebben, slœg hij nog een honderd hœsters binnen » que l’on peut traduire par « Sa Majesté avait bon appétit, car après avoir mangé quelques plats, il se tapait (sic) une centaine d’huîtres ». On voit qu’en néerlandais du 19e siècle, « huître » s’écrit « Hoester » avec un « h » alors que l’actuel vocable s’écrit « Oester », proche de l’anglais « Oyster » et de l’allemand « Auster ».
Rapidement,
les Belges surnomment le souverain français « Louis des huîtres ».
Ce surnom sera parfois déformé en « Louis dix huîtres ». Dans
certains textes anglais, le roi est nommé « Oyster Louis ».
Revenu en France, Louis continue à faire le bonheur et la fortune de la filière conchylicole et à avaler sans compter les mangeuses de plancton. Il est vrai qu’après la disparition de la gabelle en 1790, l’ostréiculture s’est développée en France, certains marais salants étant transformés en claires, ces bassins de bord de côte séparés par des abotteaux.
Le roi finit podagre et gangréneux, diabétique et handicapé, se
déplaçant en fauteuil roulant ou avec des béquilles, se décomposant
littéralement avant son décès en 1824.
Une partie de la population surnomme alors ce disciple d’Épicure au ventre
rebondi
« Cochon XVIII ». Mais les mareyeurs, qu’ils soient
royalistes, ultras ou modérés, bonapartistes, républicains ou neutres, ne
peuvent que pleurer la disparition de celui qui, pour les producteurs
d’huîtres, était incontestablement une perle.
Étienne Madranges,
Avocat à la cour,
Magistrat honoraire
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *