Article précédent
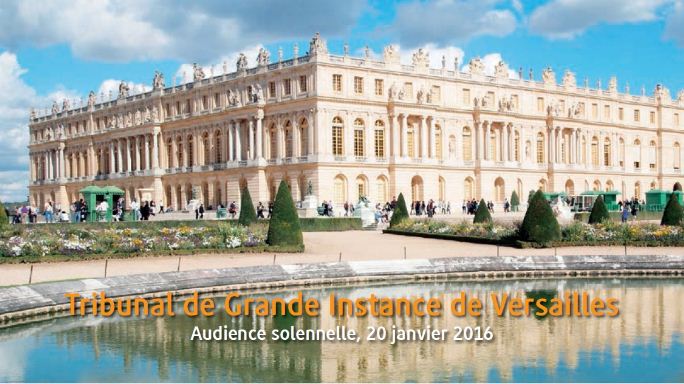

Jacques Toubon, Défenseur des droits, a présenté à la presse le 4 février 2016 son rapport annuel d’activité 2015. Bilan d’une année qui a vu les réclamations augmenter de manière inquiétante et poindre les effets négatifs de deux mois d’état d’urgence.
Des réclamations en hausse
Le Défenseur des droits a dressé un état des lieux inquiétant. En effet, par rapport à 2014, l’institution a enregistré une hausse de 8,3% des réclamations, soit un total de 79 592 demandes. Par rapport à 2010, dernière année avant la fusion des quatre institutions (la HALDE, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la CNDS), c’est une augmentation de 14% qui a été relevé par l’institution.
Responsabilité alourdie de l’Etat à l’égard des citoyens
Les attentats perpétrés en France en janvier et novembre 2015 et la mise en place de l’état d’urgence dès le 13 novembre 2015 ont « alourdis la responsabilité de l’Etat à l’égard des citoyens ». Selon Jacques Toubon, il devra « assurer un équilibre scrupuleux entre l’exigence de sécurité et la garantie des libertés et droits fondamentaux ».
Depuis le 26 novembre 2015, le Défenseur a reçu 42 réclamations relatives à des mesures prises au titre de l’état d’urgence, principalement liées à des perquisitions (18 saisines) et des assignations à résidence (11 saisines).
Le Défenseur des droits a aussi affirmé conforter ses positions quant à la déchéance de nationalité. Selon lui, la loi que le Gouvernement souhaite inscrire dans la Constitution « remet en cause le principe d’indivisibilité de la République ».
Durcissement du droit
Le rapport précise que « ce qui apparait des annonces relatives à la présentation prochaine d’un texte pénal laisse à penser que le droit commun va être singulièrement durci ». Le 23 décembre 2015, l’institution soulignait déjà qu’il « semble qu’un glissement s’opère vers un régime d’état permanent de crise caractérisé par une restriction durable de l’exercice des droits et des libertés ». Mais « l’exception ne doit pas devenir la règle », le régime exceptionnel de l’état d’urgence n’a pas vocation à perdurer.
En ce sens, le Défenseur des droits appelle à un « débat national, du peuple », auquel il prendra part. Les citoyens doivent se prononcer sur leur volonté de « réduire ou non le niveau d’exigence de notre état de droit » a-t-il précisé.
Une priorité : l’accès aux droits
Toutefois, si l’année a été marqué par ces thématiques, 2015 était surtout placée sous le signe d’un « engagement résolu en faveur de l’accès aux droits » que Jacques Toubon n’a pas manqué de rappeler. Car, et c’est ce que ce dernier déplore vigoureusement, il existe un « fossé » entre une situation discriminante et la démarche auprès du Défenseur des droits.
En 2015, le Défenseur des droits s’est réorganisé dans l’objectif de donner une place centrale à la promotion de l’égalité, à la lutte contre les discriminations et à l’accès aux droits.
Regards critiques et préconisations sur les dispositifs d’accès aux droits
L'accès aux droits est souvent entravé par les nombreuses difficultés que les usagers rencontrent lors du traitement de leurs demandes par les services publics ou les organismes qui assurent la gestion des droits sociaux.
A travers les réclamations qui lui sont adressées, le Défenseur des droits observe une certaine dégradation de la qualité du service rendu aux usagers. Cette situation résulte des défaillances des administrations mais aussi de la complexité des dispositifs et des procédures, voire de la conception même des dispositifs. Les raisons sont multiples : réduction des dépenses publiques, nouveaux modes de gestion axés sur la maîtrise des coûts et la productivité, afflux massif de certaines demandes induites par les évolutions législatives…
On peut citer le nombre important de réclamations relevant des situations où les personnes éligibles ne bénéficient pas de leurs droits de manière temporaire en raison d'un retard de traitement d'une prestation dû à un blocage, une absence de réponse, une décision erronée, ou une demande indue de justificatifs. La non effectivité des droits résulte dans ces cas des problèmes administratifs.
Les nouveaux modes de gestion peuvent également s'ériger en obstacle à l'accès aux droits. C'est le cas des politiques de lutte contre la fraude qui, appliquées avec trop de zèle, conduisent parfois à écarter des ayants droits légitimes.
La complexité des démarches et la multiplication des étapes que le parcours d'une demande implique (pièces justificatives à fournir plusieurs fois, rendez-vous multiples, déplacements entre organismes, silence des administrations, rejet des recours malgré les arguments avancés, etc.) sont source de découragement, voire de renoncement à l'ouverture d'un droit. Dans ces cas, l'intervention des délégués permet à la personne d'être accompagnée pour accéder à ses droits.
Favoriser l’accès aux droits sur l’ensemble du territoire
La réduction des inégalités territoriales en matière d'accès aux droits fondamentaux et aux services publics représente un enjeu majeur pour l'Institution.
La déclinaison de la politique de promotion de l'égalité et de l'accès aux droits à l'échelle des territoires prend appui sur le réseau des délégués répartis dans l'ensemble des départements français, sur un nouveau partenariat avec le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) et ainsi que sur une collaboration avec les collectivités territoriales.
La convention de partenariat avec le CGET, signée le 17 novembre 2015 (annexe 7), définit les objectifs partagés dans les champs de la promotion de la lutte contre les discriminations et de l'accès aux droits et aux services publics en faveur des territoires relevant de la politique de la ville et de la politique de revitalisation des zones rurales et périurbaines.
La collaboration s'articule autour de trois grands axes : la complémentarité d'intervention des réseaux ; la complémentarité et la réciprocité de leurs expertises en matière de sensibilisation, de formation et d'ingénierie de projet ; l'observation et la production de connaissances sur les inégalités territoriales, les phénomènes discriminatoires et les conditions d'accès aux droits des publics en situation de vulnérabilité. (...)
|
Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante, inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire du 29 mars 2011. Cette institution regroupe les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ainsi que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Le Défenseur des droits est institué comme l’autorité unique pour la défense des droits. Il s’attache à rendre la protection des droits et des libertés plus cohérente, plus lisible, plus accessible et plus simple pour tous les citoyens. |
Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n°19 du 9 mars 2016
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *