Article précédent

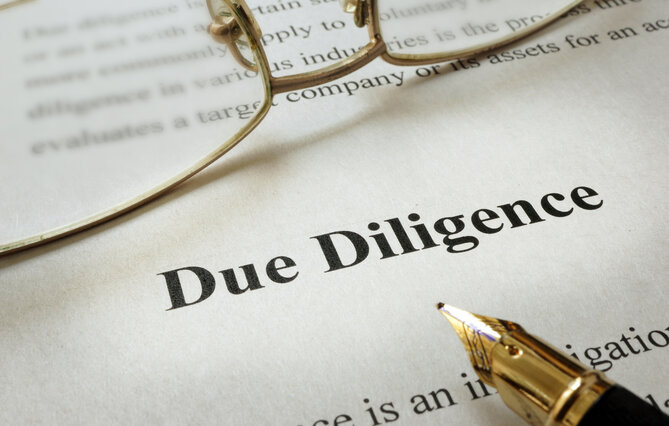
La directive Corporate
Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), par l’ampleur de ses exigences,
par son champ d’application ou encore par sa force contraignante, révolutionne
le paysage juridique de la due diligence, tant sur le sol européen que pour
l’ensemble des ordres juridiques.
Pour autant, plus qu’une
première pierre juridique à l’édifice de la responsabilité sociétale des
entreprises, cette directive prend appui sur une pluralité de règles
internationales de droit souple (soft law) et de règlementations européennes
qui, ensemble, laissaient d’ores et déjà entrevoir les contours d’une
obligation de vigilance aux impacts de leurs activités sur l’humain et
l’environnement pour certains types d’entreprises.
Cette directive, dont le nom
anglais renvoie donc explicitement à la due diligence, doit ainsi être
considérée comme la clé de voûte d’un édifice dont elle vient parachever la
construction.
Une première réception de la due
diligence en droit souple
Initialement, la notion de due
diligence était réservée à la prévention des risques matériels ou financiers
propres à l’entreprise.
C’est lors des travaux de
recherche autour de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qu’est
née l’idée de créer un ensemble de règles et de processus que les entreprises
sont invitées à intégrer dans leur organisation afin d’identifier, prévenir et
remédier aux incidences négatives pour les droits de l’homme qui peuvent
découler tant de leurs propres activités, portant le nom de due diligence,
voire de sustainability due diligence.
Initiée en 1953 par l’ouvrage
du professeur Howard Bowen Social Responsibilities of the Businessman, il
résulte de la doctrine autour de la RSE que les entreprises ont l’obligation
morale d’agir d’une manière bénéfique pour la société, et pas seulement pour
leurs actionnaires. Howard Bowen définit ainsi la RSE comme « l’obligation
pour les hommes d’affaires de poursuivre les politiques qui sont souhaitables
en termes d’objectifs et de valeurs de notre société ». De cette
obligation morale, va être conceptualisée l’obligation juridique de due
diligence.
Ainsi, dans un premier temps,
la due diligence environnementale et sociale a été reçue en droit souple. Deux
références centrales peuvent être citées : la Déclaration de l’OCDE sur
l’investissement international et les entreprises multinationales de 1976 et
ses Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales, ainsi que les Principes directeurs du Conseil des droits de
l’homme des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme adoptés
en 2011.
Concernant la première, il
peut être souligné que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales viennent d’être mis à jour, en 2023.
Parmi les principes, on
retrouve en particulier l’incitation à « exercer le devoir de diligence
fondé sur les risques, par exemple en l’intégrant dans leurs systèmes de
gestion des risques, afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les impacts
négatifs, réels ou potentiels, et rendre compte de la manière dont elles
répondent à de tels impacts » (principe 11). Il est ensuite renvoyé au
Guide OCDE du devoir de diligence pour une conduite responsable des
entreprises. En recommandant les trois étapes classiques « Identification
et évaluation des impacts négatifs », « Prévention et faire cesser
les impacts » et « Réparation des impacts », ce guide ressemble
à s’y méprendre aux obligations énoncées par la CS3D.
Les Principes directeurs du
Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur les entreprises et les
droits de l’homme de 2011 prévoient de manière encore plus concrète, au
principe 17, une injonction pour les entreprises de faire preuve de diligence raisonnable
en matière de droits de l’homme « afin d’identifier leurs incidences sur
les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et
rendre compte de la manière dont elles y remédient. […] Ce processus devrait
consister à évaluer les incidences effectives et potentielles sur les droits de
l’homme, à regrouper les constatations et à leur donner une suite, à suivre les
mesures prises et à faire savoir comment il est remédié à ces incidences ».
Ces soft laws dessinent une
obligation de due diligence des entreprises à l’égard des droits de l’homme et
de l’environnement. Toutefois, par nature, elles ne peuvent être que
d’application volontaire. Aussi, si ces éléments de droit souple ont permis
« d’appréhender les phénomènes émergents qui se multiplient dans le monde
contemporain » comme l’indiquait justement Jean-Marc Sauvé lors du fameux
rapport du Conseil d’État de 2013 sur le droit souple, une protection efficace
nécessitait l’intervention de véhicules juridiques contraignants.
L’intégration d’obligations
de due diligence dans certaines législations européennes
L’émergence de nouvelles
obligations au titre de due diligence, au sein de législations européennes
particulières et sur des thèmes spécifiques comme le climat, génère une
nouvelle gouvernance au sein des entreprises, créant, de facto, de nouvelles
obligations et donc de nouveaux régimes de responsabilités.
L’affaire Royal Dutch Shell
des Pays-Bas en est une parfaite illustration.
Pour les requérants, associations et ONG, ainsi que 17 000 citoyens,
l’entreprise avait l’obligation de prendre des mesures afin d’atténuer le
changement climatique, notamment sur le fondement des Accords de Paris. Si
l’entreprise croyait pouvoir se défendre en affirmant qu’aucune règle ne lui
imposait de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le tribunal(1) en a
décidé autrement. C’est ainsi que le tribunal de La Haye a retenu l’engagement
de la responsabilité civile de la société Shell, au titre de son devoir de
vigilance, lui ordonnant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de
45 % d’ici 2030.
Des accords internationaux
engagent donc les États mais également les entreprises. Se fondant sur une
décision précédemment rendue (Urgenda c./ Pays-Bas : injonction décidée
par le tribunal à l’encontre de l’État membre, de respecter ses engagements en
matière climatique), le tribunal a affirmé que les conséquences du changement
climatique constituent un risque de violation des droits de l’homme. Partant,
le tribunal dégage une obligation, pour les entreprises, de respecter les
droits de l’homme dans leurs activités et dans leur mise en œuvre.
Dans un tout autre domaine,
outre la directive Corporate Sustainability Repoting Directive, dite CSRD, qui
imposera aux plus grandes entreprises et aux PME cotées de publier des
informations quant à l’impact de leurs activités sur les droits de l’homme et
l’environnement – détaillée dans un article dédié de ce numéro –, plusieurs
législations de l’Union européenne établissent d’ores et déjà une obligation de
due diligence à l’égard des entreprises de certains secteurs.
C’est tout d’abord le cas du
Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE)(2). Outil essentiel de l’Union
européenne pour lutter contre le commerce du bois illégal, entré en vigueur en
2013, ce règlement interdit la fourniture sur le marché européen de bois
récoltés en violation de la législation applicable dans le pays de récolte,
ainsi que des produits dérivés de ce bois.
Or, afin de garantir cette
interdiction, le règlement impose aux entreprises qui importent ou récoltent du
bois ou des produits dérivés du bois à des fins commerciales de mettre en place
un « Système de Diligence Raisonnée » lors de la mise sur le marché
européen de bois ou de produits dérivés.
En septembre dernier, deux
entreprises françaises (l’entreprise familiale Pierre Robert et le leader
français ISB) ont ainsi été condamnées pour avoir manqué à leur obligation de
diligence raisonnée. Il leur était reproché l’importation de bois coupé illégalement
au Brésil.
Ce même Système de Diligence
Raisonnée a été repris dans le Règlement européen contre la déforestation et la
dégradation des forêts, adopté en mai 2023(3). Cette législation interdit
désormais la mise sur le marché ou l’exportation depuis le marché européen de
produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts et
concerne plus précisément sept produits, le café, cacao, caoutchouc, huile de
palme, soja, bœuf et bois, ainsi que leurs produits dérivés comme le cuir, le
charbon de bois, ou encore le papier imprimé.
L’obligation de diligence des
entreprises se retrouve également dans le secteur minier. En effet, un premier
règlement du 17 mai 2017 relatif aux minerais originaires de zones de conflit(4) fixe des obligations de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement
pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du
tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut
risque.
Plus récemment, en réaction à
l’essor d’une nouvelle mobilité électrique, l’Union européenne a adopté en
juillet 2023 un règlement relatif aux batteries électriques(5).
Elément central de cette législation, les entreprises qui mettent des batteries
sur le marché ou les mettent en service doivent se conformer aux obligations
liées au devoir de diligence, lesquelles impliquent en particulier de prévenir
des risques sociaux et environnementaux.
Antérieurement à la
publication d’une proposition de directive portant son nom, la notion de sustainability
due diligence était donc déjà amplement présente en soft law internationale et,
depuis les années 2000, au sein de certaines législations de l’Union
européenne. Toutefois, son application n’était que sectorielle, dans les
domaines d’activités à très forts risques sociaux et environnementaux.
Cette directive CS3D vient
donc parachever et harmoniser un cadre juridique composé d’obligations de due
diligence hétéroclites. Dorénavant, en plus d’étendre son champ d’application à
l’ensemble des domaines d’activité économique, la notion de due diligence
pourra donc s’appliquer de manière plus homogène, renforçant ainsi son
efficacité.
Madeleine Babès,
avocate à la Cour,
Huglo Lepage Avocats
Sylvain Hamanaka,
avocat à la Cour,
Huglo Lepage Avocats
1) Tribunal
de La Haye, Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell, 26 mai 2021,
C/09/571932 / HA ZA 19-379.
2)
Règlement (UE) n°995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui
mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
3)
Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023
relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à
partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la
déforestation et à la dégradation des forêts.
4)
Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017
fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne
d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain,
du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de
conflit ou à haut risque.
5)
Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023
relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive
2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *