Article précédent

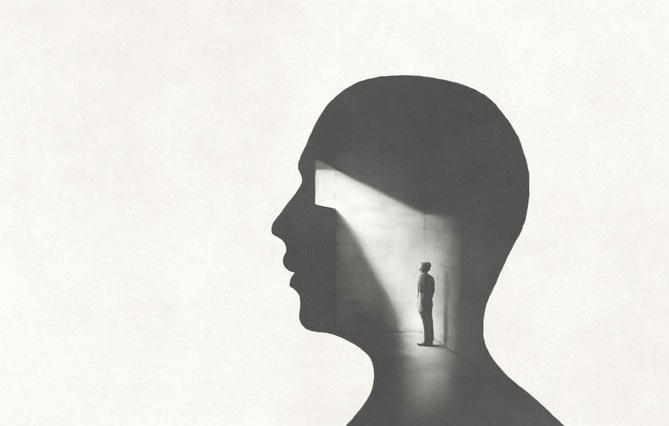
Un rapport d’information parlementaire rendu public le 10 juillet alerte sur une « aggravation alarmante » de la santé mentale des personnes placées sous main de justice. Les députées Josiane Corneloup (Les Républicains) et Elise Leboucher (La France insoumise) y formulent 100 préconisations pour sortir de cette impasse.
« On assiste à un
déplacement de l’hôpital psychiatrique vers la prison », observait
déjà le Comité consultatif national d'éthique en 2006.
Près de 20 ans plus tard, ce
constat est toujours d’actualité, si l’on en croit un rapport d’information parlementaire sur
l’évaluation de la prise en charge des troubles psychiques des personnes
placées sous main de justice, rendu public le 10 juillet.
Des
chiffres alarmants loin d’être nouveaux
Alertant sur une « surreprésentation
des troubles à tous les stades de la détention », cette mission
copilotée par Josiane Corneloup (Les Républicains) et Elise Leboucher (La
France insoumise) rappelle quelques chiffres alarmants. A l’entrée en prison,
les troubles psychiatriques sont trois fois plus représentés qu’en population générale,
et jusqu’à huit fois pour les addictions. A la sortie, deux tiers des hommes et
trois quarts des femmes présentent un trouble psychiatrique ou addictif.
La prévalence des idées et
conduites suicidaires y est également très prégnante : le taux de suicide est
10 fois plus élevé pour les hommes et 40 fois plus élevé pour les femmes en
prison qu’en population générale. En 2024, 141 suicides ont ainsi été déplorés
en détention (soit un suicide tous les deux jours et demi) - un chiffre en
augmentation d’environ 37 % depuis 2017.
Ces données criantes sont
loin d’être nouvelles : « Au total, huit hommes détenus sur dix présentent
au moins un trouble psychiatrique, la grande majorité en cumulant plusieurs
parmi lesquels la dépression (40%), l’anxiété généralisée (33%) ou la névrose
traumatique (20%). », détaille l’Observatoire international des prisons sur son site, qui fait état de pathologies
psychiatriques « 20 fois plus élevés » en milieu fermé.
« Nous avons été
confrontées à une absence de données chiffrées sur les différents types de
situations, donc à une difficulté à les réévaluer », commente la
députée Elise Leboucher auprès du JSS. « L’un des gros sujets, c’est
la gouvernance et le pilotage : on est face à deux ministères, la Santé et la
Justice, qui doivent travailler ensemble, mais qui ont du mal à parler la même
langue ». A une exception près : « Sauf localement, où il y a parfois
une vraie cohésion et un partage d’information, mais cela est très dépendant
des personnes sur place. », ajoute-t-elle.
Une
prise en charge inégale sur le territoire
A l’échelle locale justement,
« on a de plus en plus de détenus complètement désœuvrés »,
constate Mathieu Lacambre, qui a travaillé 20 ans en prison et est aujourd’hui
responsable de l’unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) du CHU de
Montpellier, laquelle accueille des détenus en hospitalisation.
« La composante addicto
est aussi très importante. Cela favorise l’exclusion, la souffrance, et ensuite
c’est un engrenage », observe-t-il. Dans son service, les détenus
occupent en moyenne un tiers des places : 5-6 sont hospitalisés en psychiatrie
sur 15 lits. A Villeneuve-lès-Maguelone, qui compte un centre pénitentiaire et
une maison d’arrêt, il y a, selon Mathieu Lacambre, 20 % d’épisodes dépressifs
majeurs associés à des idées suicidaires, environ 90 % d’addiction au tabac, 70
% au cannabis et 60 % à l’alcool.
Unité de recours pour les « décompensations
graves », l’USIP de l’hôpital de la Colombière du CHU de Montpellier est
souvent sollicitée face à la saturation des autres services prenant en charge
des détenus, par ailleurs répartis inégalement sur le territoire.
À
lire aussi : Face aux détenus
souffrant de troubles psy, les surveillants pénitentiaires aux abois
« En cas d’hospitalisation
la personne sera hospitalisée de préférence à l’unité hospitalière spécialement
aménagée (UHSA) de Toulouse mais les délais peuvent être d’une semaine pour une
admission en SDRE (Soins psychiatriques sur décision d'un représentant de
l'Etat, ndlr), voire de trois semaines pour une hospitalisation avec le
consentement du patient », décrivait en 2015 un rapport de visite du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté (CGLPL) au Centre pénitentiaire de
Villeneuve-lès-Maguelone.
« Au moment du contrôle,
au moins quinze patients nécessitent des soins psychiatriques en dehors de
l’établissement : cinq patients sont à l’UHSA et deux en attente d’une prise en
charge ; deux patients sont suivis par le SMPR (Service médico-psychologique
régional , ndlr) et quatre en attente ; deux patients sont hospitalisés en
psychiatrie au CHU », détaillait le CGLPL. Un SMPR situé à Perpignan, à
plus de 150 kilomètres, tandis qu’une UHSA est en projet à Béziers, plus près
de Montpellier.
Une
situation aggravée par la surpopulation carcérale
Le contexte, national comme
local, de surpopulation carcérale n'arrange pas la prise en charge en prison. «
On essaie de développer l'offre de soins mais ça reste compliqué face à
l’augmentation exponentielle du nombre de détenus », déplore Mathieu
Lacambre.
« Depuis 1994, on a
paramétré des mètres carrés d’unités de soins et nombre de soignants en
fonction de la population pénale accueillie, mais ce chiffre correspond au
nombre de places en prison. Or il y a un delta énorme entre ce dernier et le
nombre de personnes en détention. Par exemple à Villeneuve on a 590 places,
mais on est à plus de 1000 détenus », met en avant le professionnel de
santé. Sauf que pendant ce temps-là, « les moyens humains n’augmentent pas ».
Résultat : « On est toujours en décalage. », constate-t-il, alors
que son service peine à recruter des psychiatres.
« On est clairement
confronté·e·s au croisement de services en grande difficulté », pointe
la députée LFI Elise Leboucher. « La psychiatrie qui en grande crise, la
justice qui ne réussit plus aujourd’hui à répondre à ses missions, et la
pénitentiaire avec une multiplication des lois sécuritaires et la surpopulation
carcérale, qui favorise elle aussi une détérioration de la santé mentale ».
« Des conditions de détention dégradées deviennent dégradantes. Tout ça nous
amène à la situation qu’on connaît aujourd’hui, qui est explosive pour les
premiers concernés, mais aussi tous les professionnels », résume la
co-rapporteuse du rapport d’information parlementaire.
Des
préconisations en détention, mais surtout en amont
Pour sortir de cette impasse,
cette mission transpartisane formule 100 préconisations pour une meilleure
prise en charge en détention, le développement d’une politique de réduction des
risques, la prévention du suicide, l’accompagnement à la sortie, le décloisonnement
de la gouvernance, l’évaluation des initiatives locales en milieu ouvert, ou
encore la priorisation des mineurs.
Dans le détail, il est
notamment proposé de corréler les effectifs de personnels pénitentiaires/de
surveillants aux taux d’occupation réels des établissements pénitentiaires, de
développer les activités en détention (auxquelles les femmes, beaucoup plus exposées
au risque de suicide en prison, ont pourtant moins accès), de garantir la mise
en œuvre systématique d’une évaluation psychiatrique et addictologique dans
tous les établissements, sécuriser la couverture sociale des sortants de
prison, ou encore faire du renforcement de l’accompagnement des enfants
relevant de l’aide sociale à l’enfance une priorité absolue de l’action
publique.
Alertant sur une « véritable
pénalisation de la santé mentale », le rapport appelle surtout à
« prioriser l’amont, ce qui implique de mieux repérer les troubles dès
l’enfance, notamment à l’école, de mieux accompagner les enfants relevant de
l’aide sociale à l’enfance, laquelle apparaît aujourd’hui comme le maillon le
plus défaillant de l’action publique, alors même qu’elle devrait concentrer
tous [les] efforts ».
« Au-delà des
préconisations généralistes sur les moyens en psychiatrie et en détention, une
des premières est la question de la régulation carcérale, qui consiste surtout
en un gros travail en amont : que fait-on pour que personne n’entre dans un
cycle de délinquance ? », décrypte Elise Leboucher.
Reste à savoir si les
ministères concernés vont se saisir de ce rapport. « On a sollicité la
Commission des lois et des affaires sociales ainsi que la délégation aux droits
des femmes et aux droits des enfants pour le présenter. On espère un débat à la
rentrée. Je ne vois pas comment les ministères ne peuvent pas se saisir du sujet »,
tranche la députée LFI.
Rozenn
Le Carboulec
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *