Article précédent

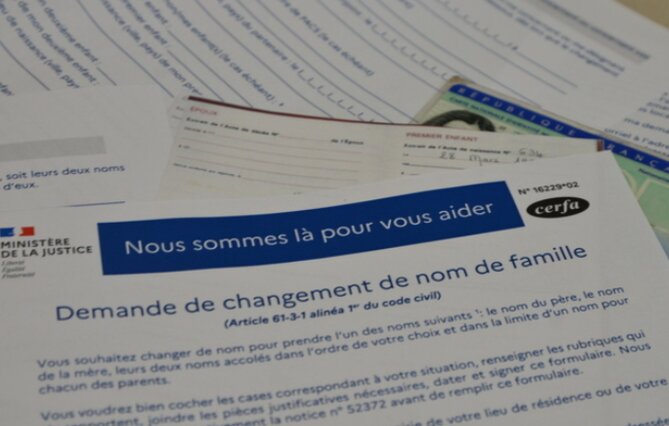
Alors que le nombre de
Français entreprenant cette démarche a été multiplié par près de 17 en un an,
démontrant son franc succès, la professeure Sophie Prétot remarque que l’« on
n’hérite plus de son état, on en est acteur », et qu’il y a désormais un
détachement vis-à-vis du nom de famille.
Le nom, ainsi que le prénom,
sont des éléments d’identification qui constituent l’état des personnes. L’état
civil est ce qui atteste de l’ensemble des éléments de l’état des personnes.
Changer son nom consiste donc à modifier son état civil. À la différence du
surnom, notre nom et notre prénom, permettent de nous identifier
officiellement.
L’occasion a été donnée de
s’interroger sur le droit au changement de nom, et plus largement de l’état
civil, lors d’une conférence au Pavillon Lecoq, à Clermont-Ferrand, organisée
par le Café des juristes (association du barreau clermontois), en collaboration
avec le Centre de recherche universitaire Michel de l’Hospital. Animé par
Aurélie Prades, avocate, et Sophie Prétot, professeure de droit privé à
l’Université Clermont-Auvergne, l’évènement, intitulé « Nom, prénom, un
choix sans limite ? Réflexion sur l’évolution de l’état civil », a
rassemblé une cinquantaine de participants, dont des professionnels du droit et
des étudiants.
Les deux intervenantes ont
commencé par évoquer l’indisponibilité de l’état des personnes. Selon ce
principe, le prénom et le nom ne peuvent être modifiés qu’à titre exceptionnel,
et cette modification doit être motivée par un intérêt légitime.
De 4 000 demandes à presque
70 000
« Chaque Français
pourra choisir son nom de famille une fois dans sa vie » annonçait le
Garde des sceaux Éric Dupond-Moretti lors d’une entrevue avec le magazine Elle
publiée le 19 décembre 2021. Choisir son nom de famille est-il pour autant un
droit absolu ? Qu’en est-il aujourd’hui de cet engagement du ministre de
la Justice ?
Avant la réforme, c’était
systématiquement au juge aux affaires familiales de statuer sur une demande de
changement de nom – procédure qui pouvait d’ores et déjà constituer un premier
obstacle. Par ailleurs, la demande devait être obligatoirement justifiée auprès
du ministre de la Justice. Désormais, ces difficultés sont révolues.
Depuis la loi Vignal du 2 mars
2022, entrée en vigueur le 1er juillet de la même année, le
changement de son nom par un majeur ne relève en effet plus de la compétence du
juge aux affaires familiales, mais de l’officier d’état civil de son lieu de
résidence ou de naissance. Le nouveau nom de famille s’étend alors
automatiquement aux enfants du bénéficiaire, mais les mineurs de plus de 13 ans
ont aussi droit au chapitre dans ce cadre, puisque la loi requiert leur
consentement.
« C’est une grande
révolution », selon Aurélie Prades, à en juger par le nombre de
demandes, avant, et après ladite réforme. Alors qu’ils étaient en moyenne 4 000
à entreprendre la démarche avant que la loi du 2 mars 2022 ne soit publiée, ils
ont été 70 000 en 2023 selon les statistiques du ministère, mises à jour le 6
juillet dernier.
La déjudiciarisation du
changement de nom, qui fait suite à celle du prénom (en vertu de la loi du 18 novembre
2016) garantit-elle une acceptation automatique de ce choix par l’administration ?
Un participant de la conférence s’interroge sur le rejet de la demande par l’officier
d’état civil. Quelles sont les voies de recours contre une telle
décision ? Ce refus peut faire l’objet d’un examen par le juge aux
affaires familiales, explique l’avocate, qui motivera sa décision par l’intérêt
légitime d’une telle mutation de l’état civil. Ce critère de légitimité était
déjà un motif de jugement sous l’empire de la législation antérieure. Le plus
grand changement de la loi Vignal est que le juge n’est plus saisi
automatiquement, mais de façon exceptionnelle.
Une révolution amorcée par la
justice européenne
L’indisponibilité de l’état
des personnes est une limite consacrée par la Cour de cassation en 1991,
réaffirmée en 2011, écartant dans les deux affaires la possibilité d’une
reconnaissance de filiation issue d’une gestation pour autrui. Qu’est-ce qui a
finalement permis une évolution du régime juridique après deux décennies de
droit constant ? Parmi les demandeurs au pourvoi en cassation de l’arrêt de
2011, certains ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.
Entre l’arrêt de 2011 et la
décision de la Cour européenne, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le
droit des parents d’attribuer le prénom « Titeuf » à leur enfant. Par
une décision du 15 février 2012, les juges suprêmes ont rendu un arrêt allant
dans le sens de la cour d’appel qui considérait comme contraire à l’intérêt
supérieur de l’enfant le choix d’un tel prénom.
C’est précisément sur ce
fondement que les juges européens ont condamné la France en 2014 suite à l’arrêt
contesté de 2011. Se fondant sur cette décision, la Cour de cassation n’a pu qu’opérer
en 2015 un revirement de sa jurisprudence en obligeant l’État à inscrire la
filiation des enfants concernés. La plus haute juridiction française a donc
fini par faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur le principe de l’indisponibilité
de l’état des personnes.
« On n’hérite plus de
son état, on en est acteur »
Ce principe d’indisponibilité
a donc été mis à mal par l’évolution du droit au changement de son nom, selon
Sophie Prétot. « On n’hérite plus de son état, on en est acteur »,
conclut-elle. Le nom est un héritage qui désigne la famille. Il y a maintenant
un détachement du nom de la famille. Un enfant de 13 ans ou plus peut demander
un nom de famille différent de celui de ses frères et sœurs, et même ne choisir
que le nom de l’un de ses deux parents si l’un des deux change de sexe.
La loi du 1er juillet
2022 a également supprimé la dévolution automatique du nom du père en premier
pour l’enfant. Le mineur de plus de 13 ans peut aussi changer son nom en
accolant en second celui de son père. Ce changement de cadre résulte de l’évolution
récente du droit civil en faveur de l’égalité des genres que l’on a connu,
notamment avec le délaissement du « patronyme », devenu
« nom de famille ».
C’est aussi la reconnaissance
des personnes transgenres et de leurs changements d’état qui a amorcé cette
révolution. La loi de 2015 avait supprimé l’opération chirurgicale comme
condition du changement de sexe pour modifier son état civil. L’intérêt
légitime n’était donc plus autant à démontrer pour les personnes transsexuelles
devant les juges que l’apparence suffisait désormais à convaincre d’un genre
plutôt que l’autre.
Cette évolution découle de la
subordination du droit français au droit européen, ainsi que d’une volonté
politique d’inclusion sociale. Ce droit n’est pas sans limites puisque si on
peut changer plus facilement son nom et son prénom, on ne peut le faire qu’une
seule fois. Parallèlement au droit français, le droit italien, historiquement
influencé par le Code civil français, a aussi évolué en ce sens. Désormais, le
nom du père n’est plus automatiquement donné à l’enfant. Le 28 avril 2022, la
Cour constitutionnelle italienne a considéré illégitime le fait d’attribuer le
patronyme d’office. Cette réforme démontre que l’intérêt de l’enfant porté par
le droit supranational s’impose aux droits nationaux. La simplification du
droit à changer son nom sera-t-elle, par analogie, étendue à tous les États membres
du Conseil de l’Europe ?
L.R.
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *