Article précédent

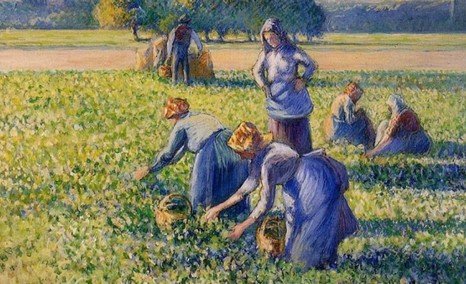
Les biens culturels, qui
comprennent au sens large tous les biens ayant une dimension historique,
artistique ou archéologique, bénéficient en principe de la libre circulation
des biens. Toutefois, certains d’entre eux sont soumis à des interdictions ou
restrictions spécifiques, créant une certaine complexité pour les acteurs du
marché de l’art. Nous tâcherons ici de donner un bref aperçu de leur cadre
juridique en signalant les principales évolutions et actualités de l’année
2021.
Certains biens culturels ne sont pas autorisés à circuler en
raison d’une cause d’illicéité, d’autres parce qu’ils font l’objet d’une
protection patrimoniale particulière.
Les biens illicites
Il faut en premier lieu rappeler que certains biens
intrinsèquement illicites peuvent être appréhendés à tout moment à la demande
des ayants droit ou des autorités, à l’instar des contrefaçons et faux
artistiques. Par ailleurs, certains biens culturels issus d’espèces protégées
font l’objet d’une interdiction de commercialisation dans l’Union européenne,
comme les objets contenant de l’ivoire d’éléphants abattus après l’entrée en
vigueur de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
D’autres biens culturels ne sont pas admis à circuler en
raison de leur provenance illicite. Il s’agit en premier lieu des biens
culturels déplacés en violation de la Convention de l’Unesco de 1970 pour la
lutte contre le trafic illicite des biens culturels ou du règlement européen n° 2019/880, dont
l’article 3 énonce une interdiction absolue d’importer des biens sortis
illicitement de leur pays d’origine. Cela concerne notamment les antiquités
provenant de pillages, qui constituent une source de revenus pour diverses
organisations terroristes et criminelles et font à ce titre l’objet d’un
contrôle accru. À titre
d’exemple, en décembre 2021, le collectionneur américain Michael Steinhardt a
dû restituer 180 oeuvres d’art et antiquités provenant de sources illicites,
dans le cadre d’un accord transactionnel avec le parquet de New York.
S’agissant des spoliations perpétrées sous l’Occupation,
l’ordonnance du 21 avril 1945 prévoit la nullité des actes de spoliation et de
tous les transferts de propriété subséquents. L’article 1.5.1 du recueil des
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires impose en
conséquence de retirer de la vente tout objet susceptible de provenir d’une
spoliation. Les possesseurs de telles œuvres, irréfragablement présumés de
mauvaise foi, ne disposent pas d’un titre de propriété valable. Par conséquent,
toute mise en circulation de l’œuvre peut se heurter à une procédure judiciaire
visant à sa restitution, comme cela s’était produit dans
l’affaire de la « Cueillette des pois » de Pissarro1.
Toutefois, dans une affaire plus récente qui concernait un autre tableau du
même artiste, l’héritière de la famille spoliée s’est heurtée à de nombreux
obstacles et s’est finalement désistée de ses demandes contre l’université
d’Oklahoma, qui lui opposait un protocole soumis à la loi et à la compétence
des tribunaux des États-Unis2.
Les trésors nationaux
Certains biens ne sont pas admis à
circuler sur le marché, non pas parce qu’ils seraient illicites, mais parce
qu’ils font partie du patrimoine français. Il s’agit des trésors nationaux, que
l’article L. 111-1 du Code du patrimoine définit comme l’ensemble formé par
cinq catégories assez différentes.
La première catégorie est composée de
biens privés faisant l’objet d’un contrôle de la puissance publique : les
biens classés au titre des monuments historiques. Les enjeux de cette
qualification ont été illustrés par la récente affaire du « Baiser » de Brancusi
(voir p.7), opposant l’État aux
propriétaires de la tombe de Tatiana Rachewskaïa au cimetière du
Montparnasse dont la stèle supporte un
exemplaire de la célèbre
sculpture. Dans sa décision du 2 juillet
2021, le Conseil d’État a validé le classement en monument historique du groupe
sculpté de Brancusi au motif qu’il
formait, avec la tombe, un ensemble constituant un immeuble par nature et présentant un intérêt public3. Il s’agit donc d’un trésor national que
les propriétaires ne peuvent ni déposer ni aliéner.
Trois autres catégories se composent
de biens appartenant déjà au domaine public mobilier : les collections des
musées de France, une partie des archives publiques et les autres biens faisant
partie du domaine public mobilier. Tous ces objets sont inaliénables et
imprescriptibles en application de l’article L. 3111-1 du Code général de la
propriété des personnes publiques, et ne peuvent en principe changer de
propriétaire qu’à l’issue d’une procédure de déclassement.
De récentes modifications laissent
entrevoir un début d’assouplissement des conditions de déclassement. Depuis la
suppression, en décembre 2020, de la Commission scientifique nationale des
collections, la décision de déclassement d’un bien appartenant à l’État qui a
perdu son intérêt public peut être prise par arrêté du ministre de la Culture
après avis du ministre de tutelle de l’institution conservant le bien. Un
arrêté du 30 septembre 2021 a ainsi déclassé et radié de l’inventaire du
Mobilier national des meubles de série ou d’usage, dépourvus d’intérêt
historique ou endommagés4.
L’inaliénabilité est aussi remise en
question par les restitutions, qu’une proposition de loi du 12 octobre 2021 en
cours de discussion au Sénat souhaite encadrer davantage. En application d’une
loi du 24 décembre 2020, 26 œuvres du musée du quai Branly provenant du pillage
du palais d’Abomey par l’armée française ont été restituées au Bénin en octobre
2021, marquant une dérogation significative au principe d’inaliénabilité. Par
ailleurs, un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 3 novembre
2021 vise à restituer 14 biens culturels faisant partie des collections
publiques aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions
antisémites.
La dernière catégorie de trésors
nationaux est constituée de biens n’appartenant pas encore au domaine public
mais qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national. Un
système de filtrage a été mis en place pour que ces biens soient identifiés en
vue d’une éventuelle acquisition par l’État, l’objectif étant d’éviter leur
dispersion.
Certains déplacements supposent l’obtention préalable
d’une autorisation ; une procédure spécifique s’ouvre en cas de refus de
délivrance du certificat d’exportation.
Les déplacements nécessitant une autorisation administrative
Signalons en premier lieu que
certains biens issus d’espèces protégées ne peuvent circuler qu’avec un
« permis CITES » délivré par les directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), sous peine de
sanctions pénales.
En dehors du cadre de la Convention
CITES, les biens culturels nécessitant une autorisation pour franchir les
frontières françaises sont définis à la fois dans des règlements européens
(règlements n° 2019/880 en matière d’importations et n° 116/2009 en
matière d’exportations) et dans le Code du patrimoine, qui prévoit en son
article L. 114-1 des sanctions pénales en cas d’importation ou exportation
non autorisées.
Une autorisation définitive ou
temporaire est nécessaire dès lors que la frontière est franchie, même
lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas destinés à la vente. Il existe
toutefois des dérogations, notamment pour les œuvres appartenant à leur auteur,
les biens déplacés pour une restauration, une expertise ou une exposition et
les biens importés à titre temporaire.
Le tri entre les biens pouvant
circuler librement et ceux nécessitant une autorisation s’opère au moyen de
catégories et de seuils. Les seuils prévus à l’échelon national ont été
modifiés par un décret entré en vigueur le 1er janvier 20215,
qui a relevé les seuils applicables à 11 catégories de biens pour tenir compte
des exigences du marché et concentrer le contrôle sur les catégories
prioritaires. À
titre d’exemple, seuls les tableaux de plus de 50 ans d’âge d’une valeur
supérieure à 300 000 euros
nécessitent désormais une demande de certificat, contre 150 000 euros auparavant ; en revanche, une demande reste obligatoire
quelle que soit la valeur de l’objet pour les antiquités nationales et le seuil
n’a été relevé qu’à 3 000 euros
pour les objets archéologiques de plus de 100 ans.
Les conséquences d’un refus de
certificat
Aux termes de l’article L. 111-4 du Code
du patrimoine, le seul motif possible de refus de délivrance du certificat est le caractère de trésor national du
bien culturel. En revanche, en application de l’article L. 111-3-1, l’État
peut suspendre l’instruction de la demande de certificat « s’il existe des présomptions graves et concordantes que
le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une
contrefaçon ou provient d’un autre crime ou délit ». L’État
a ainsi récemment suspendu l’examen d’une demande de certificat portant sur le « Martyre de Saint-Sébastien » de Léonard de
Vinci en raison d’une plainte pour vol.
Lorsque l’État
considère un bien comme un trésor national, il prend un arrêté de refus de
certificat qui marque le début de la procédure d’acquisition prévue à
l’article L. 121-1 du Code
du patrimoine. Cette procédure de négociation contrainte, qui oblige l’État
à
proposer une offre d’achat au prix du marché
international sous peine d’être tenu de délivrer le certificat, et le
propriétaire à renoncer au certificat d’exportation s’il persiste à refuser une
telle offre, a souvent pour cœur la détermination par voie d’expertise du juste
prix de l’œuvre et ne doit pas être confondue avec le droit de préemption prévu
à l’article L. 123-1 du Code
du patrimoine, qui permet à l’État
d’être subrogé à l’acquéreur à l’issue de certaines ventes.
Lorsque l’État souhaite acquérir des biens culturels qui n’entrent pas dans le cadre prévu pour les procédures relatives aux certificats d’exportation (par exemple lorsque le bien n’est pas situé sur le territoire français), la Commission consultative des trésors nationaux peut déclarer ces biens d’intérêt patrimonial majeur dans le cadre de négociations amiables avec les propriétaires. Cette déclaration ouvre droit à l’application du régime fiscal de faveur de l’article 238 bis-0 A
du Code général des impôts, qui prévoit une réduction d’impôt égale à 90 % des versements faits pour permettre soit l’acquisition d’un trésor national déclaré comme tel dans le cadre de la procédure de refus de certificat, soit l’acquisition d’un bien déclaré d’intérêt patrimonial majeur, qui acquerra in fine également le statut de trésor national. Plusieurs acquisitions de trésors nationaux réalisées en 2021 ont été partiellement financées par des mécènes, parmi lesquelles une paire de tableaux de Fragonard par le Louvre, qui l’a transférée au Musée Fabre, ainsi que des manuscrits de Sade et Breton par la Bibliothèque nationale de France.
Conformément aux traités européens, le système français
concilie ainsi la libre circulation des biens avec une politique patrimoniale
en perpétuelle recomposition, de sorte qu’il y a tout lieu de supposer que
l’actualité restera nourrie en la matière.
1)
Cass., 1re civ., 1er juill. 2020, n° 18-25.695.
2)
Pierre-Antoine Souchard, « La Bergère de Pissarro rentrera ses moutons
aux États-Unis », Dalloz Actualité, 3 juin 2021.
3)
CE, 2 juil. 2021, req. n° 447967.
4)
Arrêté du 30/09/21 portant radiation de l’inventaire et déclassement de biens
du Mobilier national, JO du 09/10/21.
Hélène Dupin,
Avocate
Fondatrice,
Hélène
Dupin Avocats,
Membre
de l’Institut Art & Droit
Pierre
Hutt,
Avocat,
Hélène
Dupin Avocats
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *