Article précédent
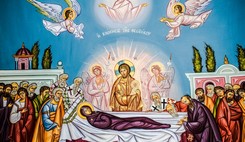

Compte rendu d’un e-débat organisé par le CNB
Crise oblige, le monde de la culture a dû se mettre sur pause puis se réinventer pour faire face à un contexte inédit, constate le Conseil national des barreaux à l’occasion d’un e-débat. Le metteur en scène Charles Berling, qui estime que le secteur n’a pas été suffisamment soutenu, rappelle que la culture est un bien commun devant faire l’objet de « perspectives, au-delà de l’épidémie de Covid ».
C’est un domaine qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire. Le 17 mars, les mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ont mis la culture à l’arrêt.
Arrêt des expositions, des spectacles ; fermeture des structures d’accueil… Léa Morgant, chargée de mission mécénat au ministère de la Culture, parle, lors de ce e-débat, d’une « période d’incertitude, de flottement », qui a vite « débouché sur une période d’inquiétude », dans un contexte de paralysie généralisé à l’issue nébuleuse.
Charles Berling témoigne : « En tournée au Maroc, j’ai dû cesser de jouer. Je suis rentré en France et j’ai pu, avec mon équipe, préparer ce confinement. C’était impératif, car nous sommes une institution culturelle et, à ce titre, un grand nombre de gens dépendent de nous. Beaucoup ne sont pas reliés à une institution, n’ont pas de revenus fixes. Nous, institutions culturelles, avons le devoir de soutenir cette filière le plus activement. C’est ce que nous avons fait. En télétravail, on a pu encaisser, mais je mesure l’effondrement produit dans le monde culturel », affirme celui qui est tout à la fois acteur, metteur en scène, réalisateur, scénariste et directeur de la scène nationale Châteauvallon – Liberté, à Toulon.
Le « casse-tête » d’une nouvelle organisation
Du jour au lendemain, il a donc fallu gérer cette situation de crise et, en particulier, l’organisation de l’activité, car « au-delà de l’aspect culturel, un directeur de théâtre est aussi un employeur : c’est quelqu’un sur lequel repose tout un ensemble de règles de sécurité », souligne Éric Goirand, avocat et élu du Conseil national des barreaux (CNB). Il précise que certains travailleurs ont continué leur activité « sur site », et qu’à ce titre, une organisation sanitaire a dû être mise en place.
Organisation qui s’est poursuivie après le déconfinement, et qui relève d’un vrai « casse-tête », estime Éric Goirand. D’autant que, « comme tout chef d’entreprise, si les règles ne sont pas respectées, cela peut engendrer un certain nombre de responsabilités, pénales entre autres, à l’égard des ressources humaines, mais aussi de tout un public qui va, on l’espère, rapidement de nouveau se rendre dans les salles de spectacle », ajoute l’avocat.
Celui-ci rappelle que pour mieux accompagner les professionnels du secteur, la Direction générale de la création artistique a mis en place des guides destinés aux différentes activités culturelles, tandis que le rapport du professeur Bricaire, infectiologue, dévoilait le 30 avril dernier un plan de déconfinement de la culture, via une série de propositions sur « un processus de réouverture des lieux de spectacles, de tournage et de répétitions ».
Appel à la solidarité
Face à des mesures gouvernementales jugées « insuffisantes » pour certains, des initiatives solidaires ont fleuri. « On a essayé de réfléchir aux systèmes qu’on pouvait mettre en place », indique Caroline Delaude, présidente de Proarti. Avec le dispositif « Spectateurs solidaires », la plateforme de mécénat participatif a ouvert la possibilité aux spectateurs faisant face à des annulations de spectacles de faire une « bonne action » à destination des équipes artistiques et de transformer leurs billets en dons défiscalisables, à hauteur de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les entreprises. « Ce dispositif a été assez balbutiant, car on s’est retrouvés dans une sorte de sidération », raconte Caroline Delaude. « On s’est également demandé pourquoi on ne procéderait pas à un abondement sur les places, afin de réaliser un don plus important, et permettre ainsi la survie des établissements, ou, du moins, aider les salles et l’ensemble du secteur culturel à sortir de cette période. »
Alors que d’autres projets étaient parallèlement déployés, suite à la vague d’appels à l’aide #SauveTonSpectacle, un mécanisme similaire porté par le ministère de la Culture auprès de l’administration fiscale a également vu le jour. Le « ticket solidaire » a ainsi « consisté à rendre éligible au mécénat » (particuliers et entreprises) « la renonciation à demander le remboursement d’un ticket » quand l’organisme qui l’a vendu entre dans le champ de la réduction d’impôt, explique Léa Morgant.
Le message est clair : « Prendre en compte le fait que la culture, les artistes, sont des acteurs nécessaires à la vie de la nation », commente l’avocate et élue du CNB My-Kim Yang Paya.
Charles Berling constate que le public a « très bien réagi » et rapporte qu’un quart des gens ont renoncé au remboursement de leurs billets. Pour le directeur de la scène nationale Châteauvallon – Liberté, ces démarches font écho au « billet suspendu » créé il y a quelques années, qui vise à offrir un billet de spectacle à un inconnu n’ayant pas les moyens de se l’offrir, inspiré du « café suspendu » italien.
Bien qu’elle soit difficile pour tous les professionnels du secteur, l’annulation des spectacles et des festivals s’avère d’autant plus problématique pour les « jeunes artistes qui devaient se lancer » cette année, évoque Caroline Delaude. « Avec l’annulation, par exemple, du festival d’Avignon, que vont devenir les artistes en phase de présenter leur premier spectacle ? », s’inquiète la présidente de Proarti. Celle-ci le martèle : « On doit accompagner le mieux possible ces artistes qui ont une véritable vocation. »
À ce titre, Proarti a réussi à collecter plus de 500 000 euros dans le cadre du festival d’Avignon. Caroline Delaude s’en réjouit, mais ne s’en contente pas : « Il faut que d’autres actions soient menées pour qu’on soit de plus en plus solidaires. Pendant le confinement, il n’y a pas eu beaucoup de mobilisation car tout le monde était sous le coup de la sidération, mais il faut que la solidarité s’affirme de plus belle. »
Le mécénat en question
Léa Morgant redoute pour sa part un fléchissement du mécénat. « Quand les spectacles n’ont pas lieu, les entreprises doivent en rendre compte à leur conseil d’administration. N’y aura-t-il pas un changement stratégique au moment de la prise de décision des entreprises vis-à-vis du mécénat culturel, qui s’effacera derrière des choix sociétaux, des besoins prioritaires ? »
En dépit de ces préoccupations, la chargée de mission mécénat au ministère de la Culture voit dans la crise sanitaire une opportunité d’évolution sur le mécénat et la place de l’artiste. Elle constate qu’il n’y a jamais eu autant cette nécessité du lien social et de l’humain. « Le mécénat, ce n’est pas qu’une question de fiscalité. C’est un vrai échange. »
Charles Berling opine : les entreprises et les structures sont demandeuses d’un échange de valeurs. « Il s’agit d’un vrai partage, pas juste de vouloir […] pomper de l’argent ici et là. »
Pour Caroline Delaude, en étant mécène, on participe activement à un projet culturel : « On le choisit, et on voit son évolution. »
Spectacle vivant VS le reste ?
La présidente de Proarti en profite pour livrer un plaidoyer pour le spectacle vivant. Elle s’insurge contre « l'ingurgitation massive » des séries disponibles sur les grandes plateformes, principalement américaines, et insiste : « Il n’y a rien de mieux que le spectacle vivant. »
Éric Goirand abonde : « Quand Charles Berling m’a invité à la répétition de sa pièce, Dans la solitude des champs de coton, je me suis retrouvé dans le noir complet de la salle de théâtre, à entendre la respiration des comédiens : et cela, aucun écran ne pourra nous le rendre. »
Selon l’avocat, certaines formes de culture passent certes davantage par les écrans d’ordinateur, mais le spectacle vivant a quelque chose d’unique et d’exceptionnel. « Il est vrai qu’on peut regarder des films chez soi, et c’est très pratique, mais le bonheur d’une salle de cinéma, ce n’est pas du tout la même chose. »
My-Kim Yang Paya se veut beaucoup plus nuancée. L’avocate considère qu’il faut évoluer avec son temps, et qu’il n’y a « pas que du mauvais dans les nouvelles manières d’aborder la culture ». Elle ajoute qu’une directive européenne bientôt transposée va obliger les plateformes à l’étranger (Netflix, Amazon) à contribuer à l'audiovisuel venu d’Europe, puisqu’elles devront s’engager à proposer 30 % de films, séries et documentaires européens. Un grand pas pour la diversité des contenus, s’enthousiasme My-Kim Yang Paya.
Charles Berling s’inscrit lui aussi dans cette optique. Le metteur en scène ne souhaite pas opposer le spectacle vivant et le reste. « Je ne rejette pas tout cela, et c’est normal : je fais de la télévision, du cinéma et des séries qu’on trouve sur Netflix. Je ne suis pas non plus contre le progrès. Au contraire, les outils numériques sont formidables. À la scène nationale Châteauvallon – Liberté, on a créé une 7e scène, virtuelle. »
Une « scène virtuelle », (inter)nationale, cette fois, c’est aussi ce que Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux, retient du visage qu’a pris la culture pendant cette crise sanitaire. « Les réseaux ont ouvert d’immenses espaces publics », rapporte l’avocate. « En plein Covid, des vidéos ont été vues des millions de fois : des danseurs de l’Opéra de Paris ont tourné une vidéo exceptionnelle, un chanteur a improvisé un morceau avec sa nièce… Il y en avait pour tous les styles, tous les goûts ! »
Pour Charles Berling, tout est une question de « juste mesure ». « Je pense juste qu’il faut considérer les choses comme elles sont, et prêter attention à ne pas trop se faire embarquer par la technologie qui pourrait nous vider de notre substance. Il y a une balance à laquelle il faut réfléchir – même si certains lobbies n’ont, bien sûr, pas intérêt à ce qu’on réfléchisse. »
La culture, un « bien commun »
Les intervenants à la table ronde tombent en tout cas tous d’accord sur un point : le confinement a permis aux Français de réaliser, encore plus que d’ordinaire, à quel point la culture était une chose importante, voire vitale. « Nous avions besoin de cette bouée de sauvetage pour passer cette période », assure Éric Goirand.
À ce titre, Charles Berling soutient avec force que la culture n’est pas un bien de consommation comme les autres : « C’est un bien commun, et, dans ce sens, il est nécessaire que les pouvoirs publics lui donnent des perspectives, au-delà de l’épidémie de Covid, à plus long terme. »
À ses yeux, l’immatérialité des métiers de la culture ne saurait s'inscrire dans un quelconque consumérisme, mais apporte au contraire une valeur fondamentale à la civilisation, à ce qu’est l’être humain, qui dépasse la simple consommation. « Il faut faire admettre aux pouvoirs publics que cette immatérialité est un bien nécessaire qui doit être protégé. Quand nous ouvrons nos portes, les spectateurs ressentent cela, et donc la nécessité de revenir », appuie le metteur en scène.
Celui-ci aime à relier, dit-il, « diversité culturelle et diversité naturelle ». « La crise a montré que beaucoup de choses étaient en relation, qu’il était important de cesser de considérer que l’homme est indépendant de la planète et de la nature qui l’environne. »
L’heure du bilan
Alors que le monde de la culture s’est remis – progressivement – en route depuis un mois, Charles Berling tire le bilan. En dépit des mesures générales (chômage partiel, prêts garantis par l’État, report de cotisations sociales et charges fiscales...) et des mesures spécifiques (aide d’urgence de 22 millions d’euros, fonds d’indemnisation, année blanche pour les intermittents…) en faveur du secteur, qui compte 1,3 million d’emplois, le directeur de la scène nationale Châteauvallon – Liberté regrette que le ministère de la Culture n’ait pas apporté davantage de soutien.
En outre, il souligne que le président de la République a réclamé aux professionnels du spectacle vivant de se réinventer, de conquérir de nouveaux publics, notamment les très jeunes. « Or, plaide-t-il, c’est ce que nous faisons constamment ! » Charles Berling s’oppose à ce qu’artistes et culture soient réduits à une simple mission pédagogique. « Cela fait bien évidemment partie de nos missions, et on en est fiers, mais les artistes sont des artistes, il faut préserver leur liberté, et pas seulement les soumettre à des injonctions. »
Enfin, le metteur en scène déplore le manque de la part des politiques, du ministère de la Culture et du président de la République, d’« une vision plus à long terme ».
Les acteurs de la culture ont, pour leur part, retroussé leurs manches, indique Charles Berling. « La pandémie de Covid nous commande de mieux penser l’avenir, de mieux penser notre pérennité, expose-t-il. Il est fondamental de jeter des bases pour les générations suivantes. Cela nous a amenés, mes collègues et moi, à étudier comment se repenser collectivement, comment revoir nos organisations. Mais nous avons aussi constaté qu’il valait mieux territorialiser les institutions. Et à ce sujet, les institutions théâtrales sont exemplaires. À la télévision ou au cinéma, on fabrique quelque chose sur des canaux qui nous échappent totalement ; on ne sait plus à qui on parle. Alors que les institutions territoriales ancrées sont des vecteurs de liberté, car elles permettent à des communautés humaines de se retrouver, d’échanger. »
Aujourd’hui, la scène nationale Châteauvallon – Liberté ouvre ses portes à 200 personnes – tout en appliquant, bien sûr, les règles sanitaires préconisées. « Dès le mois de juillet, on a prévu des spectacles avec des compagnies régionales de danse. On constate que le public répond massivement ; les standards sont assiégés ! », se réjouit Charles Berling.
C’est tout le mal que l’on souhaite à notre Culture.
Bérengère Margaritelli
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *