Article précédent

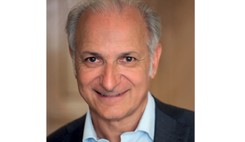
Olivier Salustro a succédé à Jean-Luc Flabeau à la tête de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, le 3 octobre 2017. Notamment expert auprès la cour d’appel de Paris et vice-président de la commission évaluation de la CNCC, il est à la tête de de la CRCC la plus importante de France avec près de 3 000 professionnels inscrits. Il revient pour le Journal Spécial des Sociétés sur son parcours, et plus largement sur les missions et responsabilités qui incombent aujourd’hui aux commissaires aux comptes.
J’ai commencé ma carrière chez Peat Marwick, devenu par la suite KPMG. Au début des années 90, je suis entré au cabinet Salustro Reydel, puis j’en suis sorti pour fonder un cabinet. J’ai ensuite refondé ma propre structure en 2011, Salustro et Associés, qui compte une douzaine de personnes, qui exercent outre le commissariat aux comptes des métiers périphériques à l’audit, comme l’évaluation financière sous toutes ses formes. En parallèle, j’étais depuis quelques années un élu de la compagnie, et depuis un an et demi, un membre du bureau de la CRCC Paris. Son président Jean-Luc Flabeau ayant été appelé à d’autres fonctions, je lui ai succédé, début octobre 2017. Ayant pris le mandat en cours, mes fonctions prendront fin quand l’année 2018 s’achèvera.
Vous êtes devenu président de la CRCC Paris en octobre 2017. Pourriez-vous définir le rôle de cette instance ?
La CRCC Paris est une instance qui accompagne les commissaires aux comptes. Il existe autant de CRCC que de cours d’appel. La CRCC Paris couvre Paris, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, l’Essonne et l’Yonne. La CRCC Paris compte environ 3 000 professionnels inscrits, ce qui en fait la plus importante de France. Ces compagnies accompagnent les professionnels dans plusieurs domaines : les aspects classiques dits « régaliens », c’est-à-dire le contrôle qualité, les conciliations entre confrères et clients, l’organisation d’élections, les cotisations, les inscriptions… En d’autres termes les aspects administratifs et techniques, sachant que la plupart de ces missions régaliennes sont en partie exercées par délégations, la réforme européenne de l’audit ayant abouti au transfert de certaines de ces missions au H3C. La compagnie exerce aussi un rôle de représentation, de défense de la profession, et pour cela échange avec toutes les autorités (tribunaux de commerce, TGI, régulateurs, compagnie nationale, organisations patronales et syndicales, etc.). Nous proposons également aux commissaires aux comptes inscrits des formations gratuites ou payantes. Celles qui sont gratuites interviennent plusieurs fois par an et s’organisent sous forme de réunions. La CRCC de Paris se déplace d’ailleurs dans chacun des départements qu’elle couvre. En outre, nous mettons à disposition de nos confrères qui n’auraient pu assister à ces réunions, ou qui voudraient aller plus loin, des formations payantes via un organisme de formations, l’Asforef.
Le commissaire aux comptes est un des acteurs de la chaîne de confiance et de régulation qui permet à l’économie de fonctionner. Car sans confiance, il n’y a pas d’économie qui vaille, en témoigne la crise de 2008, représentative d’une rupture de la chaîne de confiance. Le CAC est là pour valider et certifier que les états financiers des entreprises qui font appel à ses services sont conformes à un certain nombre de prescriptions, de réglementations. Le rôle de cet expert est donc de certifier les comptes publiés par les sociétés en émettant une opinion positive. Il arrive bien entendu que nous émettions des réserves, ou des refus de certifier. Mais, la plupart du temps le CAC est là pour garantir que l’information financière publiée est conforme à la réglementation qui s’applique au moment où les comptes sont publiés. Nous exerçons une mission d’intérêt général, instituée par la loi. On peut donc dire que le CAC constitue une partie essentielle du système de régulation économique en France.
Quelle(s) différence(s) entre la profession de commissaire aux comptes et les autres professions réglementées ?
Ce qui nous distingue des autres professions réglementées, c’est que le CAC au-delà d’être indépendant en fait, doit l’être également en apparence. C’est le point cardinal de ce qu’est un commissaire aux comptes. S’il n’apparaît pas indépendant, sa mission n’a aucun sens. Ce qui nous distingue des autres aussi, c’est que nous avons un régulateur qui nous contrôle et réglemente : le H3C. En outre, plus que toute autre profession réglementée, nous devons répondre à un tissu réglementaire très dense : Code de commerce, textes européens (réforme de l’audit), normes d’exercice professionnel édictées par le H3C, doctrines… À cela s’ajoute que notre responsabilité pénale peut être plus largement sollicitée en cas de défaillance dans l’exercice de nos fonctions. Enfin, le commissariat aux comptes est une profession dans laquelle le secret professionnel est très développé, et à mon sens beaucoup plus que dans d’autres professions réglementées. Au point que même, entre commissaires aux comptes, il est difficile d’obtenir des informations sur telle ou telle mission.
Quel rôle les CAC jouent-ils dans la prévention des difficultés des entreprises ?
Nous avons un rôle d’alerte qui est d’ailleurs bien codifié. À partir du moment où nous constatons qu’une entreprise rencontre des difficultés, nous avons le devoir de rentrer dans ce qu’on appelle « la procédure d’alerte ». Celle-ci comporte différentes phases regroupant nos interrogations sur la poursuite de l’activité de la société, et sur la pérennité de l’entreprise. Nous sommes alors amenés à interroger le chef d’entreprise sur un certain nombre de mesures qu’il compte prendre. Et dans l’hypothèse où nous ne sommes pas satisfaits de ses réponses, nous alertons le tribunal de commerce, qui va s’intéresser à ce dossier et aider l’entreprise à se sortir de ce mauvais pas. Mais là encore, le CAC s’arrête une fois son devoir d’alerte accompli. Ce n’est pas à lui de conseiller la société sur la manière de redresser la situation. Le commissaire aux comptes a un devoir absolu de non-immixtion dans la gestion de l’entreprise.
En quoi consiste cette notion d’indépendance que l’on retrouve dans le Code de déontologie des CAC ?
Nous avons un Code de la déontologie assez élaboré, qu’on se doit d’appliquer au jour le jour, par exemple sur la question de l’indépendance ou de l’apparence d’indépendance. Il y a d’ailleurs eu récemment un renforcement de cette notion dans le nouveau Code de déontologie qui prolonge la réforme européenne de l’audit. A notamment été précisée la notion de conflit d’intérêts avec, entre autres, l’exemple du déjeuner avec le client qui ne doit pas dépasser une certaine somme. À chaque fois qu’on a une nouvelle mission, on doit se poser la question de savoir si on est bien indépendant, si on respecte bien cette apparence d’indépendance. Le commissaire aux comptes doit être non seulement indépendant dans le fond, mais aussi en apparence, c’est-à-dire répondre aux critères d’indépendance concrets. Il ne doit pas gérer de commerce, ne pas avoir de liens familiaux ou amicaux avec l’entreprise qu’il audite. Il ne doit pas non plus laisser penser qu’il est en lien avec le dirigeant. Nous disposons d’outils développés en interne pour s’assurer de ces aspects-là : questionnaire à administrer, questions à poser au sein du cabinet ou au sein de réseaux de cabinets. L’aspect formation est également très développé dans notre profession, car les CAC sont en formation permanente. Ils ont un quota d’heures à effectuer chaque année : 120 heures de formation sur trois ans, dont la moitié qui doit être homologuée par un comité scientifique près de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Pour rester pertinents, ils doivent aussi être à l’écoute et en veille permanente.
Dans le cadre de ses missions, le CAC peut être amené à révéler des faits délictueux au procureur de la République ou autre instance publique. Ne peut-on pas dire qu’il est en quelque sorte un lanceur d’alerte ?
Un lanceur d’alerte c’est quelqu’un qui est en général à l’intérieur de l’entreprise, et qui lance une alerte pour dénoncer des pratiques inappropriées et, dès lors, fait l’objet d’une protection subséquente. Nous, nous sommes externes à la société, et notre mission est davantage de certifier des informations. Ce n’est donc pas tout à fait le même rôle. Juridiquement cela n’a même rien à voir. Par contre, nous avons l’obligation de révéler des faits délictueux au procureur de la République donc là, quelque part, au sens très large, « on lance une alerte » par rapport à des irrégularités qui peuvent relever du pénal. On écrit au procureur de la République à propos de ce qu’on a constaté, ensuite le procureur va mettre en œuvre une procédure d’enquête s’il l’estime nécessaire. Généralement, celui qui a révélé est interrogé par les enquêteurs (police, brigade financière…). Il apporte alors sa vision pour éclairer l’enquêteur, qui ensuite rapporte tout cela au procureur de la République, qui décide soit de poursuivre, soit de clôturer le dossier. Une fois que la révélation a été faite, le reste n’est plus de notre ressort.
Pensez-vous que la CRCC, qui peut donner son avis sur des projets de lois ou de décrets, est suffisamment entendue par les pouvoirs publics ?
La loi étant de portée générale, il revient plus à la Compagnie nationale qu’aux compagnies régionales d’exprimer la voix de la profession. Par exemple, concernant le projet de loi Le Maire qui devrait sortir au printemps, la CNCC a été interrogée sur différents sujets, et moi en tant qu’élu parisien j’ai été amené à travailler sur certains aspects de ce projet de loi. Je ne sais pas si ça ira dans notre sens mais, en tous les cas, nous avons été écoutés.
L’arrêté du 26 mai 2017 impose aux commissaires aux comptes de fournir désormais de nouveaux formats de rapport. Pourquoi de tels changements et quels sont-ils ?
Durant l’audit, il y a un travail de rédaction, d’analyse juridique, etc. Aujourd’hui, nous disposons en effet d’un nouveau format de rapport d’audit, pour une meilleure compréhension de la part du client (il existe d’ailleurs deux formats, un réservé aux entreprises dites EIP, et une version pour les autres). La différence entre l’ancien et le nouveau rapport se situe d’abord au niveau de l’organisation des éléments qui y figurent. Désormais, nous démarrons notre rapport par l’expression de notre opinion, laquelle se situait auparavant tout à la fin. On précise ensuite les fondements de cette opinion, en indiquant à quel référentiel d’audit on fait référence. Il faut également parler de son indépendance, évoquer éventuellement le fait qu’il existe ou non des incertitudes sur la continuité de l’activité. Enfin, il faut justifier ses appréciations. Dans ce nouveau format de rapport, il y a également une partie plus classique concernant le côté juridique qui nous incombe. Enfin, ce rapport est davantage détaillé, avec des formulations très précises quant à la responsabilité de chacun dans l’élaboration des comptes, de l’opinion… Il s’agit de bien clarifier les choses entre celui qui fait les comptes, et celui qui les audite.
Le Haut conseil au commissariat aux comptes contrôle la profession, mais qui contrôle les activités du H3C ?
Nous sommes sous l’étroite surveillance du H3C, qui exerce directement ou indirectement un contrôle qualité. Tous les ans, le H3C contrôle un certain nombre de cabinets, pour savoir si ces derniers sont organisés comme il se doit, et s’ils respectent la législation sur le terrain. Le H3C essaie de savoir, via l’étude de certains dossiers, si les missions ont été convenablement menées, et si la substance même du travail du CAC est conforme et pertinente par rapport aux sujets à traiter. Il vérifie aussi si tous les moyens ont été mis en œuvre, car, je le rappelle, nous avons une obligation de moyens. Le H3C est une autorité administrative indépendante, donc elle ne dépend de personne. Cette autorité émet des normes, régule la profession, surveille, contrôle, effectue des contrôles qualité et détient également un pouvoir de sanction. Il reste cependant que les normes qu’elle édite sont soumise à l’homologation de la chancellerie. Par ailleurs, le Code de déontologie qu’il a rédigé a été publié par un décret du garde des Sceaux du 12 avril 2017.
S’agissant des décisions individuelles du H3C, donc d’une décision qui fait grief, c’est la juridiction administrative qui, dans le cadre d’un contrôle de légalité, va être amenée à en contrôler la conformité. En dehors de cela, le H3C est doté d’un large pouvoir de décision. Il bénéficie d’une très grande indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Enfin la Cour des comptes peut, depuis la réforme européenne de l’audit, vérifier que cette instance est bien gérée.
Pensez-vous que les cabinets sont désormais en conformité vis-à-vis de la réforme européenne de l’audit entrée en vigueur en 2017 ? Si non, comment les y aider ?
À partir de 2018, dans les contrôles qualité qui seront opérés soit directement soit indirectement par le H3C, l’application des conséquences de la réforme européenne de l’audit sera surveillée. En particulier toutes les modifications de procédures internes prévues par la réforme européenne de l’audit seront vérifiées, notamment la mise en place d’un contrôle qualité interne, et la surveillance du bon fonctionnement de ce contrôle qualité par les cabinets eux-mêmes. Les cabinets sont soumis à un contrôle-qualité externe mené par le H3C, ou par délégation par les compagnies. De plus, chaque année, les cabinets doivent faire faire un contrôle par le responsable du contrôle qualité interne ou par un contrôleur externe. Sur ce point-là, la compagnie de Paris fait de gros efforts, car nous offrons à nos confrères un outil leur permettant de développer un manuel de procédures intégrant ces aspects de contrôle qualité interne. Cet outil s’appelle Cap performance. Nous offrons aussi une plateforme d’échanges qui s’appelle BBusi, qui permet aux cabinets de trouver des contrôleurs qualité interne parmi la population de confrères qui offrent leur service. Ce dernier doit bien entendu présenter certaines qualités, notamment avoir fait suffisamment d’heures d’audit dans l’année, être indépendant du cabinet…
Propos recueillis par Maria-Angélica Bailly
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *