Article précédent
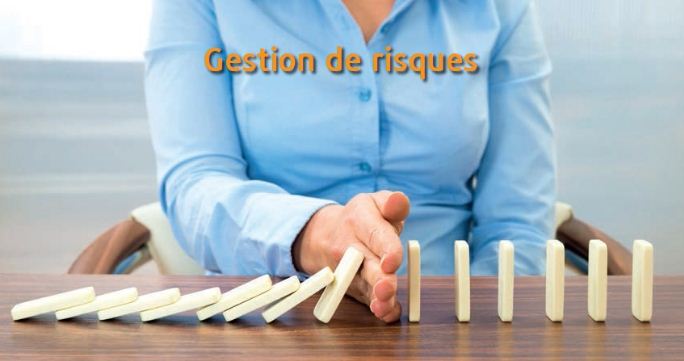
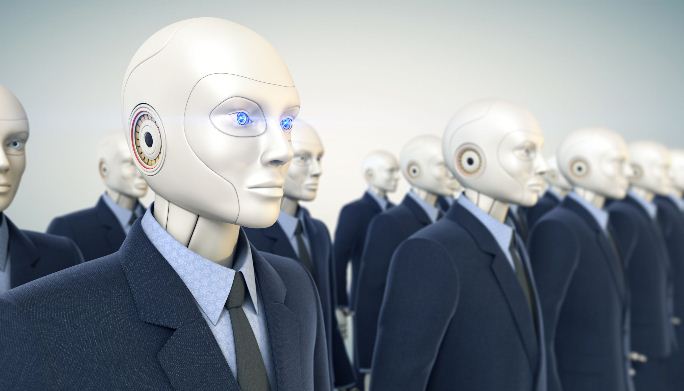
Une nouvelle étude de l’institut France Stratégie - « L'effet de l'automatisation sur l'emploi : ce qu'on sait et ce qu'on ignore » - estime que « seulement » un emploi sur six pourrait être automatisé dans le futur. Un chiffre qui nuance des études passées plus alarmantes, qui prédisaient que plus de 40 % des humains verraient leur emploi remplacé par des robots.
C’est un thème de société qui pour certains
tourne à la psychose. Selon une étude abordée lors du dernier forum de Davos,
d’ici 2020, chez les 15 plus grosses économies de la planète, près de 5
millions d’emplois seront occupés par des machines. Des robots assumeraient des
tâches habituellement occupées par des humains.
Un chiffre qui inquiète surtout lorsqu’on le rapproche d’une étude réalisée en
2013 par deux chercheurs de l’université d’Oxford, Carl Benedikt Frey et
Michael A. Osborne : « Future
of employment : how susceptible are jobs to computerisation ? ».
D’après leurs travaux, 35% des emplois au Royaume-Uni et 47 % aux USA
présenteraient une forte chance d’être automatisés dans un avenir proche. En
appliquant ces recherches à d’autres pays, on obtient des résultats aussi
spectaculaires : 42 % en France, 49 au Japon et jusqu’à 54 % dans l’Union
Européenne. Ces données ont été estimées en pointant 70 professions que les
chercheurs estiment comme pouvant être, ou non, automatisées (commandées par
des robots, des logiciels ou effectuées par des machines).
L’automatisation viendrait-elle alors à bout du salarié ?
Face à de tels chiffres, même si
la prédiction ne fixe pas de date exacte, on peut légitimement se demander si
l’avenir n’appartient pas aux machines. Dans nombre d’usines, la robotique a
remplacé la main humaine et le phénomène se répand dans d’autres secteurs de
l’économie. C’est ici qu’entre en jeu l’étude de France Stratégie. Prenant en
compte ces observations, l’institut livre ses propres estimations, bien en deçà
de l’étude britannique. Selon eux, 15 % des emplois en France seraient
susceptibles d’être automatisés. Soit environ 3,4 millions de postes, qui
pourraient voir se substituer aux hommes des robots, des logiciels, etc.
Pour arriver à une telle divergence (de 42 à 15 %), il faut se pencher sur la
méthode d’analyse elle-même. Les chercheurs d’oxford considèrent chaque
profession comme un tout, alors que l’étude française décompose chaque tâche
effectuée dans la profession en question. Ils mettent en évidence que certains
aspects d’un métier ne pourraient pas être réalisés par un logiciel. Ils prennent
pour exemple le secteur du service, les vendeurs, ou les comptables. France
Stratégie explique également que en près de 15 ans, les emplois « peu
automatisable » [1]
ont augmenté de 33%, passant de 6,9 millions en 1998 à 9,1 millions en
2013 ; minimisant, selon eux, le risque de voir des professions se transformer.
L’étude de l’organisme, rattachée au Premier ministre, rejoint celle que l’OCDE
avait publiée en mai dernier, « The
Risk of Automation for jobs in OECD Countries : A Comparative Analysis ».
Selon leurs prévisions, seulement 9% des emplois en France seraient
automatisables. Des chiffres similaires, sans doute rassurant pour certains,
mais pas forcément indicateurs d’une bonne santé du marché du travail :
« La conclusion principale de notre article est qu’il est peu probable que l’automatisation et la numérisation détruisent un grand nombre d’emplois. Cependant, les travailleurs peu qualifiés souffriront plus des coûts d’ajustement car leur emploi est davantage susceptible d’être automatisé que pour les travailleurs qualifiés. Ainsi, le défi futur consiste probablement à faire face à la croissance des inégalités et à veiller à former (ou former à nouveau) les travailleurs peu qualifiés. »
Délocalisation, désindustrialisation…
Les résultats soulignent une autre tendance forte pour le marché de l’emploi des pays occidentaux, celle de la désindustrialisation. Au regard des critères retenus par les deux études, il apparaît que les emplois des secteurs primaire et secondaire, essentiellement liés aux industries, sont d’avantage susceptibles d’être automatisés (25 %), que ceux touchant aux services et aux relations avec le public (13 %). Les risques de voir une automatisation réductrice de main d’œuvre dans nos contrées sont de plus en plus limitées du fait de la désindustrialisation, le nombre d’emplois potentiellement concernés a reculé de 200 000 depuis 1998.
Certes, moins d’activités vont être occupés par des logiciels, mais parce que elles n’existeront malheureusement plus. Cependant, selon l’analyse, la transformation des emplois, l’émergence de nouveaux modes d’organisation du travail, permettent, non seulement, d’amortir la destruction de postes, mais aussi de limiter le risque d’automatisation. Sur la période 2005-2013, grâce à cette modification de la pratique des métiers, on a assisté à une hausse de 1,13 millions d’emplois peu automatisables. Sans cette transformation, la hausse se serait limitée à seulement 400 000 postes. Soit 730 000 personnes qui auraient pu voir leur travail effectué par un robot dans le futur. Les interactions sociales seraient la clef pour garder les emplois occupés par des humains.
…Transformation et révolution
Face à cela, un autre facteur est à prendre en compte, le progrès technologique. Ici, les chercheurs restent incertains. Pour quelques secteurs, ils ne peuvent déterminer, si le progrès a sensiblement détruit des emplois, puis compensé la perte avec l’apparition de nouveaux métiers, ni si dans le futur ces derniers seront plus facilement automatisables. (...)
[1] « Les emplois peu automatisables sont ceux dont le rythme de travail est imposé par une demande extérieure exigeant une réponse immédiate et qui ne consistent pas toujours à appliquer strictement des consignes. Les emplois davantage automatisables sont ceux dont le rythme de travail n’est pas imposé par une demande extérieure exigeant une réponse immédiate et qui consistent à appliquer strictement des consignes. » - France Stratégie
Louis Royer
Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n° 63 du 10 août 2016
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *