Article précédent

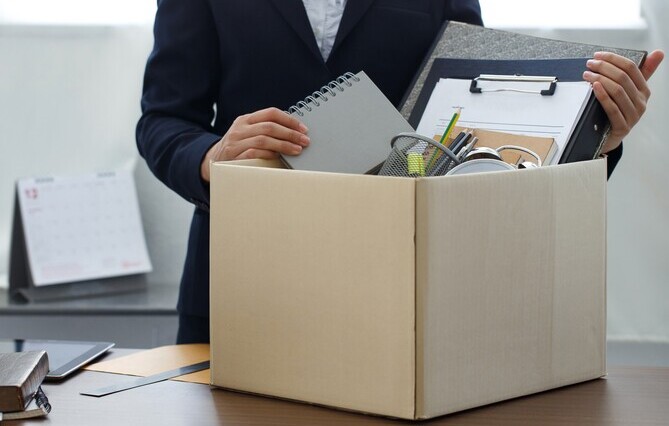
Mise
en place par l’ordonnance du 22 septembre 2017, la grille plafonnant les
indemnités prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était
jusqu’à très récemment boudée par deux cours d’appel, qui continuent, par
d’autres méthodes, à la détourner.
Sept
ans après sa mise en place, le barème Macron est-il transgressé par les
instances judiciaires ? « Certains tribunaux font de la résistance »,
assure François Hubert, avocat en droit social chez Voltaire Avocats.
Certaines
cours d’appel semblent en effet permettre aux salariés de contourner l’ordonnance
du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail ayant introduit, par un article
L. 1235-3 du Code de travail, un barème des indemnités de
licenciement sans cause réelle et sérieuse (hors licenciements graves pour
harcèlement moral, sexuel, discrimination ou violation d’une liberté
fondamentale, qui seraient considérés comme un licenciement nul). Après la
signature de cette ordonnance, « un certain nombre d’oppositions se
sont levées pour contester son application », rappelle François
Hubert.
Des
juges français avaient en effet immédiatement écarté ce barème, sur le
fondement de l’article 10 de la Convention
158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui
impose lorsqu’un versement est jugé injustifié par un tribunal de procéder au
« versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation
considérée comme appropriée », et de l’article 24 de la Charte
sociale européenne révisée, qui donne le droit aux « travailleurs
licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation
appropriée ».
Cette
contestation a connu diverses décisions judiciaires : saisi par des députés,
le Conseil constitutionnel avait considéré le 29 mars 2018 que le législateur avait
« poursuivi un objectif d’intérêt général ». La Cour de
cassation a confirmé à plusieurs reprises cette décision depuis, estimant qu’un
tel barème était, au contraire des décisions initiales, compatible avec les
textes de l’OIT et de la Charte sociale européenne.
Mais
certaines juridictions et instances ont tout de même continué de s’y attaquer,
comme le Comité européen des droits sociaux qui, dans
une décision non contraignante en 2022, avait considéré que « des
plafonds d'indemnisation fixés par l'article L.1235-3 du Code du travail ne
sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et
être dissuasifs pour l'employeur ».
Deux
cours d’appel plus « généreuses » que les autres
En
février 2024, une étude mesurant l’impact du barème à partir de plus de 268 000
arrêts de cour d’appel a relevé une baisse globale de l’indemnisation de base, qui
est passée en moyenne de 7,9 mois avant la réforme à 6,6 mois de salaire brut
après l’entrée en vigueur du plafonnement des indemnités.
Mais en plus de cette indemnité « initiale » s’ajoutent des indemnités « secondaires ». Et après l’addition de ces deux montants, la baisse du montant total d’indemnisation a été effacée. « Les juges ont compensé la diminution de l’indemnité de licenciement en accordant plus facilement d’autres indemnités aux salariés », analyse Anne Vincent-Ibarrondo.
À lire aussi : Licenciement : la menace du pénal prend-elle le dessus ?
En
regardant les décisions, le cabinet Voltaire Avocats a déterminé que les cours
d’appel de Douai et de Grenoble ont à plusieurs reprises écarté le barème
Macron.
Dans
une décision du 21 octobre 2022, la cour d’appel de Douai décidait de ne pas
respecter cette disposition, considérant qu’au vu de la situation particulière
du salarié – âgé de 55 ans, père de huit enfants dont trois encore mineurs et
avec des emprunts en cours –, l’application du barème ne permettait pas une
indemnisation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi. 30 000
euros de dommages et intérêts avaient ainsi été alloués au salarié licencié,
soit 6 000 euros de plus que ce que le barème prévoyait.
Le 16
mars 2023, c’est cette fois la cour d’appel de Grenoble qui décidait d’écarter
le barème, se fondant sur « l'absence d'examen à intervalles réguliers
par le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, des
modalités du dispositif d'indemnisation ».
Les
entreprises ne sont pas inquiètes
Un
non-respect qui a, dans le cas de la décision de la CA de Douai, été cassé par
la Cour de cassation, laquelle, le 7 mai dernier, a rappelé que « la
loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse »,
tout en réaffirmant que le barème Macron était compatible avec la
convention 158 de l’OIT. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel
d’Amiens.
« Il
y a une inégalité de traitement entre les salariés, car la plupart des cours
d’appel de France appliquent ce barème, assure François Hubert. Si on
est salarié ou entreprise relevant du ressort juridictionnel des cours d’appel
de Douai ou de Grenoble, on a affaire à une incertitude compte tenu de leur
position dissidente. »
Une conséquence à l’exact opposé de l’intention initiale de la réforme : « L’application du barème Macron avait notamment pour objectif de faciliter les entreprises, lorsqu’elles envisageaient un licenciement, d’évaluer le risque encouru en cas de remise en cause de ce licenciement. » Pour autant, on ne peut pas dire que cette situation fasse peur aux entreprises, estime l’avocat : « Les quelques décisions rendues en dissidence avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sont très limitées. »
Certains
salariés ayant fait l’objet d’un licenciement pourraient toutefois être tentés
par le fait de multiplier les demandes pour espérer obtenir un jugement plus
favorable. François Hubert note ici deux types de stratégies pouvant se cumuler
dans un même dossier prudhommal. Sur la rupture du contrat de travail, si la
nullité du licenciement est confirmée, le barème ne s’applique pas, et le
salarié peut être réintégré dans l’entreprise et a droit au versement de
l’équivalent des salaires qu’il aurait dû percevoir entre son renvoi et sa
réintégration. S’il n’y a pas de réintégration, le salarié a droit au minimum à
six mois de salaire.
Mais
« dans des dossiers pour lesquels les salariés ont une ancienneté
limitée, ceux-ci invoquent la nullité du licenciement pour contourner
l’application du barème », assure François Hubert. Une stratégie de
défense relayée par certaines juridictions prud’homales, selon des
constatations de l’avocat. « Il n’est pas rare de voir des décisions de
justice dans lesquelles le licenciement est jugé nul pour permettre
l’allocation de dommages et intérêts de manière plus forte qu’en cas
d’application du barème Macron. »
Des
demandes « plus ou moins sérieuses », estime-t-il, et qui ont
pour conséquences des effets pernicieux, comme l’augmentation des durées de
procédures, la complexification de la défense des entreprises et l’engorgement
des conseils des prud’hommes.
Un
régime relativement souple pour les employés
Les
salariés peuvent aussi cumuler la demande de nullité de son licenciement, pour
harcèlement moral par exemple, avec le fait d’être victime d’autres préjudices
trouvant leur source dans des manquements de l’employeur à différentes
obligations, comme l’obligation de sécurité ou de formation. Le salarié peut
dans ce cadre demander un certain nombre d’indemnités.
L’autre
technique, qui peut aussi se cumuler avec la précédente, est de formuler des
demandes en lien avec l’exécution du contrat de travail. Cela peut-être la
réclamation d’heures supplémentaires ou la contestation de son forfait jour par
exemple. « Cette situation aboutit quelquefois à des montants demandés
à ce titre plus importants que ceux demandés au titre de la rupture du contrat
de travail sur laquelle le barème Macron a vocation à s’appliquer. »
Une multiplication facilitée par un régime probatoire, en particulier concernant les requêtes d’heures supplémentaires et les accusations de harcèlement moral, relativement souple.
En
matière d’heures supplémentaires, la Cour de cassation demande au salarié
d’apporter des éléments capables de prouver les heures supplémentaires qu’il
prétend avoir effectuées, et l’employeur doit apporter des éléments démontrant
que la durée légale du travail a bien été respectée et que les éléments
apportés par le salarié ne sont ni crédibles ni sérieux.
En
matière de harcèlement moral, la jurisprudence considère qu’il faut apporter
des éléments de fait laissant penser que le salarié a été victime de
harcèlement moral. À charge pour l’employeur d’apporter des éléments objectifs
de nature à contredire ces éléments de fait produits par le salarié et montrer
que les décisions prises étaient objectives.
La jurisprudence de la Cour de cassation, qui depuis la fin d’année dernière admet la recevabilité d’une preuve déloyale sous conditions que cette atteinte soit proportionnée au but poursuivi et que la production de cette preuve soit indispensable au succès de la prétention de la partie qui se prévalait de cette preuve illicite, « peut aussi encourager la mise en place de ces dossiers prud’homaux venant complexifier les demandes pour contourner le barème Macron », estime François Hubert.
« L’employeur
doit donc être exemplaire au titre de la rupture comme au titre de l’exécution
du contrat de travail pour éviter d’être exposé à des demandes pécuniaires en
cas de contentieux », synthétise Anne Vincent-Ibarrondo, qui se
demande si le barème pourrait être remis en question lors de prochaines
élections. « Si cela arrive, on aura toujours ce même phénomène de
multiplication des demandes, et les employeurs auront tout perdu puisque le
risque en cas de contentieux sera encore plus élevé. »
Alexis Duvauchelle
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *