Article précédent

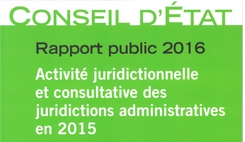
Jean-Marc Sauvé a présenté le 24 mai dernier le bilan de l’année 2015, « marquée par l’état d’urgence ». Le vice-président de l’institution a précisé que le Conseil d’Etat avait eu à connaître de ce sujet « en sa double qualité de conseiller du gouvernement et de juge de l’administration ». La dernière mission du Conseil d’Etat est d’assurer l’administration générale des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Le rapport présente donc aussi des chiffres éclairants, relatifs à leur activité.
« Le Conseil d’Etat a pleinement assumé, en dépit d’une hausse d’activité, ses responsabilités de conseillers des pouvoirs publics et de juge de l’administration. En 2015, les formations consultatives ont examinées 1250 textes, un niveau record depuis 2008 (…) 88 % des principaux textes examinés l’ont été en moins de deux mois ». En introduction de la présentation du rapport annuel public 2016, le vice-président du Conseil D’Etat (CE) Jean-Marc Sauvé s’est également félicité de ce « service public robuste qui réalise avec un haut niveau d’exigence ses missions » et d’ajouter : « innovant, ouvert, il apporte une contribution au débat public ».
En tant que conseiller du gouvernement, le Conseil d’Etat a plusieurs fois examiné des textes visant à combattre le terrorisme. Il s’est d’abord exprimé sur la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Cette loi prévoit plusieurs mesures, telles que l’installation chez les opérateurs de télécommunication de dispositif détectant les comportements suspects à partir des données de connexions. Elle autorise aussi l’utilisation de mécanisme d’écoute comme des logiciels espions ou encore des IMSI-Catchers qui permettent, grâce à du matériel portatif, d’intercepter des communications de téléphones mobiles.
De plus, le Conseil d’Etat a examiné le 16 novembre 2015 un projet de loi destiné à prorogé l’état d’urgence pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre. Il l’a déclaré justifiée « eu égard à la nature de l’attaque et à la persistance des dangers ». Il a aussi estimé que « tant le ressort géographique que les mesures retenues dans le cadre de l’état d’urgence étaient proportionnés aux circonstances ».
Le rapport précise que le Conseil d’Etat a cette année « vérifié que les modifications apportées par le projet à la loi de 1955 sur l’état d’urgence, telles que les contraintes nouvelles assortissant l’assignation à résidence, la dissolution des associations ou groupement et les perquisitions administratives, étaient nécessaires et assorties des garanties suffisantes dans l’encadrement de l’exercice des pouvoirs de police administrative. »
La disposition très décriée qui devait étendre la déchéance de nationalité aux personnes « nées françaises » a elle aussi fait l’objet d’une analyse de la part du Conseil d’Etat. Selon lui, cette mesure « répond à un objectif légitime consistant à sanctionner de façon solennelle les auteurs d’infraction si graves qu’ils ne méritent plus d’appartenir à la communauté nationale ».
« Pour chaque texte, le Conseil d’Etat a veillé à la sécurité des dispositifs envisagés, à la garantie des libertés et des droits fondamentaux et au respect des compétences du juge judicaire », a expliqué Jean-Marc Sauvé lors de la conférence de presse de présentation du rapport public 2016.
Après deux avis de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2014, un projet de loi a créé des associations professionnelles nationales de militaires (APNM). Le Conseil d’Etat a eu à connaitre de cette modification importante du statut des militaires. Cette réforme exclue tout droit syndical et déroge en partie à la loi du 1er juillet 1901. Pourtant, il a estimé « que le projet de loi, en soumettant ces associations à des restrictions spécifiques, assurait une conciliation équilibrée entre, d’une part, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et la nécessaire libre disposition de la force armée et, d’autre part, la liberté d’association ».
En tant que conseiller du gouvernement, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur beaucoup d’autres sujets : le projet de loi « Pour une République numérique », la lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts, ou encore la réforme budgétaire des collectivités territoriales pour le domaine des finances publiques.
II. Juger
Durant cette année marquée par l’état d’urgence, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur des assignations à résidence. L’institution a tout d’abord considéré que le recours contre une telle mesure justifiait que le juge des référés se prononce en urgence. En raison des restrictions que l’assignation à résidence cause à la liberté d’aller et venir, cette saisine du juge se fera dans le cadre d’une procédure de référé-liberté. En ce qui concerne la possibilité pour le ministre de l’Intérieur de prononcer une telle privation de liberté, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil Constitutionnelle une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article de la loi du 3 avril 1955.
Toujours dans le domaine de l’état d’urgence, l’institution a estimé que « le juge administratif exerce un entier contrôle de proportionnalité sur des mesures d’assignation à résidence. Dans le cadre du référé-liberté, le juge doit rechercher à la fois si le principe même de l’assignation, compte tenu des motifs retenus par l’administration, est manifestement illégal, et si les modalités de l’assignation (obligation de présentation régulière aux forces de police, obligation de maintien à domicile à certaines heures…) ne portent pas une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ».
Dans le cadre de ce contrôle de proportionnalité, le juge des référés de Lille a par exemple suspendu une assignation à résidence avec une ordonnance du 22 décembre 2015. Il a jugé que, au vu des éléments présentés par le ministre de l’Intérieur, la mesure prise portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. Dans d’autres décisions, comme celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2015, le juge des référés a pu aussi estimer que « l’assignation à résidence n’apparaissait pas manifestement illégale dans son principe ». « Il a alors vérifié que ses modalités ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir : quand tel était le cas, les juges des référés ont ordonné une modification des modalités de l’assignation », précise le document.
Pour Jean-Marc Sauvé : « L’état d’urgence conduit à donner, pendant une période limitée, des pouvoirs accrus à l’administration. Il ne signifie l’effacement ni de l’État de droit ni de la garantie des libertés fondamentales ».
Le problème de la jungle de Calais n’est toujours pas résolu. Après une évacuation partielle du bidonville en février dernier, les questions sanitaires et de dignité sont toujours d’actualité, mais pas seulement. Jeudi 26 mai, en fin d’après-midi, une trentaine de migrants ont été blessés dans une rixe qui a opposé environ deux cents personnes, essentiellement des Afghans et des Soudanais.
Le bilan d’activité du Conseil d’Etat explique qu’il y a quelques mois déjà, « à la demande d’associations et de migrants, le juge des référés du tribunal administratif de Lille (TA Lille, 2 novembre 2015, Association Médecin du monde et autres, n°1508747) avait ordonné à l’État de procéder, dans un délai de 48 heures, au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département du Pas-de-Calais en vue de leur placement. Il avait également ordonné à l’État et à la commune de Calais de commencer à mettre en place, dans les huit jours, diverses mesures d’hygiène publique et, enfin, de créer des accès pour les services d’urgence ». Le document ajoute : « Saisi en appel dans le cadre de la procédure de référé liberté, le juge des référés du Conseil d’État a confirmé cette ordonnance. Il a notamment estimé que les conditions de vie étaient de nature à exposer les migrants vivant sur le site à des traitements inhumains ou dégradants ».
Face à la concurrence des chaînes d’information gratuites telles que BFM ou Itélé, LCI, une chaîne du groupe TFI, avait déposé une demande d’agrément pour passer à une diffusion sur la TNT. A l’époque, le refus du CSA avait largement indigné les salariés de la chaîne dont l’emploi était menacé, ainsi que les dirigeants eux-mêmes. Le Conseil d’État les a soulagés. L’institution a en effet annulé les deux décisions du CSA pour un motif de procédure. Le bilan d’activité explique : « leurs études d’impact n’avaient été publiées qu’en même temps que les décisions elles-mêmes, alors qu’il résulte de la loi que ces études doivent être publiées avant que le CSA ne prenne ses décisions.
Dans le cadre de son rôle de juge, le CE a rendu beaucoup d’autres décisions. Extrêmement varié, le contentieux concerne les collectivités territoriales, la santé publique, les élections présidentielles, l’urbanisme et même le football ! Chargée d’une mission de service public, les décisions de la ligue de football professionnel peuvent faire l’objet de contestation devant le CE. (...)
Victor Bretonnier
Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n°47 du
15 juin 2016
S’abonner au journal
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *