Article précédent
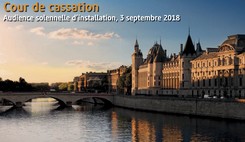
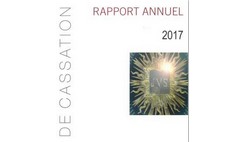
Le Premier président ainsi que le procureur général près la Cour de cassation ont remis, le 27 juin dernier, leur rapport annuel édition 2017 au Président de la République et à la garde des Sceaux. L’occasion de faire le point sur les chiffres et décisions phares de cette édition passée.
Dans son rapport annuel présenté en juin dernier à l’Elysée, la Cour de cassation le souligne : après un léger infléchissement constaté les trois années précédentes, le nombre d’affaires nouvelles est reparti à la hausse (plus de 8 %) en 2017.
Si un peu plus de 28 000 affaires ont ainsi été jugées sur 30 000 affaires enregistrées, c’est malgré tout 4 % de moins qu’en 2016, et la baisse est particulièrement visible en matière civile. Pas d’amélioration notable non plus du côté des délais moyens de jugement, puisqu’il a fallu attendre en moyenne 196 jours au pénal (deux jours de plus que l’année précédente) pour être jugé, et pas moins de 414 jours au civil – chiffre qui accuse toutefois une légère baisse.
Réforme du traitement des pourvois : le filtrage
Dès septembre 2014, la Cour de cassation avait
indiqué réfléchir à la modification des modalités de traitement des pourvois en
cassation, pour se calquer sur les modèles européens (notamment allemand,
autrichien, suisse ou encore espagnol), et avait institué une commission
chargée d’étudier les évolutions envisageables des modalités de traitement des
pourvois. Après deux ans de consultations, le président Jean-Paul Jean avait
remis son rapport en mars 2017, dans lequel il préconisait notamment le recours
au filtrage. Cette proposition a été transformée en « projet de
dispositif opérationnel » par Bruno Pireyre, nouveau directeur du
Service de documentation, des études et du rapport (SDER) – lequel prévoit que
le pourvoi en cassation est soumis à autorisation préalable, délivrée « en
fonction de trois critères alternatifs », indique le rapport. Ainsi,
l’affaire doit soulever « une question de principe présentant un
intérêt pour le développement du droit » ou « une question
présentant un intérêt pour l’unification de la jurisprudence », ou
bien elle doit présenter « une atteinte grave à un droit
fondamental ».
À noter que la valeur financière du litige n’est pas prise en compte,
contrairement aux mécanismes prévus par la plupart des cours suprêmes
européennes.
But affiché de cette sélection : « en jugeant moins (...), juger mieux », précise le rapport.
Ce dernier vise, dans un premier temps, uniquement les quelque 20 000 pourvois civils formés chaque année, « dont 75 % sont voués à l’échec », explique la Cour. Ce dont s’était justifié Bertrand Louvel dans une tribune publiée en mars dernier, affirmant que la majorité des pourvois « ne présentent pas de moyen sérieux de cassation, le justiciable tent[e] trop souvent d’obtenir devant un troisième juge ce qu’il n’a pu convaincre le premier juge et le juge d’appel de lui accorder ». La Haute juridiction envisage ainsi une « réduction de 55 à 60 % du nombre d’arrêts rendus au terme d’un examen complet de l’affaire », soit 8 200 à 9 300 décisions.
Le projet, notamment accusé de constituer une entorse aux règles du procès équitable, reste, à ses yeux, « conforme aux principes constitutionnels » et « conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », assure-t-elle dans son rapport.
Elle estime en outre que cela permettra un « traitement renforcé des dossiers », un « enrichissement de la motivation des arrêts » et du « sens de la portée de la décision », mais aussi plus de prévisibilité et de sécurité juridique. « Les cours suprêmes qui, au cours de ces quinze dernières années, ont adopté de tels dispositifs de filtrage des pourvois, sont précisément celles de pays reconnus pour la haute qualité de leur droit et la forte fiabilité de leur justice mises en évidence par les évaluations périodiques du Conseil de l’Europe et les enquêtes d’opinion », indique en outre le rapport.
Zoom sur les décisions ayant marqué 2017
Parmi les décisions importantes rendues au cours de l’année 2017, on note un arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2017 (pourvoi n° 15-25.65), par lequel la chambre mixte retient qu’en présence des éléments matériels caractérisant la responsabilité du fait des produits défectueux, le juge du fond est tenu d’en examiner d’office l’applicabilité au litige.
Autre décision importante, celle du 4 mai 2017 (pourvoi n° 16-17.189), émanant cette fois de la première chambre civile, qui affirme l’impossibilité de l’inscription d’un « sexe neutre » à l’état civil, la loi française ne permettant pas en l’état de faire figurer dans les actes d’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.
Pour sa part, la troisième chambre civile a précisé le domaine d’application de la garantie décennale des constructeurs en matière d’éléments d’équipement dans trois arrêts rendus les 15 juin, 14 septembre et 26 octobre 2017. Cette dernière a en effet jugé que tous les dommages qui affectent les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination, relèvent de la responsabilité décennale.
Du côté de la chambre commerciale, financière et économique, on peut souligner deux arrêts du 12 juillet 2017 qui viennent établir qu’en présence de contrats interdépendants, la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre, aucun d’entre eux n’étant le principal ou l’accessoire de l’autre - une clause stipulant une indemnité de résiliation étant inapplicable. (Pourvois numéro 15-23.552 et n° 15-27.703), tandis qu’un arrêt cette fois de la chambre sociale du 21 septembre 2017 (pourvoi n° 16-25.531) est venu affirmer qu’un syndicat ayant perdu sa représentativité ne pouvait s’opposer à la révision d’un accord d’entreprise qu’il avait négocié.
Quant à la chambre criminelle, cette dernière est notamment revenue sur la motivation des peines correctionnelles dans un arrêt du 1er février 2017 (pourvois n° 15-84.511, 15-83.984 et 15-85.199), pour affirmer l’obligation générale de motivation de la peine correctionnelle et fixer les trois critères généraux que le juge doit prendre en compte : gravité des faits, personnalité de l’auteur et situation personnelle de celui-ci.
Des QPC moins nombreuses, surtout au pénal
Comme l’indique la Cour de cassation dans son rapport, « Toutes chambres confondues, le nombre de décisions rendues sur Question Prioritaire de Constitutionnalité (257) est revenu en 2017, à un niveau comparable à celui de 2015 (229 décisions) et en net retrait par rapport à l’année 2016, laquelle a connu une forte augmentation (476) due à des causes conjoncturelles. »
Rappelons qu’avec ce mécanisme, tout justiciable peut, au cours d’une instance judiciaire, invoquer l’inconstitutionnalité d’une disposition législative – question transmise par le juge du fond à la Cour de cassation puis au Conseil constitutionnel, si elle porte bien sur une disposition législative applicable au litige ou à la procédure, ou constituant le fondement des poursuites, et si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.
On observe également qu’en 2017, comme en 2016 d’ailleurs, davantage de QPC ont été enregistrées en matière civile qu’en matière pénale. Une tendance qui s’est inversée au fil des années, puisque « depuis la création de cette procédure en 2010, la matière pénale était le terrain privilégié des QPC », rappelle la Cour. En l’occurrence, cette année, la Haute juridiction a eu à connaître notamment des délits d’ « entreprise individuelle terroriste » et de consultation habituelle de sites terroristes. Au civil, la Cour a eu à se prononcer sur des questions relatives à la limitation par le législateur de la possibilité d’obtenir du juge judiciaire la démolition des constructions édifiées en vertu d’un permis de construire, ou encore l’application de la législation sur les procédures collectives aux agriculteurs personnes physiques exclusivement.
Au titre de ses solutions inédites, notamment, la Cour, après avoir rappelé que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition », a établi une distinction nouvelle entre la notion d’ « interprétation jurisprudentielle » – adossée à une disposition législative – et celle de « construction jurisprudentielle » – qui ne peut, elle, être contestée par voie de QPC. Elle s’est également prononcée à plusieurs reprises sur la notion de « changement des circonstances », justifiant le réexamen par le Conseil constitutionnel d’une disposition déjà déclarée conforme en raison de l’intervention d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme ou d’une décision du Conseil constitutionnel.
Obstacles juridiques : quelles propositions de la Cour ?
Le Premier président et le procureur général, habilités à faire part au garde des Sceaux d’améliorations permettant de faire face aux difficultés juridiques à l’occasion d’un pourvoi, ont formulé plusieurs propositions inédites, à l’instar de l’harmonisation des sanctions du défaut d’information de la caution prévues par le Code de la consommation et le Code monétaire et financier. La Cour a également envisagé l’ouverture d’une « passerelle » entre les actions en ouverture d’une mesure de protection d’un majeur et les demandes d’habilitation familiale, ainsi que la création d’un statut de traducteur assermenté distinct de celui des experts judiciaires, et a proposé d’aligner la prescription en matière de copropriété sur la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières.
En revanche, plusieurs propositions formulées en 2016 n’ayant pas trouvé d’écho en 2017, la Haute juridiction a réitéré, entre autres, sa volonté d’une extension de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, l’alignement de la prescription en matière d’assurances sur celle applicable aux actions personnelles ou mobilières, l’amélioration de l’indemnisation de toutes les victimes d’accidents et l’application de l’indice légal de revalorisation des rentes indemnitaires, ou encore, en matière de droit du travail, la mise en conformité du droit interne avec les règles du droit communautaire s’agissant de l’acquisition des droits à congé payé par un salarié en situation de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, de congé maladie, ou ayant commis une faute lourde.
Bérengère Margaritelli
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *