Article précédent
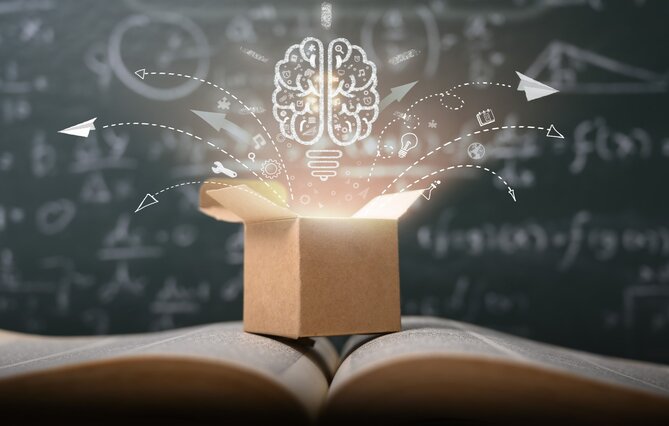

Alors que les Jeux Olympiques de Paris touchent à leur fin ce dimanche, et à l'approche des Jeux Paralympiques, se pose la question du cadre juridique des compétitions sportives. Quel est le régime qui s'applique aux compétiteurs ? Les magistrats de cassation se sont interrogés dans la Lettre de la Cour. Peut-on considérer dans la boxe un « aménagement des violences volontaires », ou dans le foot la « tentative de vol » du ballon par le joueur qui dribble ?
En sport, la responsabilité pénale, souvent constituée par une intention ou une imprudence de l'auteur, peut se cumuler avec la responsabilité civile (dès qu'un dommage est avéré), auxquelles peut s'ajouter la responsabilité disciplinaire (transgression du règlement fédéral ou olympique) des sportifs, explique Laurent Fellous, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit du sport. Outre la responsabilité personnelle du sportif, celle des organisateurs est souvent reconnue par la justice.
Lors d'une compétition officieuse entre
deux lutteurs de catégories différentes, un des adversaires est victime d'une
tétraplégie. Le 16 mai 2018, les juges de cassation ont retenu que
l'association organisatrice (affiliée à la Fédération française de lutte) était
tenue par une obligation de sécurité. Cette obligation, qui n'était que de
moyens, devait cependant être renforcée par les organisateurs à cause de la
différence particulière de niveaux entre les deux athlètes, causant
manifestement un risque plus important de blessures.
Tel n'est pas sans rappeler l'actualité
de ces olympiades avec le match opposant la boxeuse Angela Carini qui a jeté
l'éponge face à son adversaire algérienne Imane Khelif. Une partie du
Gouvernement Meloni accuse en effet les organisateurs d'avoir autorisé un
combat inéquitable, jugeant la compétitrice trop virile malgré son
appartenance à la même catégorie.
À un rang supérieur des clubs, les
fédérations sont-elles responsables pour n'avoir pas suffisamment précisé les
règles de protection des athlètes ? « Concernant
les fédérations sportives, dont le rôle principal consiste à réglementer et à
superviser les pratiques sportives, leur responsabilité peut également être
mise en cause lorsque les règlements qu'elles édictent sont insuffisamment
précis quant à la protection des athlètes. » selon Laurent Fellous, qui ajoute qu'« une carence
dans les prescriptions de sécurité peut être considérée comme une négligence de
la part de la fédération, qui engendrera une responsabilité pour faute. Les
victimes d'accidents ou de blessures survenus en raison de règlements imprécis ou
inadéquats peuvent ainsi invoquer cette négligence pour obtenir
réparation. »
Qu'en est-il alors de la protection des
boxeurs par le port du casque intégral ? Aux JO de Paris, les boxeurs
n'ont pas de casques. Ils ont en effet été supprimés lors des jeux de Rio pour
les hommes depuis 2016. « Pour les matchs amateurs et les combats
féminins, l'obligation du casque vise à minimiser les risques de blessures. »
En revanche, pour les épreuves olympiques masculines, la décision, selon les
déclarations de l'organisation de la boxe amateur International Boxing
Association (AIBA), a été prise « pour des raisons de sécurité ».
Selon une étude de l'AIBA, même si cela pouvait paraître contre-intuitif, les
arbitres devaient interrompre les matchs pour des blessures à la tête (et donc
des commotions cérébrales potentielles) plus souvent lorsque les boxeurs
portaient un casque. Cependant, l’étude de référence ayant été uniquement
réalisées sur des échantillons masculins, les femmes sont toujours soumises à
l’obligation du port du casque lors des jeux olympiques. Cette différence
soulève néanmoins des questions de cohérence réglementaire et d'égalité de
traitement qui pourraient être sujettes à débat juridique, déclare Laurent
Fellous, « notamment en ce qui concerne le principe d'égalité devant la
loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789. »
L'avocat poursuit sur la responsabilité
des organisateurs en général : « En droit de la responsabilité civile
délictuelle, on considère que tout fait volontaire (y compris l’abstention ou
la négligence) ayant eu un rôle dans la survenance du dommage (ex. la blessure
du participant), et que n’aurait pas commis dans des circonstances analogues
l’organisateur d’un événement normalement diligent, constitue une faute. La
responsabilité de la fédération pourrait alors être engagée sur ce
fondement. » Les associations sportives, parce qu'elles ont, dans le
cadre de leurs activités, pour mission d'organiser, de diriger, de contrôler
l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent dès
lors qu'un préjudice est avéré, tel que jugé pour un fait générateur du dommage
indéterminé dans une mêlée de rugby (29 juin 2007, Ass. Plén.).
Seule la faute de la victime et le cas de
force majeure peuvent exonérer l'association sportive de cette responsabilité
précise la Cour à cette occasion. En revanche, la violation de la règle du jeu
par le sportif ne dégage pas pour autant le club de sa responsabilité vers
ledit sportif seul.
Pour que la victime participant à une
compétition soit indemnisée, le fait générateur doit consister en une violation
des règles du jeu par le concurrent (C.Cass 2ème, 13 Jan. 2005). Sur le terrain de la
responsabilité civile, une distinction doit être opérée entre les violences
volontaire et involontaire. La première peut impliquer une sanction (C.Cass. 2ème, 5 décembre 1990),
mais uniquement si elle est commise en dehors du règlement selon le juge civil
(C.Cass. 2ème chambre 8 avril 2004 OM c/Nantes). Si
elle est involontaire, la faute doit présenter un certain niveau de gravité,
propre au droit du sport, pour obliger à indemnisation.
Ces règles du jeu « ne sont-elles
pas supérieures aux règles du droit ? » interroge Xavier
Tarabeux, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il
est admis que les droits humains qui relèvent du sport, seraient, du fait de
leur reconnaissance universelle, supérieurs aux règles de droit, selon le
haut-magistrat. Une telle importance accordée aux règles du jeu, dans la
hiérarchie des normes, ne tient-elle pas au fait que ceux qui en acceptent les
contraintes, le font librement ? C'est la question que pose Vincent
Vigneau, Président de la chambre commerciale de la Cour de cassation. C'est en
effet l'adhésion du sportif aux règles du jeu qui fait que le comportement du
footballeur ou du rugbyman n'est pas punissable. Asséner un coup de poing n'est
autorisé que sur le ring. Effectuer un plaquage n'est légal que dans le stade.
Selon le principe specialia generalibus derogant tiré du droit romain, la règle particulière déroge à la règle générale. Le droit du sport est légitimement dérogatoire du régime classique parce qu'il constitue une exception sans laquelle la pratique sportive serait impossible. Cette exception n'est pas sans encadrement puisqu'il existe des règlements établis par les instances fédérales et olympiques.
Mais pour ce qui relève de la
responsabilité pénale du sportif, les précisions viennent du juge de cassation.
Xavier Tarabeux explique que c'est le comportement violent qui dépasse le geste
sportif sur lequel repose la compétition qui est considéré comme une
infraction. Il prend aussi l'exemple de la triche, par laquelle, « un
accroissement artificiel des capacités physiques aura rompu l'égalité entre les
concurrents ». Le dopage, notamment, est sanctionné par les fédérations,
mais aussi par le juge de droit commun.
Pour que l’acceptation des
risques du jeu soit un fait justificatif (élément exonératoire de la
responsabilité pénale), la jurisprudence exige que le
dommage intervienne à l'occasion d'une compétition sportive (C.Cass 2ème
ch. 4 nov. 2010), excluant
ainsi l'entrainement de son champ d'application, sauf, comme relaté plus haut,
le cadre des compétitions non officielles.
Laurent Fellous précise qu'« afin
de qualifier ou non un geste de violence au regard du droit pénal, il va
falloir effectuer une délimitation entre les gestes autorisés et les gestes
interdits. Celle-ci est plutôt simple à opérer lorsqu'ils surviennent en dehors
du jeu ». L'avocat cite l'exemple de la faute commise avant le coup
d'envoi ou après le coup de sifflet final (Amiens, 21 sept. 2007 et Pau, 16
mars 2006), ou pendant la mi-temps (Paris, 2 déc. 1967). « De même, les
violences sans rapport avec le jeu sont facilement identifiables et punissables. »
Par exemple, le footballeur qui plaque un de ses adversaires (Montpel., 24
sept. 1992). Dans ces cas, on pourra constater la commission d'une violence
conformément au droit pénal.
L'adhésion du sportif aux risques
entrepris au cours d'un combat permet à son adversaire, auteur de la blessure, de ne pas être sanctionné pour violence, à condition de ne pas commettre
volontairement la blessure. Le juge pénal ne peut qualifier la violence que si
l'athlète a commis intentionnellement la faute (C.Cass, Crim. 1er
juin 1999). Laurent Fellous explique aussi que pour
établir une infraction pénale au sein du jeu, il faut établir « une faute
contre le jeu », c'est-à-dire un geste brutal ou déloyal (C.Cass. 2ème
28 jan. 1987) ou une prise anormale de risque appréciée concrètement. « Cependant,
dans le cadre sportif, les tribunaux font preuve d'une certaine bienveillance à
l'égard des athlètes en retenant régulièrement la qualification de blessures
involontaires avec l'approbation de la Cour de cassation (Crim. 24 janv. 1956, 25
mars 1980 et 16 oct. 1984). » conclut Laurent Fellous. Lorsqu'il est
difficile d'établir une intention, au-delà de la qualification pénale de
blessures involontaires, c'est plus classiquement la responsabilité civile
seule qui joue à ce stade.
Antonio
Desserre
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *