Article précédent
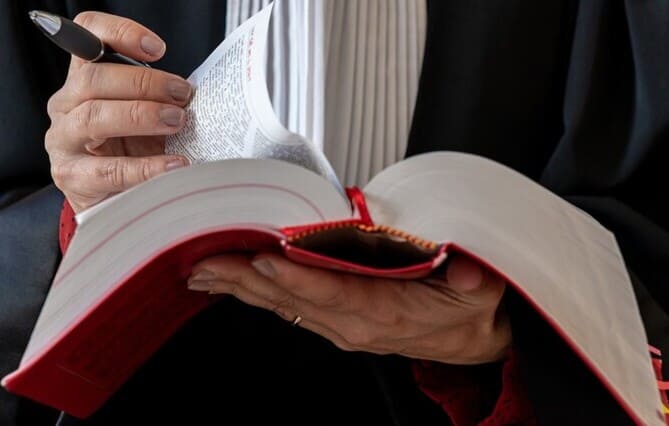

En France, les femmes représentent encore moins d’un tiers des chercheurs scientifiques et ce chiffre stagne ces dernières années. La délégation aux droits des femmes du Sénat s’est mise en quête d’explications et de solutions pour conjurer cette sous-représentation historique.
Ce
n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, récent et emblématique. Pendant le
sommet pour l’action sur l’IA qui s’est tenu à Paris début février, un
baromètre européen a fait ressortir que les femmes représentaient seulement 25 % des effectifs travaillant
dans ce secteur d’avenir en France, et plus généralement en Europe.
Une
révolution scientifique et technologique qui se construit sans sollicitation ou
contribution égale de la moitié de l’humanité… Le constat n’est pas nouveau.
Alors que les femmes demeurent sous-représentées dans les carrières et domaines
scientifiques, la délégation aux droits des femmes du Sénat a décidé de se
pencher sur les solutions à apporter pour plus de filles et de femmes dans les
sciences.
Le
13 février dernier, pour le lancement de sa mission transpartisane qui
débouchera sur un rapport d’information, la délégation a entendu des membres de
l'Académie des sciences au sujet d’un rapport intitulé « Sciences : où
sont les femmes ? », publié en juin 2024.
Accompagner les enseignantes
qui ont « une dent contre les sciences »
Devant
les sénatrices, les membres de l’Académie ont tenu à rappeler le décrochage
inquiétant, car précoce, des filles en sciences par rapport aux performances
des garçons. Une tendance observée ces 20 dernières années dans les grandes
évaluations de performance scolaire, au premier lieu rang desquelles l’enquête PISA et plus récemment TIMSS.
« Il suffit de quelques mois seulement pour que ce décrochage ait lieu : il se situe entre le début du CP, le milieu du CP, le début du CE1. Le phénomène se produit dans tous les contextes sociaux, territoriaux et familiaux. Pour l’instant, nous ne disposons pas d’explications scientifiquement étayées. Des études restent à faire », explique Laure Saint-Raymond, mathématicienne et professeure des universités à l'ENS de Lyon.
À lire aussi : La Cour des comptes dresse un bilan « décourageant » des inégalités de genre à l’entrée dans le monde professionnel
En attendant, l’hypothèse
privilégiée est celle d’un biais de genre chez les professeures des écoles. Les
femmes représentent en effet plus de 80 % des enseignants du premier degré,
mais 10 % d'entre elles seulement ont une formation scientifique. « Beaucoup n'ont pas fait de sciences depuis
le lycée, et certaines ont même un petite dent contre les sciences »,
résume Laure Saint-Raymond. Un déficit de formation « qui risque de transmettre une image négative des sciences aux élèves et
tout particulièrement aux filles », souligne quant à lui le rapport.
À ce titre, l’Académie invite
à renforcer la formation scientifique initiale et continue des professeurs des
écoles. L’institution souligne que la réforme envisagée par le Gouvernement sur le chantier de la
formation va dans ce sens. Autre piste de solution : former les
enseignants et personnels de l’éducation aux biais de genre. Car les
stéréotypes infusent partout, jusque dans les bulletins scolaires. « Il ressort
majoritairement des appréciations que les filles travaillent bien et sont au
maximum de leur potentiel, quand les garçons en ont toujours sous le pied », détaille par exemple
la mathématicienne.
Rendre les carrières scientifiques attractives pour les
femmes
« La réforme du lycée et du baccalauréat n’a, pour ainsi dire, rien
arrangé », poursuit la physicienne Jacqueline Bloch. Depuis la mise en
place des choix d’options, les filles se tournent majoritairement vers les
humanités. 45 % des filles de terminale ne choisissent aucun enseignement de
spécialité en sciences, contre 28 % des garçons.
Le serpent continue de se
mordre la queue à l’université, où le nombre de diplômés universitaires place
la France dans la moyenne de l’OCDE, avec seulement 13% des étudiantes
diplômées dans les domaines des Sciences, technologies, ingénieries et mathématiques
(STIM) en 2023, contre 40 % des étudiants.
Cette situation aboutit à ce
qu’en France, les femmes représentent encore moins d’un tiers des chercheurs
scientifiques. Elles sont encore moins nombreuses à occuper des postes à
responsabilité au sein des laboratoires de recherche ou des départements R&D
des entreprises.
Et quand bien même, les
femmes aspireraient à faire carrière, le monde de la recherche, comme le monde
de l’entreprise a-t-on envie de dire, ne prend pas en compte leurs assignations
sociales. La physicienne Hélène Bouchiat, directrice de recherche au CNRS, pointe notamment du doigt « un recrutement de plus en plus tardif, à la
suite de longues années de contrats temporaires avec souvent un passage obligé
à l’étranger », qui décourage les femmes en rendant leurs avancées
professionnelles incompatibles avec leur vie de famille.
Pour améliorer cet équilibre,
l’Académie préconise trois mesures concrètes : le report des dates limites pour
les candidatures en fonction de la durée du congé parental, le recrutement
précoce et continu dans des postes juniors pour intégrer les jeunes scientifiques
dans des équipes, et le soutien aux jeunes parents par des décharges
d’enseignement ou une aide technique au laboratoire.
Quotas :
une fausse bonne idée ?
Faut-il en passer par des
quotas ? s’interrogent aussi les élues qui ont vu progresser grâce à eux la
place des femmes en politique. Dans son rapport, l’Académie indique que ce
système présente « des intérêts
notables » et observe que dans ses rangs un grand nombre
d’académiciennes ont favorablement bénéficié de quotas à l’époque où les écoles
normales supérieures étaient séparées par genre. Mais, note l’institution, « la mise en place de quotas ne résout pas
tous les problèmes et peut générer des frustrations et encourager un sentiment
d'illégitimité ».
Cette politique est surtout
difficile à mettre en place en l’absence de vivier. L’équation est simple :
femmes sous-représentées = femmes sur-sollicités. Comme en témoigne Laure
Saint-Raymond.
À
lire aussi : Femmes
de justice fête ses 10 ans : « L’égalité professionnelle est devenue une
véritable politique publique »
« Je suis mathématicienne dans une communauté où je pense qu'on est un
peu moins de 10% de femmes professeures ou directrices de recherche. Et depuis
un certain nombre d'années, pour aider à la représentation des femmes, on
oblige à ce qu’il y en ait dans tous les comités de recrutement, éditoriaux et
de conférences. Concrètement, ça veut dire qu'on travaille dix fois plus que
nos collègues hommes au service de notre communauté scientifique ».
En finir
avec le star system
Plus généralement, les
membres de l’Académie ont souligné à plusieurs reprises devant les sénatrices
la nécessité d’agir sur les représentations. En commençant par remettre en
cause un modèle de réussite très « masculin » : celui du compétiteur individualiste.
« Le stéréotype du chercheur
brillant dont on glorifie les qualités de leader plus que la créativité »,
explicite Hélène Bouchiat.
« De façon générale, il y a à valoriser le travail collectif, parce
qu’une découverte en sciences repose sur un travail d'équipe où chacun a
contribué avec des compétences complémentaires. Et ça, ce n'est vraiment pas
assez mis en avant », déplore la physicienne. Notamment lors des
remises de prix scientifiques qui contribuent au maintien d’un star system.
S’attaquer aussi, de l’autre
côté, aux représentations limitées et souvent inadaptées des femmes
scientifiques dans les manuels scolaires. « On présente aux jeunes filles des modèles extrêmement impressionnants,
Marie Curie étant l'exemple emblématique », rappelle Jacqueline Bloch.
« Mais peu de scientifiques ont eu
deux prix Nobel, nuance la physicienne. Des modèles comme ça, c'est extrêmement
écrasant. Mieux vaut faire intervenir de jeunes scientifiques accessibles dans
les classes, car cela marche bien pour promouvoir ces matières ».
Delphine Schiltz
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *