Article précédent
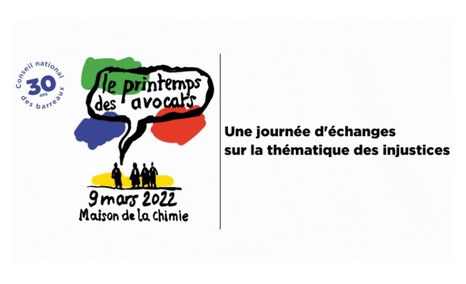

Suzanne
Régnault naît le 18 juin 1914 dans la Meuse, à Varennes-en-Argonne, à la veille
de la Première Guerre mondiale. D’abord notaire, son père, Félix, est juge de
paix depuis 1912. Sa mère, Marguerite Perrin, de nationalité allemande pour
être née à Metz (1), est mère au foyer.
Suite
au déclenchement des combats, la famille est contrainte d’évacuer et n’est de
retour qu’une fois la paix revenue. Suzanne et son frère, Maurice, sont
scolarisés au lycée impérial de Nancy, devenu le lycée Henri Poincarré. Elle et
son frère sont traités de la même manière et tous deux poursuivent des études
juridiques. Après son baccalauréat, elle le rejoint à la faculté de droit où il
étudie depuis l’année précédente.
Une étudiante devenue une
mère de famille
Elle
obtient aisément sa première année mais arrête ses études car à 21 ans, le 18 mai
1935, elle se marie avec François Gousset. Elle met au monde quatre enfants,
trois garçons et une fille, en 1936, 1937, 1939 et 1944. Cependant, son époux
est atteint d’une sclérose en plaques : elle est consciente de la gravité de
son état et de son probable décès précoce, qui arrivera effectivement en 1949.
À
29 ans, Suzanne Régnault-Gousset décide alors de préparer l’avenir, sachant
qu’elle aurait à assumer sa survie économique. Courageuse et pugnace, alors
qu’elle a dix ans de plus que ses camarades de bancs universitaires, elle
s’inscrit en octobre 1943 en deuxième année de droit. Elle obtient une licence
en 1945 et s’inscrit en qualité d’avocate stagiaire au tableau de l’Ordre des
avocats de Nancy, où elle est admise le 30 novembre 1945.
Entre-temps,
son frère Maurice est devenu magistrat. Suzanne y pense aussi, alors que les
temps changent pour les femmes.
Suzanne Régnault-Gousset, Photo de famille
La
première à concourir à un examen réservé aux hommes
Tout au long du XXe siècle, les hommes magistrats sont
nommés, sans processus de sélection formel de leur compétence.
La loi organique du 20 avril 1810 dispose simplement en
son article 64 que « nul ne pourra être juge ou suppléant d’un tribunal de
première instance, ou procureur impérial, s’il n’est âgé de vingt-cinq ans
accomplis, s’il n’est licencié en droit, et s’il n’a suivi le barreau pendant
deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale ».
Le décret du 13 février 1908 crée un examen et précise
qu’il est nécessaire, pour s’y présenter, de remplir les conditions d’âge et de
diplôme, d’accomplir un stage d’un an dans un barreau et de justifier d’un an
de stage au ministère de la Justice ou dans un parquet, ou de deux ans dans une
étude d’avoué.
Cet examen n’est ouvert qu’aux hommes.
Ce n’est qu’à l’issue d’une lente évolution politique et
sociétale, formalisée par une succession de projets rejetés, que finalement, la
loi du 11 avril 1946 permet à « tout Français, de l’un ou de l’autre sexe,
répondant aux conditions légales » d’accéder aux fonctions de la magistrature.
Le garde des Sceaux qui porte cette réforme est
Pierre-Henri Teitgen. Il est de Nancy : son père Henri Teitgen y a été
bâtonnier, lui-même a enseigné le droit à l’université. Il connaît la situation
difficile sur le plan personnel de Suzanne Régnault-Gousset et son mérite.
Certains ont pu penser qu’il avait accéléré la réforme pour elle.
Quoi qu’il en soit, elle est la première à se lancer sans
tarder dans cette nouvelle voie qui vient de s’ouvrir aux femmes. Un mois après
le vote de la loi, le 11 juillet 1946, elle s’inscrit en qualité d’attachée
stagiaire auprès du tribunal civil de Nancy. Elle a 32 ans et se prépare à
présenter les épreuves de l’examen professionnel d’entrée dans la magistrature.
Par arrêté du 12 octobre 1946, 160 candidats sont admis à
subir les épreuves : elle est la seule femme. Sur cette liste, ne figurent que
des noms de famille sans précision du sexe, à l’exception de celui de Suzanne
Régnault-Gousset qui est le seul à être précédé d’un « Mme », soulignant le
caractère exceptionnel de l’événement.
Elle passe les épreuves le 14 novembre, et, par décret du
18 décembre 1946, elle devient la première femme « déclarée apte aux fonctions
judiciaires », 40e sur 57 candidats ayant concouru.
Elle suit donc de près Charlotte Béquignon-Lagarde,
première femme magistrate à la Cour de cassation, par intégration directe en
raison de titre universitaire, ayant prêté serment le 16 octobre 1946 (2).
Magistrate
dans les années 1940/1950
Suzanne Régnault devient d’abord attachée de parquet où
elle se forme au métier. En 1947, elle est nommée juge suppléante auprès du
tribunal de Nancy.
L’arrivée d’une femme est remarquée, et la presse locale
rend compte de cette situation inédite. « Pour la première fois à Nancy, une
femme siège au tribunal correctionnel », « Mme Gousset avait déjà fait
partie du tribunal civil, mais c’est la première fois qu’un magistrat féminin
siégeait au prétoire de la correctionnelle (3). »
« La profession était mal préparée à l’arrivée des
femmes » euphémise son fils (4), qui rappelle qu’à l’époque, une femme devait
être « à la cuisine et au lit », et que « mécontents, les hommes n’ont pas fait
de publicité sur l’arrivée des femmes dans la magistrature ».
Les chefs de cour ne voient pas d’un très bon œil
l’arrivée de Suzanne Régnault-Gousset, et ne font rien pour la mettre en
valeur. Elle ne fait pas carrière, souhaitant simplement rester à Nancy pour
s’occuper de ses enfants. Elle adopte un profil modeste pour se faire accepter,
et exerce son métier avec simplicité et humanité. Elle est souvent désignée
comme assesseure dans les formations correctionnelles collégiales. Jamais
présidente.
Pourtant, Suzanne Régnault-Gousset est une femme
particulièrement intelligente, vive et subtile.
Elle est parfaitement consciente des réticences à
l’entrée de femmes dans la magistrature, qu’elle incarne pour être la première
à s’être soumise aux épreuves. Elle décide d’ignorer les préjugés et de
démentir son frère Maurice lorsqu’il trouve les collègues féminines « pas
sérieuses (5) ».
Sur les photos, sa fine silhouette, sa coiffure soignée,
lui donnent une prestance qui révèle sa personnalité, forcément hors norme pour
avoir eu le panache de se lancer la première dans une profession historiquement
réservée aux hommes. Catholique pratiquante, elle avait foi en l’avenir et a
mobilisé son énergie pour gagner sa liberté. Elle s’est aussi adossée à sa
volonté d’indépendance, professionnelle et financière, ce qui est la marque
d’un esprit d’avant-garde.
En 1950, elle est nommée juge titulaire auprès du
tribunal civil de Lunéville, où elle siège jusqu’à sa fermeture, en 1958. En
1955, Suzanne Régnault se remarie, à 41 ans, avec Jean Fenot, commerçant et
juge au tribunal de commerce de Nancy. En 1959, elle est nommée juge auprès du
tribunal de grande instance de Nancy, où elle effectue le reste de sa carrière.
Le Tribunal de Lunevile en 1953. Suzanne
Régnault-Gousset est assise derrière la chaire à droite
Elle prend sa retraite assez jeune, à 59 ans, en 1973.
Lors de sa dernière audience, le bâtonnier fait son éloge : « Vous avez
beaucoup sacrifié à la cause de la justice. Vous étiez un élément de sécurité
et nous avons toujours apprécié vos qualités de cœur, votre mérite, votre
caractère humain, aussi l’estime du barreau vous était entièrement acquise (6)
».
C’est âgée de 80 ans qu’elle décède le 1er
août 1994, dans la ville où elle a mené à la fois sa vie et sa carrière.
Une
mémoire conservée
La situation de Suzanne Régnault-Gousset est
assez exceptionnelle pour la noter : sa mémoire a été conservée. Contrairement
à Charlotte Béquigon-Lagarde, qui avait disparu de l’histoire de la
magistrature, l’ancrage local a permis l’inscription de son identité sur une
plaque émaillée.
C’est en effet son fils Étienne Gousset,
alors chef du protocole à la mairie de Nancy, qui propose que la ville baptise
une rue de son nom : pas n’importe laquelle, celle du siège de la cour d’appel
de Nancy (7). C’est chose faite en 2005, et depuis plus de 15 ans déjà, son nom
figure sur tous les courriers adressés aux juges nancéens. Afin que nul n’en
ignore !
1) Suite au
traité de Versailles du 26 février 1871 qui met un terme à la guerre avec la
Prusse.
2) Voir son
portrait dans le JSS n° 71 du 6 octobre 2018.
3) Articles
de presse transmis par monsieur Rémi Gousset.
4) Entretien
de l’autrice avec Rémi Gousset, fils de Suzanne Régnault-Gousset, le 24 août
2021.
5) Témoignage familial de Rémi Gousset.
6)
Discours de Monsieur le bâtonnier Pierre Joffroy.
7)
Anciennement dénommée terrasse de la pépinière.
Gwenola Joly-Coz,
Première présidente de la
cour d’appel de Poitiers,
Membre de l’association
« Femmes de justice »
Retrouvez tous les portraits de femmes pionnières, réalisés par Gwenola Joly-Coz
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *