Article précédent
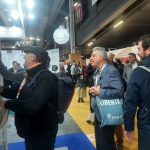
En juin dernier, les magistrats Gwenola Joly-Coz et Eric Corbaux, dont les innovations en matière de VIF sont régulièrement saluées, ont été investis d’une mission par le garde des Sceaux : comprendre et améliorer les pratiques de l’institution judiciaire face aux violences faites aux femmes. Le résultat de ces recherches de terrain, sous forme d’un rapport inédit, a été remis ce 25 novembre à la Chancellerie, Journée internationale de lutte contre la violence faites aux femmes. Pour le JSS, ils décryptent ces travaux.

Journal spécial des sociétés : En quoi consiste cette mission particulière qui vous a été confiée par le garde des Sceaux en juin dernier ?
Gwenola Joly-Coz : Nous avons nous-mêmes orienté cette mission, car nous tenions à ce qu’elle soit centrée sur la question de la confiance, en travaillant plus précisément sur la façon dont les femmes pourraient avoir à nouveau confiance dans la justice. Je les appelle « le peuple des femmes au pied des palais ». Aujourd’hui, il y a beaucoup de choses qui les interrogent et qui les mettent en difficulté : les classements sans suite, mais aussi l’émiettement judiciaire, les règles probatoires…
Il y a des magistrats et des magistrates formidables, engagé(e)s, mais il n’y a pas de parole articulée de la justice. Nous avons produit un rapport très court, conceptuel, simple, avec des évolutions possibles qui ne demandent ni budget ni loi. Un rapport pour aider à penser l’organisation judiciaire : on appelle ça mieux connaître pour mieux juger.
JSS : Avec qui avez-vous travaillé exactement lors de cette mission VIF ? Quels ont été les retours du terrain, sur quels chantiers travailler aujourd’hui ?
Eric Corbaux : Nous avons entendu les responsables des grandes associations et les représentantes des femmes victimes, qui travaillent déjà sur le sujet.
Nos interlocutrices nous ont notamment fait part des inégalités en fonction des territoires : il y a des tribunaux où les choses sont très avancées, et des tribunaux où ça avance moins. Les départs de procureurs, qui mettent en place des dispositifs, qui restent un peu puis s’en vont, provoquent des discontinuités territoriales.
À lire aussi : DOSSIER. Cartographier les VIF pour mieux les juger
Sur le contact même avec l’institution judiciaire : les délais de traitement, la sécheresse des contacts qui manquent parfois d’humanité. Il y a aussi la question du traitement des plaintes, dont les classements ne sont pas toujours suffisamment motivés ou expliqués. La question de la cohérence des décisions de justice est revenue également, notamment en ce qui concerne les enfants et l’exercice de l’autorité parentale.
Des choses très concrètes, en somme, comme la manière d’instruire les affaires à l’audience, l’exercice des droits de la défense, avec les conséquences qu’ils peuvent avoir. Et certaines améliorations possibles concernent des façons de faire très « pratiques » : la victime placée à côté de l’agresseur lors de l’audience, par exemple.
JSS : La mission vous a-t-elle aussi permis d’avoir des retours sur la question de la prise en charge des auteurs de violences ?
G. J-C. : Bien sûr, nous avons eu des retours concernant les auteurs. C’est aussi l’objet des réflexions sur le contrôle coercitif : arrêter de se pencher sur la victime, et interroger l’auteur, son comportement, ses préjugés, la façon dont il justifie ces violences masculines. Nous souhaitons aussi parler, plus que de violences faites aux femmes, de violences masculines. À partir du moment où l’on s’intéresse davantage à « l’homme », il faut aussi repenser à l’homme dans la peine, dans la prison, mais aussi dans la probation, avec la question des stages. Que met-on dans la sensibilisation des auteurs de violences conjugales, comment ces stages sont-ils conçus ? Il faut réfléchir au traitement de l’auteur et à la fin de la peine pour éviter la récidive, c’est l’objectif. Du dépôt de plainte jusqu’à la sortie de détention de Monsieur, c’est un sujet global.

Nous souhaitons aussi parler, plus que de violences faites aux femmes, de violences masculines
Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete
Dans ce qui revient sans cesse, il y a la question de la séparation du pénal et du civil. Beaucoup de gens nous disent : ça n’est plus possible que l’on juge d’un côté le pénal et de l’autre côté, l’aspect familial de la situation. Éric Corbaux appelle ça la justice résolutive de problèmes. Nous pensons qu’il faut absolument que la justice se réorganise pour traiter en même temps les aspects pénaux, c’est-à-dire la violence, et les conséquences familiales de cette violence.
JSS : Pourrait-il être question de développer l’expérience qui avait été menée à Poitiers, en 2024 ?
G. J-C. : L’expérience que nous avons menée à Poitiers s’est en effet poursuivie en 2025, grâce à nos présidents de chambre sur place. Il s’agit d’une innovation juridictionnelle, qui visait à faire en sorte que le même jour, avec les mêmes juges, nous traitions l’affaire pénale et l’affaire civile. Les violences, mais aussi le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, l’autorité parentale, la séparation, les interdictions de contact… Bref, que tout cela soit cohérent. Car ce que nous disent beaucoup les femmes, c’est que parfois, les décisions judiciaires sont incohérentes. Encore plus contradictoire : un juge pénal qui ordonne une interdiction de contact, et un juge aux affaires familiales qui ordonne un droit de visite et d’hébergement. En tout cas, nous avons prouvé que c’était possible et nous avons même obtenu le Prix de l’innovation judiciaire, à Montréal, il y a un an.
JSS : Il est rare que la France inspire le Canada, concernant ces thématiques. On a plutôt tendance à constater l’inverse…
G. J-C. : (Rires) Effectivement, vous pouvez le marquer d’une pierre blanche ! On était assez contents, pour une fois.
JSS : Qu’est-ce qui empêche, aujourd’hui, de généraliser cette façon de faire innovante à l’ensemble de la justice française ? Y a-t-il des obstacles à surmonter ?
E. C. : Il y a une question d’organisation, bien sûr, mais d’abord de volonté. Ce n’est pas simple à mettre en place, mais nous y sommes arrivés, c’est que c’est possible ! Après, il y a quelques résistances, notamment sur l’approche de la question de l’impartialité. Le juge n’aurait pas la capacité de juger de manière impartiale une affaire civile s’il a connaissance de l’affaire pénale. Cette question, qui mérite réflexion, trouvera des solutions, parce qu’on peut aussi travailler sur une proportionnalité repensée, un peu moins théorique et beaucoup plus réaliste. L’impartialité peut être meilleure si le juge est au courant de l’intégralité de l’affaire. Nous avons travaillé avec des barreaux qui ont accepté notre position, reconnaissant l’intérêt d’une décision cohérente, y compris pour les auteurs. Il nous a suffi de bien l’expliquer. Mais il est plus facile de dire que c’est impossible que de dire « je vais essayer » !

L’impartialité peut être meilleure si le juge est au courant de l’intégralité de l’affaire
Eric Corbaux, procureur général près la cour d’appel de Bordeaux
G. J-C. : Tout cela se fait à droit constant. Il n’y a besoin d’aucune révolution juridique pour juger en même temps le civil et le pénal : nous l’avons fait. C’est une question d’organisation interne. La justice, elle-même, que peut-elle faire ? Et c’est bien cela l’objectif de notre rapport.
JSS : Est-ce qu’aujourd’hui, la justice peut également s’améliorer dans le domaine de la prévention des violences intrafamiliales ?
E. C. : La mission de prévention revient au ministère public, certes, et nous y participons, mais elle repose surtout sur tout un écosystème : la société, l’éducation, le sanitaire et le social, les collectivités locales… Notre rôle est d’apporter une réponse judiciaire.
G. J-C. : Si la prévention n’est pas notre mission principale, à nous, l’autorité judiciaire, je pense que la protection est arrivée dans nos offices et aujourd’hui, les citoyennes nous réclament d’être protégées. Comment fait-on pour les protéger et éviter la récidive ? Comment éviter une femme tuée alors qu’on avait tous les signaux de la dangerosité de la situation ?
E. C. : Le développement des mesures de protection est devant nous. On cite souvent les progrès faits en Espagne, un pays pilote en la matière, mais nous proposons aussi une approche catégorique : pour toute femme qui porte plainte, avant même qu’on n’enquête – et tout en préservant la présomption d’innocence – une ordonnance d’éviction et de protection vient sortir le conjoint du domicile. Les bracelets anti-rapprochement et les téléphones grave danger peuvent certainement être plus utilisés, donc oui, il y a une marge de progression sur ces sujets-là.
JSS : A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, est diffusé aussi en complément du rapport, le documentaire Je vais te tuer, réalisé par Karine Dusfour et filmé aux cours d’appel de Poitiers et de Colmar. Pourquoi ouvrir les portes des audiences aux médias ? Que gagne l’institution judiciaire à amplifier sa communication ?
G. J-C. : On a toujours été tous les deux très partants pour communiquer, sinon la justice est une institution sans parole, sans voix. On entend très souvent les avocats, et c’est normal, mais nous pensons que c’est aussi notre rôle. Parler de la justice incombe particulièrement à la hiérarchie, à celles et ceux qui ont une responsabilité. Avec ce documentaire, nous avons voulu apporter une voix judiciaire sur la question des violences faites aux femmes. Faire comprendre de quoi on parle quand on évoque le contrôle coercitif, décrypter les violences masculines, inverser la culpabilité, passe aussi par là.
E. C. : On est dans cette logique, effectivement. Et pour restaurer la confiance en la justice des citoyens, il faut qu’elle s’ouvre et qu’elle explique. D’énormes progrès ont été faits : aujourd’hui, la parole des procureurs est attendue en permanence par les chaînes d’information en continu. Des sessions de formation à la communication sont désormais ouvertes à l’École nationale de la magistrature (ENM). Des émissions filment désormais les audiences et permettent aux téléspectateurs de se rendre compte de ce qui s’y passe, sans y mettre les pieds. Nous avons eu ainsi, avec Mme Joly-Coz, un quatre pages dans Elle, dans nos robes de magistrats. Ces robes-là, ce magazine en avait peu l’habitude !
LIRE AUSSI
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *