Article précédent
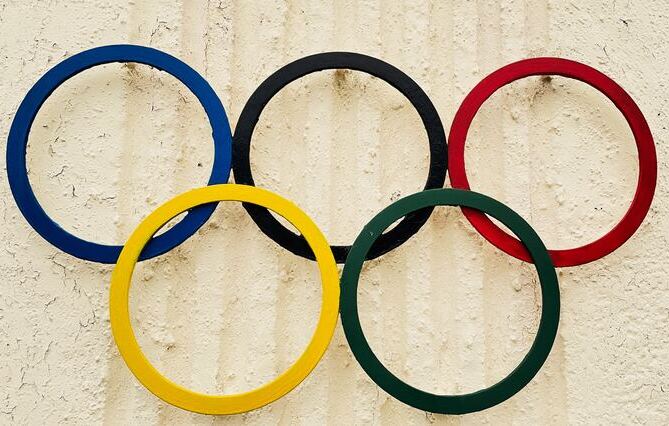
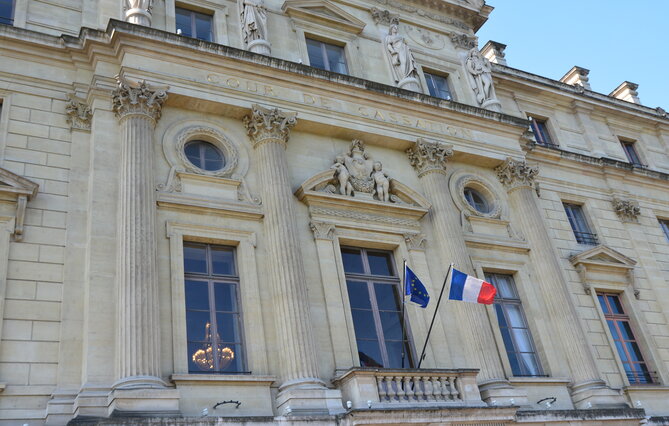
Lors
de la rentrée judiciaire de la haute juridiction, le 12 janvier, le premier
président Christophe Soulard et le procureur général Rémy Heitz ont fait le
point sur les récentes réformes bénéficiant à la justice, et sur les derniers
chantiers et expérimentations menés par la Cour, à l’instar de l’Observatoire
des litiges judiciaires. Des avancées étroitement liées au numérique et à l’IA,
même si ces dernières ne doivent pas faire oublier la « dette technique »
dont souffre la justice.
C’est
comme de coutume au cœur de sa Grand’Chambre richement parée que la Cour de
cassation a procédé à sa rentrée judiciaire, le 12 janvier. « Un
instant traditionnel (...) Un temps fort. Le temps du bilan. Le temps de l’élan »,
a résumé Rémy Heitz avec son sens habituel de la formule.
De
l’élan, car le procureur général l’a rappelé : en 2024, entrent progressivement
en vigueur les dispositions de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la
responsabilité du corps judiciaire et celles de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice pour la période 2023-2027,
dans la continuité des Etats généraux de la Justice.
Des
réformes pour « redonner du souffle » à la justice
Ces
réformes, Rémy Heitz les a qualifiées de « décisives », à
l’instar de la progression du budget de la justice (près de 11 milliards
d’euros) qui doit – en particulier – permettre de recruter 10 000
professionnels, et notamment un certain nombre d’attachés de justice, avec une
distinction, parmi les tâches des greffiers, entre celles qui relèvent de
l’assistance procédurale et celles qui relèvent de l’aide à la décision. Sur ce
point, « les juges devront apprendre à travailler avec cette équipe
renforcée sans déléguer ce qui fait le cœur de leur mission », a
estimé le premier président, Christophe Soulard.
Rémy
Heitz s’est également réjoui de la revalorisation des traitements, destinée à
obtenir une plus juste équivalence entre les magistratures des différents
ordres, et qui devrait « permettre à la France de ne plus figurer en
aussi mauvaise position dans les statistiques [de] la Commission européenne
pour l’efficacité de la justice du Conseil de l’Europe », ainsi que de
la suppression des emplois fonctionnels « hors hiérarchie » au profit
de la création d’un 3e grade. Cet aménagement acte une évolution
vers la séparation du grade et de la fonction pour valoriser la diversité des
compétences des magistrats, « nécessaire » à ses yeux afin de
« répondre aux besoins des juridictions ».
Toutefois,
le procureur général n’a pas manqué non plus de pointer des évolutions « moins
remarquées, mais qui traduisent la défense de valeurs essentielles » :
celles consacrant l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans
les carrières, ainsi que l’égalité à l’égard des magistrats en situation de
handicap.
Le
procureur général a par ailleurs salué « le renforce[ment] des
exigences déontologiques » porté selon lui par la « rénovation »
(critiquée dernièrement
par le délégué général de CFDT-Magistrats, Emmanuel Poinas) du serment prêté
par les magistrats, dont la formule,
modifiée par la loi du 20 novembre 2023, est désormais la suivante : « Je
jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de
me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter
le secret professionnel et celui des délibérations. » Ce serment 2.0
reprend les principes dégagés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
qui « s’apprête, à la demande du législateur, à établir une charte
déontologique », comme l’a précisé Christophe Soulard.
Si
au global, les chefs de cour et du parquet ont rendu hommage à des réformes qui
« dessinent un avenir pour la Justice en général, et la magistrature en
particulier », le procureur général a toutefois souligné que « ces
moyens ne sont pas un aboutissement mais un commencement ». « Nous
devons [les] accueillir pour ce qu’ils sont : une occasion historique de
redonner du sens et du souffle à notre institution, qui en a tant besoin »,
a-t-il martelé, un an après le dernier discours de rentrée de son prédécesseur
François Molins, qui dénonçait la « crise » traversée « depuis
trop longtemps », et un peu plus de deux ans après la « Tribune
des 3 000 » contre une justice « du chiffre » et « qui
n'écoute pas ».
En
2023, plus de transparence et des audiences interactives
Assouplissement
des conditions de la compétence universelle de la justice française en matière
de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis à l’étranger,
détermination du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés
ou encore inflexion des conditions de recevabilité de la preuve en matière
civile… Du côté de l’activité de la Cour de cassation durant l’année écoulée,
le procureur général est revenu sur plusieurs « décisions importantes »
« marquant des clarifications et des évolutions jurisprudentielles
majeures » rendues par la plus haute juridiction de l’ordre
judiciaire.
Le
livret de rentrée
disponible sur le site internet de la Cour rapporte quant à lui que la majorité
des pourvois en cassation ont été issus des cours d’appels de Paris (4 335),
Aix-en-Provence (2 017) et Versailles (1 857), principalement en
matière civile (67 %). Le nombre d’affaires enregistrées a connu une
légère baisse en matière civile (14 250) comme en matière pénale (7 250),
une tendance qui se retrouve aussi pour les dossiers jugés et les radiations
(14 470 au civil et 7 540 au pénal). En revanche, les délais accusent
une légère hausse en matière civile – 15,5 mois contre 15,3 l’année précédente –
et une stagnation au pénal (5 mois). Enfin, les principaux contentieux jugés
concernent le droit du travail (32 % de la matière civile) – à l’instar de
plusieurs arrêts du 13 septembre via lesquels la Cour a opéré un revirement de
jurisprudence s’agissant des congés payés – et le correctionnel (42,2 % de la
matière pénale).
À lire aussi : La Cour de cassation
fait évoluer sa jurisprudence sur l’usage d’une preuve obtenue de façon
déloyale devant le juge civil
Le
premier président a pour sa part souligné que la Cour de cassation s’était
employée cette année à renforcer sa « transparence » (démarche
déjà entreprise par le passage au « style direct », jugé plus clair,
en 2019, et plus récemment, par l’enrichissement de la motivation de ses
décisions) en développant sa politique de communication et en diffusant sur les
plateformes numériques « la partie publique » de ses audiences
les plus importantes. Rappelons que le 10 mars dernier, la Cour de cassation a
en effet filmé puis diffusé l’une de ses audiences pour la première fois.
Le
chef de la haute juridiction a également mentionné le projet d’expérimentation
en cours autour de l’audience interactive, suivant la recommandation issue du
rapport de la commission de réflexion « Cour de cassation 2030 »
rendu en 2021. En jeu : des audiences plus vivantes et dynamiques, pour
contribuer à de meilleures décisions. « En demandant aux parties, au
cours de l’audience, de préciser le sens de tel ou tel argument avancé par
elles, voire de répondre aux objections qu’on pourrait y opposer, le juge
assure la qualité du débat », comme l’a expliqué le premier président,
qui a ajouté : « En soumettant aux parties l’ébauche du raisonnement
qui pourrait être le sien, le juge en teste la pertinence. Il diminue ainsi le
risque que sa décision se heurte à des objections qu’il n’avait pas envisagées. »
En
2023, Christophe Soulard a par ailleurs observé une augmentation des saisines
du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire et du service
d’aide et de veille déontologique du CSM – instances déontologiques – par les
magistrats, lesquels ont des questions « de plus en plus nombreuses »,
« signe du souci salutaire d’un comportement irréprochable »,
selon les dires du premier président.
Expérimentation
de l’OLJ : vers une jurisprudence « de fait »
Lors
de cette rentrée judiciaire, un focus tout particulier a en outre été opéré sur
l’open data des décisions de justice, cette mise à disposition du public de
l'ensemble des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, numériquement
et à titre gratuit ; vaste chantier confié à la Cour, traditionnellement
chargée de diffuser la jurisprudence. « Après les arrêts de la Cour de
cassation et des cours d’appel, ce sont les décisions de neuf
tribunaux judiciaires
qui sont mises en ligne depuis quelques jours », a rappelé à ce titre Christophe Soulard. Un
processus qui va « se généraliser » dans les mois qui
viennent.
« Cette
connaissance de la jurisprudence des juges du fond ne manquera pas d’alimenter
la réflexion de la Cour de cassation. Mais encore faudra-t-il classer et
hiérarchiser ces décisions, qui seront au nombre de plusieurs millions par an,
sous peine que se confondent jurisprudence et contentieux. C’est ce
qu’entreprend actuellement la Cour de cassation, avec l’appui de correspondants
au sein de chaque cour d’appel », a indiqué le premier président.
Aujourd’hui, plus de 800 000 décisions sont aujourd’hui diffusées en
moyenne chaque année, contre 15 000 jusqu’en 2016… et « entre 3 et
5 millions demain », a précisé de son côté le procureur général.
Dans
la même veine, a débuté en novembre dernier la phase expérimentale de
l’Observatoire des litiges judiciaires (OLJ) au sein des cours d’appel de
Versailles, Rennes et Nancy. Grâce à un mécanisme de remontée d’informations,
cet OLJ entend repérer les contentieux émergents et donner à l’ensemble des
juridictions « des informations d’ordre à la fois procédural (quelles
sont les juridictions saisies du même contentieux, à quel stade de la procédure
ils se trouvent) et substantiel (élaboration d’une documentation, recensement
des solutions déjà adoptées) ». Un tel observatoire devrait ainsi
favoriser « un fonctionnement en réseau de l’ensemble des juridictions »,
a assuré Christophe Soulard. « L’OLJ donnera plus de sens au travail du
juge. Il y a là un enjeu majeur pour l’avenir de l’institution judiciaire. »
Le
chef de la haute juridiction n’a d’ailleurs pas caché que l’intelligence
artificielle jouerait, avec l’OLJ – tout comme l’open data –, un rôle
prépondérant, une « aide précieuse ». En la matière,
Christophe Soulard a toutefois tenu à couper court à tous les fantasmes : « Certains
pensent pouvoir déduire que [la Cour] abandonnera sa fonction traditionnelle et
prophétisent même sa disparition. Je crois tout l’inverse. La mise à
disposition de l’ensemble des décisions de justice engendre le risque qu’une
même valeur soit attribuée à chacune. Le principe de l’égalité devant la loi
pourrait être sérieusement mis en cause si la même interprétation des textes
n’était pas retenue d’une juridiction à l’autre. C’est bien pour conjurer ce
risque que la Cour de cassation existe. »
Selon
le premier président, l’OLJ devra également permettre qu’émerge une
jurisprudence « de fait » afin de faciliter le développement des modes
alternatifs de règlement des différends et de viser une égalité de traitement « plus
exigeante ». « Au-delà de la jurisprudence qu’on pourrait
appeler “de droit”, se fait sentir la nécessité d’une jurisprudence “de fait”, a-t-il
en effet développé, une harmonisation des décisions de justice appliquées à
des situations très proches. Par exemple des décisions fixant le montant de
dommages-intérêts ou de prestations compensatoires. Il y va, là aussi, de la
prévisibilité du droit et de la sécurité juridique. »
Des magistrats « recentrés
sur le cœur de métier »
Paraît
donc se profiler, portée notamment par la Cour de cassation, une justice de
plus en plus dans l’air du temps… Oui, mais pas suffisamment, de l’avis de Rémy
Heitz. « Nos méthodes de travail doivent être davantage évaluées »,
a-t-il insisté le 12 janvier dernier ; modernisation qui passe « en
priorité », a-t-il appelé de ses vœux, par des améliorations
numériques « indispensables » « pour qu’en matière de
justice, le numérique et la dématérialisation cessent d’être une faiblesse et
deviennent des atouts ». Et d’ajouter : « La dette technique
dont nous souffrons doit être comblée, au plus vite désormais. »
À lire aussi : Mediator : la Cour de
cassation facilite une action en justice plus tardive pour les victimes
Mais
à ces aménagements sur le fond pourrait bien faire obstacle, sur la forme, une
certaine image de la justice, jugée poussiéreuse par certains. Un avis auquel
semble se rallier le procureur général. « Peut-être est-il temps de
considérer que les costumes d’apparat que nous portons présentent aujourd’hui
un certain décalage avec les objectifs d’accessibilité et de simplicité vers
lesquels doit tendre notre justice », a-t-il souligné, avant de
proposer au premier président « d’initier cette réflexion »,
conscient que le sujet ne recueille pas un consensus parmi les
magistrats.
A
côté d’une justice qui doit poursuivre sa modernisation, Rémy Heitz a plaidé
pour des magistrats à même de « rendre la justice aujourd’hui et demain »,
et notamment des magistrats « qui doivent pouvoir se recentrer sur
[leur] cœur de métier », grâce à la consécration d’une équipe élargie
autour d’eux (notamment les attachés de justice). « Car la justice est
avant tout une œuvre collective et (...) nous ne progresserons qu’avec plus de
collectif », a appuyé le procureur général.
Au-delà,
ce dernier a également requis des magistrats « qui doivent être
représentatifs de la diversité », et a, à cet égard, rendu hommage à
l’association de tutorat en droit « La courte échelle », créée par le magistrat Youssef
Badr, qui œuvre pour l’égalité des chances.
Rémy
Heitz réclame une consolidation du statut du parquet
Parmi
les autres changements attendus, le procureur général s’est largement attardé,
sans surprise, sur le statut du parquet. « S’agissant du ministère
public dans son ensemble, dans un contexte où le rôle du procureur ne cesse de
s’étendre, il est impératif de consolider le statut du parquet par une réforme
constitutionnelle qui soumettrait la nomination de ses magistrats à l’avis
conforme du CSM et alignerait leur régime disciplinaire sur celui du siège »,
a-t-il réclamé, faisant écho aux demandes répétées – et de longue date – des
magistrats du parquet en ce sens.
Alors
que, selon Rémy Heitz, les « régimes illibéraux » se
multiplient, y compris au sein de l’Union européenne, déconstruisant leurs
systèmes judiciaires, « la justice doit, le plus possible, être
protégée et sanctuarisée (...) Il ne faudrait pas qu’un jour, nous ayons
à regretter amèrement de ne pas avoir suffisamment protégé notre démocratie »,
a argué le procureur général, défendant, devant le représentant du garde des
Sceaux et le président du Sénat Gérard Larcher, « l’impérieuse
nécessité » de cette évolution.
Un
« impératif de consolidation » qui vaut aussi pour le parquet
général de la Cour de cassation, a-t-il fait valoir ; ce, dans un contexte où
le parquet général s’apprête à être « significativement renouvelé »,
avec le départ à la retraite en 2024 de près de 10 % de son effectif, alors que
la réforme engagée par les Etats généraux de la justice n’est pas achevée.
Rémy
Heitz a ainsi réclamé une évolution du statut de l’avocat général « qui
doit pouvoir bénéficier dans les textes de l’indépendance dont il jouit dans la
pratique » et du positionnement du parquet général au sein de la Cour
et des chambres pour que les avocats généraux aient « un accès
uniformisé aux informations essentielles dont ils ont besoin pour fonder des
avis enrichis ». Quant à l’organisation interne du parquet général, il
compte bien la bâtir « dans les mois à venir ».
En
clôture, le procureur général l’a annoncé : il présentera « très
prochainement » au ministre de la Justice un projet de réforme, « fruit
du travail collectif actuellement mené au sein du parquet général ».
Bérengère Margaritelli
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *