Article précédent

SERIE (1/4). Le plasma humain fait l’objet d’un commerce très particulier : ce composé du sang est prélevé sur des volontaires, et sert, entre autres, à fabriquer des médicaments. Mais il est au cœur d’une étrangeté économique : rémunérer les personnes pour prélever leur plasma est plus rentable que de collecter du plasma auprès de bénévoles. Certains pays comme la France choisissent pour des raisons éthiques de ne faire appel qu’à des dons bénévoles… mais cette pratique lèse le nombre de collectes.
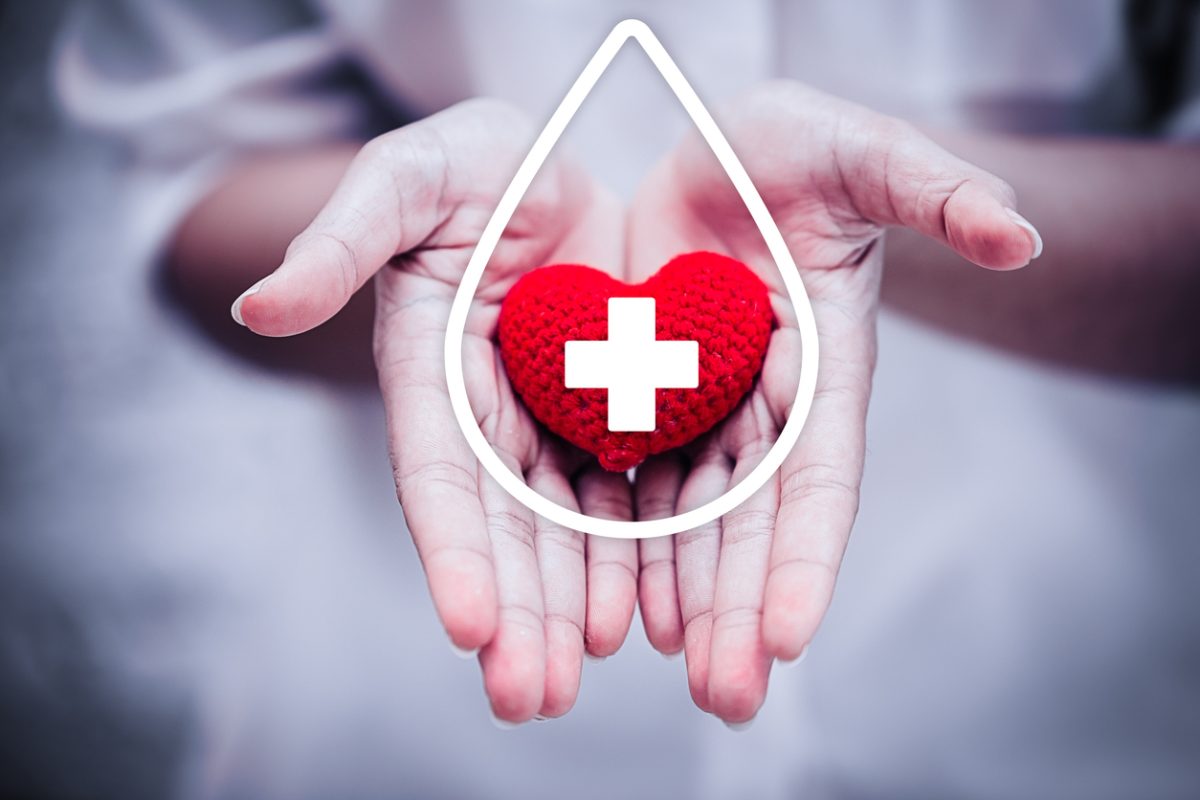
Attirer des personnes précaires dans d’immenses centres pour prélever des éléments de leur corps et en faire des médicaments vendus dans le monde entier ? Non, il ne s’agit pas d’un obscur trafic, mais d’un business parfaitement légal, qui pèse, selon certaines estimations, autour de trente milliards de dollars par an. Un commerce dominé par les Etats-Unis.
L’élément au centre des convoitises, c’est le plasma, composant du sang, composé à 90 % d’eau, mais également de protéines qui permettent de traiter certaines pathologies. Le plasma sert lors de transfusions sanguines, il entre alors dans la catégorie des produits sanguins labiles, destinés à un usage thérapeutique direct. Mais il est principalement utilisé pour produire des médicaments. On parle alors de médicaments dérivés du sang, les MDS, fabriqués par des industriels spécialisés, les fractionneurs : ils fractionnent le plasma pour en récupérer les protéines. A l’Etablissement français du sang (EFS), qui collecte sang et plasma, 94 % du plasma collecté sert pour le fractionnement, et seulement 6 % servent pour la transfusion, celle-ci diminuant légèrement au fil des ans (à la fois parce que les transfusions s’amoindrissent et parce que le volume global de collecte augmente).
Chaque année, 500 000 patients en France sont traités par des dérivés du plasma, à commencer par les immunoglobulines. Elles traitent notamment les déficits immunitaires primitifs, qui touchent 8000 personnes en France, dont la moitié est substituée par immunoglobulines, sans alternative.
La demande pour les médicaments dérivés du plasma est en hausse, même si certains se demandent si elle est entièrement justifiée : +7 % par an, selon l’économiste Jean Mercier Ythier, qui s’intéresse depuis plusieurs années au marché du plasma. S’il lui est compliqué d’avoir des chiffres mondiaux, il estime que la demande de plasma pour le fractionnement tourne autour de 69 millions de litres en 2019, et anticipe 92 millions l’an prochain.
De plus, la part de plasma de fractionnement issu de sang total (obtenu suite à un don de sang classique) décroit, alors que la part de plasmaphérèse (technique permettant de ne prélever que le plasma) augmente.
Selon Jean Mercier Ythier, le plasma issu de don de sang total représentait 30 % du plasma de fractionnement au niveau mondial dans les années 2000. Avant la pandémie, ce n’était plus que 11,5 %. Aujourd’hui, il est tombé à 5 %.
Une des causes est une moindre demande de sang total ces dernières décennies, et donc un moindre volume prélevé. L’EFS a d’ailleurs vu la cession aux hôpitaux des concentrés de globules rouges diminuer de 10 % entre 2022 et 2024. « D’où un impact sur la collecte de plasma, parce que l’établissement ne collecte le sang qu’en fonction des besoins des patients, pas pour faire du stock », explique Thibaut Bocquet, directeur du projet Ambition Plasma à l’EFS. Si, pour l’instant, le plasma prélevé vient majoritairement des dons de sang total, l’établissement veut inverser la tendance. En 2024, la plasmaphérèse représentait 37 % de la collecte de plasma. En 2025, cela devrait être 42 %. L’objectif est d’arriver à 62 % en 2028.
Paradoxalement, il est plus rentable de rémunérer les personnes pour prélever leur plasma que de se baser sur des dons. L’exemple le plus frappant vient des Etats-Unis, qui produisent les deux-tiers du plasma de fractionnement mondial. L’explication est simple : les personnes rémunérées pour leur plasma sont plus régulières, car elles y trouvent un intérêt financier. Des collectes plus régulières permettent de rentabiliser le matériel de collecte et le personnel médical. Et donc, de faire des économies d’échelle, et ainsi diminuer le prix au litre du plasma.
Cependant, cela pose des problèmes éthiques : les personnes qui viennent sont les plus précaires, qui y voient un complément de revenus. Aux Etats-Unis, le rythme des prélèvements dans les immenses centres dédiés pose des questions sur la santé des donneurs, mais également sur la qualité du plasma.
Ce modèle est donc contesté, et de nombreux pays optent pour un don entièrement gratuit de plasma. Certains arrivent à être autosuffisants, mais c’est beaucoup plus compliqué, puisque les donneurs viennent moins fréquemment. Les quantités de plasma produites sont donc moindres et la collecte plus chère. Le prix de vente est souvent inférieur au coût de revient tout en étant supérieur au prix du marché, calculé à partir du coût de revient le plus bas, celui des Etats-Unis, témoigne Jean Mercier Ythier.
Ces pays dépendent donc souvent de médicaments dérivés du plasma fabriqués dans des pays où la collecte est rémunérée. Ce qui pose aussi un problème de souveraineté : que faire si le marché là-bas s’effondre, que des barrières douanières se mettent en place… « Avec un Trump à la tête des Etats-Unis, on n’est pas à l’abri qu’à un moment donné, il ferme les frontières et qu’on se coupe de 65 % de notre plasma », s’inquiète ainsi Virginie Milière, déléguée générale de l’Iris, association de patients atteints de déficit immunitaire primitif.
Outre les incertitudes géopolitiques, le plasma reste une matière première. « Une matière première très spécifique car issue du corps humain. Mais c’est typiquement une économie de matière première, où les prix sont très sensibles aux écarts entre l’offre et la demande, et peuvent brutalement flamber s’il y a un excès de demande, mais aussi s’écrouler s’il y a un excès d’offres », explique l’économiste Jean Mercier Ythier. D’où une fragilité du secteur du plasma rémunéré, qui rend « dangereux d’avoir une industrie qui repose à ce point sur une fourniture de plasma américaine », basée sur un petit nombre de donneurs susceptibles de partir dès que leur situation économique s’améliore.
La Fédération française des donneurs de sang bénévoles (FFSB) estime d’ailleurs que sur le long terme, le plasma gratuit peut être plus rentable que le plasma rémunéré, parce que le vivier de donneurs est plus large et plus stable.
En Europe, le nouveau règlement SoHo (Substances of Human Origin), voté en 2024 et qui doit s’appliquer en 2027, renforce le principe de non-rémunération mais remplace le principe de gratuité par celui plus ambigu de neutralité financière. Jean Mercier Ythier a d’ailleurs participé à une réunion de la Direction européenne de la qualité du médicament & soins de santé (EDQM) à ce sujet et il a observé que la majeure partie des pays européens convergeaient vers une recherche de plus grande souveraineté.
Il soutient qu’un modèle basé sur le bénévolat peut être profitable. « Dès lors que le coût de collecte passe en dessous du prix de marché de la matière première, cela devient une activité rentable ». Avant la pandémie, au niveau mondial, le volume de plasmaphérèse issue de dons gratuits était tout à fait marginal. Elle commence doucement à progresser, mais reste pour l’instant limitée à quelques pourcents.
Selon lui, sa généralisation mondiale n’est pas possible. En revanche, les pays avec une collecte de sang bien organisée et refusant la rémunération « peuvent développer des politiques d’autosuffisance en plasma, à condition d’être modestes sur les objectifs. L’autosuffisance n’est pas censée être du 100 % tout le temps, mais arriver à 80 % sur certains produits particulièrement sensibles serait bien ». D’autant que les patients ont besoin de différents types de médicaments, pas tous produits au niveau national, et que s’agissant de médicaments biologiques, la tolérance peut varier selon les fournisseurs pour chaque patient.
Pour augmenter son autonomie, un pays doit améliorer l’efficacité de la collecte, et donc trouver plus de donneurs. Mais les collecteurs peuvent également bénéficier d’une tendance à la hausse du prix de vente du plasma. « À la suite de la poussée continue de la demande à la fin des années 2010, il y a eu une pression à la hausse sur le prix, explique Jean Mercier Ythier, notamment par l’augmentation du coût de collecte aux Etats-Unis », elle-même intensifiée par « l’augmentation de l’indemnité [des donneurs], passée d’environ 35 dollars à plus de 60 dollars. Les prix étaient donc passés d’environ 110 euros le litre à 160 euros ».
Se sont ensuite ajoutées « toutes les perturbations au tournant des années 2020, liées aux tensions sur le marché, la crise sanitaire, l’inflation… Tout cela fait que les prix ont fortement augmenté, et le coût de collecte aux Etats-Unis est désormais autour de 180 dollars le litre. Cela devient donc plus facile d’arriver à ces niveaux de coût de collecte sans rémunérer les donneurs ».
Le Comité consultatif national d’éthique parle, lui, dans un avis de fin 2024, d’un prix de vente de 170 euros au niveau international, et d’un coût de collecte de 200 euros aux Etats-Unis.
Avec son modèle éthique, basé sur la gratuité, la France ne répond pas aux besoins de sa population, et dépend aux deux-tiers d’exportations pour ses médicaments dérivés du plasma. Le seul organisme habilité à y prélever le sang et ses composés est l’Etablissement français du sang, un établissement public administratif. Il ne peut le vendre qu’au seul fractionneur national, le LFB, laboratoire français de biotechnologie, société anonyme à unique actionnaire, l’Etat français. Or, c’est l’Etat qui fixe le prix de cession. Il a longtemps été terriblement bas, déséquilibrant les comptes de l’établissement. Et l’Etat a été accusé à plusieurs reprises de favoriser le LFB au détriment de l’EFS.
Face à ces enjeux, l’EFS et l’Etat ont révélé en juillet 2024 le programme Ambition Plasma. Celui-ci s’engage à drastiquement augmenter la quantité de plasma prélevée pour fractionnement : autour de 827 000 litres en 2023, 1,4 million de litres par an à partir de 2028. Selon Thibaut Bocquet, « cet objectif est conséquent, mais l’ensemble de l’établissement s’organise pour l’accomplir ».
En parallèle, le prix de cession est revu à la hausse, de 110 à 140 euros au 1er janvier 2025. Il doit passer à 160 euros en 2026 si l’EFS atteint son objectif 2025 de 915 000 litres prélevés. Selon Thibaut Bocquet, c’est en bonne voie. Mais produire un litre de plasma coûte actuellement à l’EFS 224,9 euros : de là vient la nécessité de diminuer le coût de collecte pour être à l’équilibre.
Pour Jean Mercier Ythier, d’une manière générale, ce genre de modèle « ne peut fonctionner qu’à condition qu’une subvention comble l’écart entre le coût de collecte, car l’établissement de collecte doit équilibrer ses comptes, et l’industriel doit travailler au prix du marché. C’est une condition de base, la principale [selon moi] ».
Certains se demandent tout de même encore si l’EFS a les moyens d’accomplir sa mission : « C’est dommage de conforter deux entités nationales dans leur rôle sans forcément leur en donner véritablement les moyens », regrette ainsi Virginie Milière. Je pense que pour le LFB, l’État a été au-delà même de ce qu’il pouvait faire au regard des finances publiques. Pour l’EFS, l’augmentation de son budget va dans le bon sens, mais je pense que les moyens sont encore très insuffisants. L’EFS a toute mon admiration pour assurer sa mission de service de santé publique avec ses moyens et ses contraintes ».
Le directeur d’Ambition Plasma Thibaut Bocquet assure de son côté que l’EFS est « au rendez-vous de cet objectif, avec notamment de très belles réalisations et des records historiques, surtout par la collecte de plasma issu d’aphérèse. Nous avions dépassé les 9100 prélèvements hebdomadaires dans le courant du mois de mai et nous avons eu trois semaines de records historiques à partir de mi-juillet jusqu’à la première semaine d’août : 9621 prélèvements sur une semaine, et deux autres semaines à plus de 9200 chacune ».
Alors qu’en interne, certains syndicats dénoncent un manque de moyens, Thibaut Bocquet récuse l’accusation : « l’Etat nous accompagne, notamment au travers d’une revalorisation de la tarification », accompagnée qu’une dotation annuelle de l’Assurance maladie de 100 millions d’euros (soit 10 % du budget de l’EFS). Et aussi « par un pilotage de la filière globale, qui n’existait pas il y a encore deux ans, avec une vision globale des objectifs de chacun des acteurs de la filière dans le sens d’une consolidation de cette filière. Nous sommes dans un process intégré : l’Etablissement français du sang et le LFB sont liés par la loi. Nous sommes aussi monitorés dans l’atteinte de ces objectifs et de bonne utilisation de l’argent public ».
Pour atteindre ses objectifs, l’établissement se met en ordre de marche. Il faut moderniser le matériel, recruter, et surtout, faire en sorte de recevoir plus de dons. Jacques Allegra, président de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles (FFDSB), confirme « un intérêt massif pour le don de plasma. Le problème essentiel restant, mais l’EFS s’y emploie avec les moyens qui lui sont donnés, c’est l’offre de collecte et donner la possibilité à l’ensemble des citoyens de donner ».
Pour augmenter le volume collecté, il y a trois possibilités : faire venir de nouveaux donneurs de sang ; convertir les donneurs de sang total en donneurs de plasma ; et augmenter la fréquence des dons par personne. Car, pour augmenter les volumes de plasma de fractionnement, « le seul relai de croissance, c’est le plasma d’aphérèse », explique Thibaut Bocquet.
L’EFS travaille sur ces trois leviers simultanément. Sur 1,5 millions de donneurs, 160 000 donnent aussi leur plasma. L’objectif est de passer à 330 000 donneurs de plasma, et à une moyenne de 2,4 dons de plasma par donneur et par an à 3,2, pour arriver à un million de plasmaphérèse par an (chacune représentant jusqu’à 750 millilitres de plasma). « Ces trois objectifs sont à mener de front, nous ne pouvons pas nous permettre d’en mener qu’un sans mener l’autre, sinon ce sera d’autant plus complexe », assure Thibaut Bocquet.
En plus d’augmenter le nombre total de donneurs, l’EFS doit aussi remplacer ceux qui partent chaque année, pour des raisons médicales ou de changement de vie. « C’est un travail permanent pour l’établissement, assure le directeur. Recruter, fidéliser, ce sont les deux grands axes, et parfois réactiver certains ‘abandonnistes’ pour qu’ils reviennent vers nous ».
Pour cela, l’EFS travaille désormais beaucoup plus autour de la communication ciblant spécifiquement le don de plasma. « Le recrutement passe aussi par la notoriété, indique le directeur d’Ambition Plasma : faire connaître le don de plasma, ce que c’est, les protéines qui le composent, à quoi elles servent ».
Il y a aussi des considérations plus concrètes pour les donneurs : « Comment se passe le don de plasma, quels sont les impacts en tant que donneur, combien de temps cela prend ? Ce sont des outils pédagogiques de compréhension, expliquer que je peux venir tous les quinze jours, jusqu’à vingt-quatre fois par an, que je vais très bien récupérer, que l’aiguille est la même que le sang total… Nos axes de travail sont un, je connais, deux, je considère ce que ça peut faire, trois, je m’engage personnellement. L’engagement est un acte personnel, mais pour cela, il faut faciliter le parcours du donneur, il faut que tout soit simple offline et online. »
Et de rappeler que « le don de plasma est très peu connu, moins de 40 % des Français le connaissent, quand 70 % connaissent le don de sang ». L’organisme veut également « combiner la notoriété du don de plasma avec la notoriété du don de sang, parce que les donneurs de sang sont des futurs donneurs de plasma. Certains arrivent directement au don de plasma, sans passer par le don de sang, mais la majorité effectuent une transformation de donneurs de sang en donneur de plasma ».
Cette approche semble fonctionner. L’EFS a ainsi mené « une grosse campagne sur le plasma, de fin février au 15 mars, qui a fait croître de 15 % [son] activité. Les recrutements des donneurs aussi ont suivi cet accroissement. Maintenant, notre stratégie va être, pour éviter les pics et les creux, des campagnes plus au long cours, pour avoir une présence permanente dans différents supports médiatiques ».
Selon la FFDSB, la communication pourrait encore être poussée. « L’établissement fait avec les moyens qu’il a, mais on est encore loin de pays comme l’Italie. En France, c’est encore un peu timide. C’est pour cela qu’on appelle à ce que le don de plasma soit déclaré grande cause nationale », plaide Jacques Allegra.
Du côté des association de patients, Virginie Millière reconnaît que l’EFS s’est « mis en ordre de marche sur les derniers mois. » Elle reconnaît « une vraie différence dans la communication » : « J’entends beaucoup plus parler du plasma qu’il y a deux ans. Certains donneurs de sang me disent qu’on leur a parlé du plasma ». L’association Iris – comme celles de donneurs – participe d’ailleurs à la communication à un niveau plus local et plus personnel, et organise des événements avec des témoignages de patients traités par le plasma. « Être confronté à des véritables histoires ou à des personnes qui viennent témoigner de l’importance du traitement et de ce que cela change dans leur vie, cela a plus d’impact, c’est plus concret », analyse la déléguée générale.
Le don de plasma est compliqué parce qu’il ne peut être réalisé que dans des maisons du don, des établissements fixes (95 lieux peuvent accueillir le don de plasma aujourd’hui), et non dans les nombreuses collectes mobiles (salles des fêtes, entreprises, lieux publics…) de don du sang. Certains volontaires au don se retrouvent donc loin des lieux de collecte. Le plan Ambition Plasma prévoit la création de nouvelles maisons du don et la rénovation de certaines pour pouvoir accueillir le don de plasma : cinq depuis 2024, deux d’ici la fin de l’année, quatre à l’étude pour les années qui viennent. Pour Jacques Allegra, « c’est encore un peu juste, mais cela peut créer une dynamique ».
« La problématique majeure, c’est la distance », souligne-t-il. Les associations de donneurs essaient de rapprocher les donneurs des collectes de plasma, par exemple en organisant des covoiturages. L’initiative est récente et pour l’instant « ne représente pas une masse énorme, reconnaît le président de la FFDSB. Mais cela permet déjà de créer une culture du plasma ».
L’EFS doit également investir dans le matériel. De son côté, Thibaut Bocquet assure : « Nous travaillons à acquérir des équipements. Nous avons un peu plus de 500 machines à date. Nous devons doubler nos équipements ». Mais au-delà des machines d’automate, à la CFDT de l’EFS, le délégué syndical central Benoît Lemercier pointe des problèmes de matériel obsolète sur des outils aussi basiques que les chariots.
Il attribue aussi les problèmes aux mauvaises conditions de travail, plus généralement, et au turnover, qu’il lie entre autres à un manque de moyens. Par conséquent, le syndicat ne juge pas le plan Ambition Plasma réaliste, et a émis un avis défavorable en réunion du comité social et économique. « On ne peut pas augmenter les cadences sans avoir de réels moyens en termes d’investissement dans le matériel et dans les ressources humaines, dans le social de manière générale », prévient Benoît Lemercier. La fédération de donneurs l’observe aussi : le manque de personnel « est toujours un problème », provoquant « des collectes sont raccourcies ou annulées », confirme Jacques Allegra.
Le directeur de l’EFS, lui, rappelle que l’ensemble des « métiers médicaux sont en tension, cela veut dire pléthore d’offres pour ces métiers », accentuant le turnover, mais il estime que la situation n’est pas pire à l’EFS que dans le reste du secteur sanitaire. « Effectivement il y a des impacts, nous ne pouvons pas les nier, mais nous sommes accompagnés ». 350 à 400 salariés doivent être embauchés d’ici 2028, et le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’Etat et l’EFS prévoit notamment de « rénover le projet social ».
Pour accueillir plus de donneurs, l’EFS veut réorganiser les horaires de prélèvement. Les augmenter, mais aussi déplacer certains créneaux, pour s’adapter au rythme de vie : s’étendre plus tard le soir, parfois plus tôt le matin, parfois le samedi… Selon Benoît Lemercier, cela « dégrade les conditions de travail de l’ensemble de la chaîne », ce qui « diminue l’attractivité de l’établissement ».
Thibaut Bocquet reconnaît que cela « change le contrat social initial », qui accentue un peu le turnover existant. Mais il estime que les conditions restent meilleures qu’à l’hôpital : « Nous ne travaillons pas la nuit, les amplitudes d’horaires maximum des plus gros sites, c’est de 8h à 20h, nous sommes fermés le dimanche, les samedis finissent plus tôt. »
Il souligne que l’organisation varie beaucoup d’un site à l’autre et doit « répondre aux besoins des donneurs, dont le mode de vie évolue : nous devons être à leur service pour faciliter la venue au don, par exemple au-delà de 17h sur certains sites ».
Ce changement « peut passer par une augmentation des horaires, mais aussi fermer ceux où il n’y a pas grand-monde », en se basant par exemple sur les données chiffrées de fréquentation. Il assure que « les choses se font progressivement en concertation avec les équipes ».
Pour Jacques Allegra, le plan Ambition Plasma « est largement réalisable, pour autant qu’on explique à nos concitoyens l’importance du plasma et son impact stratégique majeur. Non seulement stratégique par rapport aux soins des patients, mais également par rapport à notre souveraineté sanitaire ».
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *