Article précédent

Approuvé avec un ultime vote du Sénat ce mercredi, le texte issu d’un accord en commission mixte paritaire avait été adopté le jeudi 23 octobre dernier par l’Assemblée nationale à une large majorité. Après un long processus législatif marqué par des débats dans et en dehors de l’hémicycle, la France a voté « cette avancée majeure dans la lutte contre les violences sexuelles », et rejoint à présent des pays européens comme la Suède, l’Espagne, ou encore la Norvège.
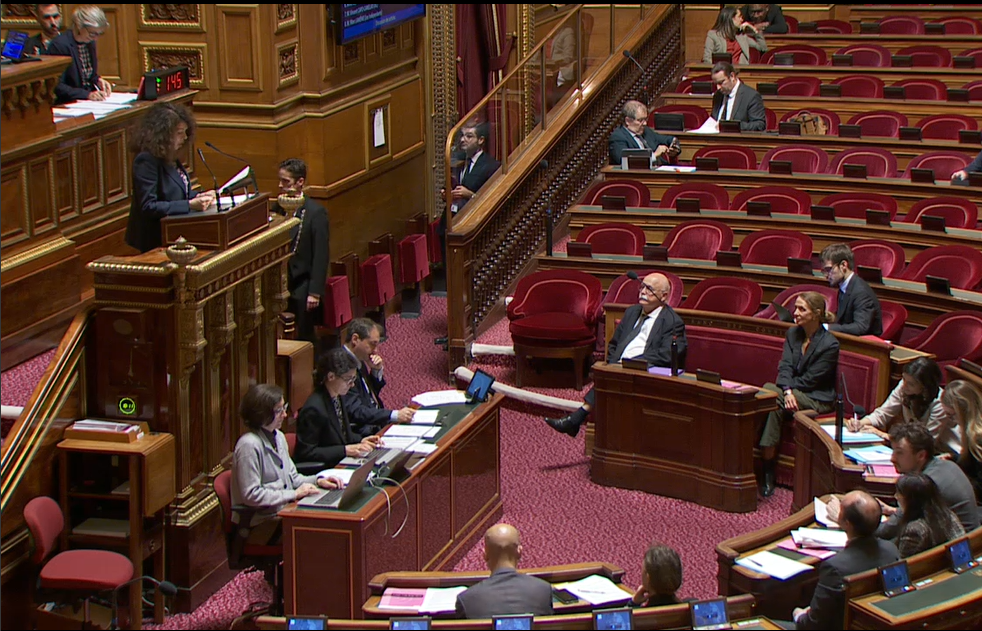
Le 8 octobre, devant la cour d’assises d’appel du Gard, Gisèle Pélicot a interpellé le seul prévenu de l’affaire de Mazan ayant maintenu son appel, Husamettin Dogan. « À quel moment je vous ai donné mon consentement ? Jamais ! » a-t-elle lancé au prévenu qui maintenait ne pas l’avoir violée. Il a finalement été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Quelques jours plus tard, le 23 octobre, l’Assemblée nationale adoptait la proposition de loi visant à inscrire la notion de consentement dans les définitions du viol et de l’agression sexuelle.
Issu d’un accord en commission mixte paritaire et porté par les députées Véronique Riotton (Ensemble pour la République) et Marie-Charlotte Garin (EE-LV), il a été adopté par l’Assemblée nationale à 155 voix pour et 31 voix contre. Face à une réponse pénale jugée insuffisante et dissuasive, Véronique Riotton a rappelé que « le viol reste le crime le plus sous-déclaré ». En 2021, seules 6 % des victimes de viol, de tentatives de viol ou d’agressions sexuelles ont porté plainte, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes. En 2020, à peine 0,6 % des viols ou tentatives de viol ont donné lieu à une condamnation, d’après l’INSEE.
Les classements sans suite le sont dans l’immense majorité des cas pour « infraction insuffisamment caractérisée ». « Nous nous appuyons sur la loi existante en la clarifiant et en la renforçant pour que la justice ait une compréhension plus fine des violences sexuelles et, in fine, opte pour une application plus juste et plus protectrice du droit », a expliqué Marie-Charlotte Garin.
En l’état du droit, le viol était jusque là défini par le Code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». La proposition de loi transpartisane prévoit d’introduire le « non-consentement » pour caractériser le viol et les agressions sexuelles. Le nouvel article 222-22 du Code est ainsi rédigé : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ». Le texte précise que le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Il ne peut par ailleurs pas « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » et est considéré comme inexistant si l’acte litigieux « est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».
À lire aussi : Le consentement dans la loi sur le viol : « Cela faciliterait le travail du juge »
Le texte précise que le consentement doit être « apprécié au regard des circonstances ». Car si la validité du consentement doit être évaluée à l’instant où l’acte est commis, elle suppose également de prendre en compte des éléments plus larges en regardant notamment « dans les interactions passées, dans d’éventuels rapports de pouvoir et dans la personnalité de l’auteur, pour évaluer si les vulnérabilités de la victime ou des stratégies de l’agresseur ont pu vicier le consentement ou empêcher la victime de résister, voire de réagir, a déroulé Marie-Charlotte Garin. Ainsi, le consentement ne pourra plus être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. »
Cette dernière a aussi évoqué « l’inégalité des victimes face à l’application de la loi », soulignant que celle-ci varie selon l’évolution de la jurisprudence et le tribunal saisi des faits. En mars dernier, le Conseil d’État avait rendu un avis favorable sur le texte, considérant que son « principal apport » consistait à « consolider par des dispositions expresses et générales, les avancées de la jurisprudence, nécessairement casuistique » renforçant ainsi la sécurité juridique.
Un des arguments avancés par les partisans de cette proposition de loi est qu’elle prendrait en compte des situations jusqu’ici non couvertes par le droit comme la sidération, l’emprise ou la vulnérabilité. Selon Sarah Legrain (LFI), la nouvelle loi permettrait de mieux traiter « les cas qui se trouvent trop souvent exclus des critères de violence, contrainte, menace ou surprise ». Dans l’idée, avec ce nouveau texte, le simple manque de consentement devrait suffire à qualifier un viol, sans qu’il soit nécessaire pour la victime de prouver la contrainte, la résistance ou la violence.
Pour la députée, qui avait porté en novembre 2024 un texte visant à introduire le consentement dans les définitions du viol et de l’agression sexuelle, finalement rejeté par la commission des lois avant d’arriver à l’Assemblée, le nouveau projet permettrait d’empêcher les auteurs de « présumer le consentement » des victimes. Il les obligerait à expliquer comment ils l’ont obtenu et inciterait magistrats et policiers à prendre en compte les « circonstances », les « rapports de force » et les « vulnérabilités » qui peuvent empêcher de dire non, et donc de consentir.
Erwan Balanant, (MoDem) a voté en faveur de la loi, mais il a exprimé ses doutes lors des débats, craignant le risque « de concentrer l’enquête judiciaire et la procédure judiciaire sur le comportement de la victime ». Pour Carole Hardouin-Le Goff, maîtresse de conférences à l’Université Paris-Panthéon-Assas, cette crainte ne tient pas, « le projecteur est DÉJÀ mis sur la victime, déshabillée une seconde fois dans la salle d’audience », expliquait-elle lors d’une conférence organisée par l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris en décembre 2024.
A l’Assemblée nationale, sur les 31 votes contre, 27 provenaient de députés du Rassemblement National et 4 du groupe de l’Union des droites pour la République. Parmi eux, Sophie Ricourt Vaginay a dénoncé une « insécurité juridique généralisée », estimant que l’introduction du consentement dans la loi ferait peser sur l’auteur des faits une charge de preuve impossible à assumer, reprochant aux corapporteures de « légiférer avec émotion ».
« Combien de verres de vin suffisent à rendre un consentement « non éclairé » ? Faudra-t-il désormais enregistrer les préalables à chaque acte sexuel et l’acte sexuel lui-même pour constituer préventivement une preuve ? » a quant à elle interrogé la députée Sophie Blanc (Rassemblement National), évoquant un basculement dans « la culture du soupçon ». Certaines voix extérieures au débat parlementaire comme l’avocate pénaliste Fanny Colin soutiennent que le faible taux de réponse pénale face aux viols ne s’explique pas par une définition actuelle inadaptée mais par un manque de preuves.
Des réserves se font également entendre en dehors de l’hémicycle. Pour Céline Piques, porte-parole d’Osez le féminisme, membre de la commission violence du Haut Conseil à l’Egalité et pour Elise Arfi, avocate pénaliste, ancienne membre du Conseil de l’ordre du barreau de Paris, l’inscription dans la loi de la notion de consentement est un « pétard mouillé », destiné à masquer le problème principal de la justice pénale : le manque de moyens notamment ceux investis dans les enquêtes. Pour elles, la définition actuelle du viol permet déjà de traiter l’ensemble des cas de viols et d’agressions sexuelles grâce à une jurisprudence abondante.
Selon Céline Piques, les « oui contraints » sont fréquents, notamment dans les cas de viols conjugaux, et l’inscription du consentement dans la loi pourrait dissuader le juge de creuser la piste de « l’environnement coercitif » à l’origine de ce consentement vicié. Selon elle, la nouvelle loi risquerait de multiplier les situations où coexistent consentement vicié et contrainte, obligeant la victime à détailler comment son consentement a été influencé par les circonstances.
La proposition de loi marque l’aboutissement de plusieurs années de débats sur le sujet. En 2019 déjà, le Groupe d’experts chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention d’Instanbul du Conseil de l’Europe avait demandé à la France de « revoir la définition pénale des agressions sexuelles et du viol pour s’assurer qu’elle repose sur l’absence d’un consentement libre ». En novembre 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies avait à son tour invité à la France à modifier son Code pénal pour fonder la définition du viol sur « l’absence de consentement ».
En février 2024, les débats autour de la directive européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes n’avait pas permis d’aboutir à une définition européenne du viol basée sur le consentement, notamment en raison des réticences françaises. En mars de la même année, Emmanuel Macron s’était dit favorable à l’inscription de la notion dans le code pénal, suivi quelques mois plus tard par Didier Migaud, alors garde des Sceaux. Le Sénat a adopté le texte ce mercredi 29 octobre. En commission mixte paritaire, aucune voix contre le texte n’avait été exprimée par la Chambre haute.
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *