Article précédent

Le concept de jury populaire, qui apporte un gage démocratique à la justice française, est régulièrement attaqué pour son manque de légitimité. En 2023, il a ainsi été retiré des nouvelles cours criminelles départementales. Face aux tendances managériales dans les tribunaux et aux attaques contre la justice, certains continuent de défendre cet héritage de la révolution. Au nom d’une justice représentative et émancipatrice.
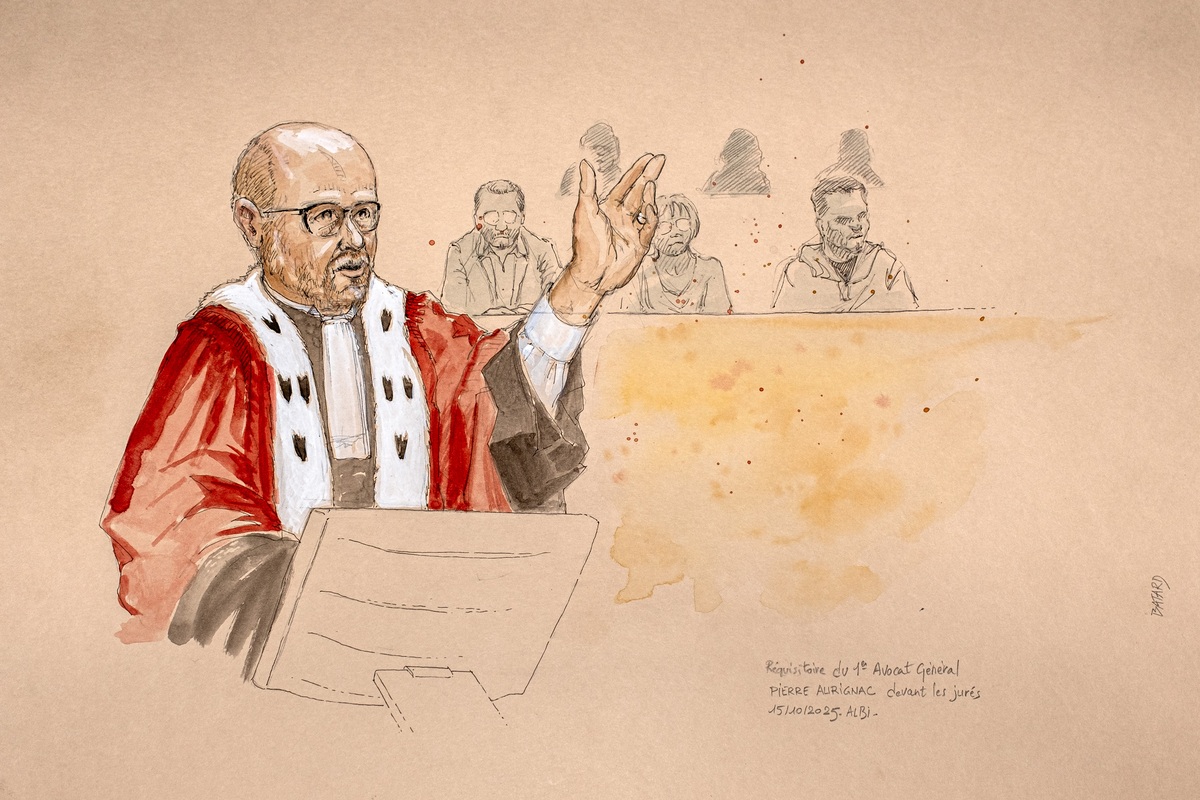
Le 15 mai dernier, le garde des sceaux Gérald Darmanin annonçait dans une lettre adressée aux magistrats sa volonté d’instaurer une procédure de plaider-coupable pour les crimes. Jusqu’à présent, cette procédure était réservée aux « petits délits », passibles de moins cinq ans de prison.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans la proposition du ministre, nécessiterait l’accord de la victime pour déclencher la procédure, suite à quoi serait organisée une « réunion de conciliation » pour évaluer la manière dont l’accusé « exprime sa culpabilité ». « Une sorte de négociation autour de la peine » serait également envisagée, en prenant en compte l’avis de la victime. Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé, un procès classique s’engagerait alors.
La proposition récente a été formulée afin de « simplifier la justice civile ». En ouvrant la voie à un jugement sans procès, un système déjà mis en place aux Etats-Unis où 90% des affaires criminelles s’en passent, cette annonce entend logiquement se priver de cour d’assises, et donc, de jury populaire. Ce dernier avait déjà été supprimé depuis la généralisation des cours criminelles départementales (CCD) en 2023, remettant en cause sa pérennité au cœur de la vie judiciaire française, alors que des voix continuent de se faire entendre pour le défendre.
Les premiers jurys naissent en septembre et octobre 1791 et ne s’attachent, dès leurs débuts, qu’aux grandes affaires criminelles. L’objectif de cette nouvelle loi est avant tout de révoquer toute trace de l’Ancien Régime et de restreindre les juges, dont le pouvoir effraie. Le principe est simple : des citoyens, directs représentants du peuple français, sont désormais associés aux juges déjà en place pour assister aux procès et décider de la culpabilité ou non d’un prévenu, puis de la sanction à appliquer en cas de condamnation. Cette « tradition », si elle a connu de nombreuses évolutions au cours des deux derniers siècles (il a fallu attendre 1945 pour que les femmes soient autorisées à siéger en tant que juré) a fait depuis l’objet de nombreux débats politiques, interrogeant par exemple la légitimité de ces juges non-professionnels à concourir à une décision de justice.
Pour ses plus fervents défenseurs, comme Benjamin Fiorini, maître de conférences à l’Université Paris 8, la fonction du juré participe pourtant à un phénomène d’émancipation citoyenne : « de nombreux témoignages de jurés racontent la transformation qu’ils ont vécue. Ils se rendent compte que la citoyenneté ne s’exerce pas exclusivement à travers le droit de vote et qu’elle recouvre bien d’autres aspects. Notamment par cette possibilité concrète de contribuer au jugement des crimes les plus graves ».
Le juriste mentionne également l’impact de cette expérience sur leur vision de la justice. « Leur appréciation évolue, s’affine et devient plus réelle. Ils reconnaissent qu’avant d’occuper la fonction de juré, ils pouvaient avoir des positions très lapidaires sur les affaires médiatiques, en regrettant parfois que la peine maximale ne soit pas prononcée. Devoir juger l’un de ses pairs, un membre de la société à laquelle il appartient, permet de saisir la complexité de l’exercice. D’un certain point de vue, le jury populaire est un moyen de lutter contre le populisme judiciaire ».
Et contribue à forger l’esprit critique des participants, ajoute-t-il encore. « Les jurés sortent d’un procès en étant beaucoup plus méfiants des récits médiatiques qui sont faits des affaires judiciaires. Pourquoi ? Parce qu’ils réalisent que les coupures presse ou les émissions sont en fait très éloignées de l’audience qu’ils ont vécue. Ils s’aperçoivent du prisme déformant. L’esprit critique s’exerce et disons que cela évite d’écouter… le professeur Hanouna » (ndlr : en référence à Cyril Hanouna, animateur télé populiste).
Pour Benjamin Fiorini, le maintien des jurés rend aussi la justice meilleure. Il s’explique : « Cela ne signifie pas du tout que les magistrats seuls ne sont pas capables de juger des affaires criminelles. C’est surtout que le jury populaire structure l’audience de manière différente, notamment au niveau de sa temporalité. Les magistrats doivent faire preuve de pédagogie à leur égard : tout est disséqué, le dossier est verbalisé. Ce qui évite in fine une justice expéditive. L’audience a la faculté de reconstruire le lien social, elle est dotée de toute son envergure humaine. Parfois, un accusé va faire des aveux ou présenter des excuses. Des victimes se confieront sur ce qu’elles ont subi. Tout cela n’advient qu’avec du temps ».
Le maître de conférences ajoute à cela l’argument de la représentation collective que les jurés apportent : « Des gens de couches sociales différentes, aux origines socio-économiques mixtes, permettent de représenter le peuple français. Je trouve que la magistrature française actuelle ne répond pas exactement à cette définition ».
Hugues Bouthinon-Dumas partage cet avis. Le professeur de droit à l’ESSEC Business School a présidé un groupe de travail chargé d’évaluer l’expérimentation des CCD. Il a depuis déposé un projet de recherche auprès de l’Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ) qui porte sur l’ajustement des dispositifs concernant les juridictions criminelles. « Si l’on analyse le jugement criminel à travers les concepts de la psychologie sociale, on sait que l’hétérogénéité du groupe amené à prendre la décision rentre en compte ».
Il mentionne également le critère du genre. « Aujourd’hui, la plupart des formations de justice sont majoritairement féminines, c’est une réalité statistique. Le fait de tirer des citoyens sur les listes électorales entraine environ 50% de chances d’avoir des hommes. Ce petit biais peut donc être contrecarré par le tirage au sort ». Il pondère néanmoins ses propos en précisant que les chefs de juridiction, chefs de cour et présidents de tribunaux demeurent néanmoins des hommes, pour une grande majorité d’entre eux.
Dans la même veine, Benjamin Fiorini rappelle la composition des promotions de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). « La promotion 2023 comptait 231 auditeurs. Parmi eux, 220 parents exerçaient des professions de cadres supérieurs. Pour 11 ouvriers et 1 agriculture. Cela révèle l’homogénéité sociale de la magistrature qu’on ne retrouvera pas dans un jury populaire. Croiser le regard de personnes qui viennent de parcours différents permet d’éviter de tomber dans une justice de classe ».
Hugues Bouthinon mentionne également le biais possible de l’âge des magistrats siégeant dans une CCD. « La moyenne d’âge est plutôt élevée, environ 55 ans : on ne devient pas président de cour d’assises à 30 ans, c’est parfois le couronnement d’une carrière. Pour un procès, deux autres assesseurs peuvent être recrutés parmi les magistrats à titre honoraire, voire des avocats honoraires, au sein desquels on note une surreprésentation de personnes âgées. Ceux là peuvent avoir 75 ans. Logiquement, au moins 3 personnes sur 5 dans une CCD sont donc des séniors ».
L’exemple du jugement d’un viol illustre selon lui tout l’intérêt de la pluralité du jury : « Ce type d’affaire est soumis à une part d’interprétation de la relation intersubjective. De ce point de vue, la diversité des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, favorise un certain recul et une réflexion propre à leur génération ».
En dépit des apports du juré populaire dans le jugement d’un procès, plusieurs critiques ont été émises à leur sujet. Dans leurs travaux, le sociologue Aziz Jellab et la chercheuse Armelle Giglio-Jaquemot constatent que l’« indépendance » des jurés à l’égard de l’opinion des politiques n’empêche pas des doutes « confortés par certaines pratiques judiciaires telles que la récusation et les stratégies engagées par les magistrats en vue de peser sur le vote du jury ».
Boris Barraud, docteur en droit et chercheur en philosophie juridique et politique, attaque pour sa part l’incompétence des jurés. Selon lui, la légitimité de la justice passe uniquement par la compétence du magistrat, et non pas parce celle d’un citoyen « devenu juge suite à un parfait concours de circonstances ». Une vision que partage le professeur en droit Hugues Bouthinon : « Les magistrats sont légalistes, généralement très sensibles aux arguments d’intérêt général et d’ordre public, beaucoup plus que la population lambda. Or, c’est plutôt une bonne chose d’avoir des magistrats légalistes, parce qu’on leur demande d’appliquer la loi ».
Il rappelle en outre que la diversité des jurys populaires peut être mise à mal par la sociologie des départements. « Les Hauts-de-Seine accueillent beaucoup de cadres. En revanche, sans tomber dans les clichés, un département du Nord sera sans doute plus diversifié ». Il prend également l’exemple des territoires ruraux de la diagonale du vide. « Si vous allez dans la Creuse, le nombre de CSP+ sera très faible. La population est vieillissante et il y a plus de chance de tomber sur des personnes issues de la ruralité, du monde agricole ou de l’artisanat. Ces critères influencent la décision rendue ».
Dans les faits, le jury populaire perd sa légitimité démocratique d’antan. De nombreux contentieux sont sortis de son orbite, à l’image des affaires de terrorisme ou de crime organisé. Et l’avènement des CCD semble définitivement signer leur recul. Généralisées en 2023, ces nouvelles juridictions, sans jurés, sont nées avec la promesse de désengorger la justice criminelle et d’endiguer le phénomène de correctionnalisation des viols.
La réforme a provoqué de nombreuses réactions, dont celle de Benjamin Fiorini, pour qui la mise en place des CCD constitue « le paroxysme de la justice managériale. Elle a été proposée, non pas pour améliorer la qualité de la justice, mais pour des raisons de coût et de temps. La question de leur apport en qualité n’a jamais été évoquée. Le tout, au mépris de la participation des citoyens. Les dernières études montrent par ailleurs que cette volonté de dé-correctionnalisation est un échec ». Les CCD jugeant principalement des affaires de viol, la question de la non-intervention des jurés interroge également sur la symbolique d’un crime « de seconde classe », qui ne mériterait plus la mobilisation de l’ensemble de la société.
Hugues Bouthinon insiste à son tour sur le fait que la généralisation des CCD n’a pas pris en compte le point de vue des jurés. « Dans le cadre de concertations ou de débats préalables, on pose la question aux personnes qui sont susceptibles d’apporter une réponse. Ici, on a demandé leur avis aux avocats spécialisés dans les affaires criminelles ou aux magistrats. Mais aux jurés, jamais. Aucun annuaire des jurés n’existe, évidemment. Mais pourquoi ne pas envisager de questionner celles et ceux qui l’ont été ? En transférant plus de la moitié des dossiers criminels à des juridictions sans jurés, on prive plus de la moitié des citoyens de la chance de voir ses compétences et sa vision de la justice transformée par cette expérience ».
Partant du même constat, le barreau de Bordeaux s’est récemment engagé dans le débat en demandant la suppression des CCD, qui, « contrairement aux objectifs annoncés, n’ont ni réduit les délais de jugement ni empêché la correctionnalisation des crimes ». L’organisation a adopté une motion soulignant entre autres la réduction de la justice démocratique, « affaiblissant le lien entre les citoyens et la justice » et demandant le retour des cours d’assises pour juger l’ensemble des crimes aujourd’hui traités par les CCD.
Lionel Da Costa Roma qui a participé à leur mise en oeuvre dans le ressort de la Cour d’appel d’Orléans juge pour sa part la réforme utile : « J’ai observé le nombre d’affaires criminelles augmenter de manière très régulière et j’ai compris la nécessité d’accroitre la capacité de jugement. Je ne suis pas fondamentalement contre la présence symbolique du juré citoyen. Par principe, je trouve cela très bien que des citoyens participent au jugement des infractions les plus graves. Dans un monde idéal, tous les crimes passeraient en cours d’assises ».
Aujourd’hui, le magistrat associe la perte de pouvoir progressive des jurés à l’évolution des valeurs républicaines dans la société. « Il y a quelques dizaines d’années, être tiré au sort pour participer à une audience d’assises était perçu comme un extraordinaire privilège. C’est désormais perçu comme une corvée. Au delà de la question de la régulation des flux et du gain de temps dans le jugement des affaires, cette remise en cause de la cour d’assises et de la participation des jurés traduit simplement l’évolution de la citoyenneté telle qu’elle est perçue par les gens », estime-t-il.
En tant que praticien, Lionel Da Costa Roma trouve aussi aux CCD des avantages pratiques : « aux assises, les jurés prennent conscience minute par minute de ce que représente la charge qui vient de leur tomber sur la tête. En CCD, c’est plus détendu parce qu’on est entre professionnels du droit ». Et il ajoute un argument en rapport avec la technicité des débats : « Je me souviens d’une affaire de viol commis par surprise, l’un des 4 modes opératoires prévus par le code pénal. Le délibéré a été relativement rapide parce que cette notion de surprise était acquise par mes collègues. J’ai pensé que si l’affaire avait été jugée en assises, j’aurais passé un sacré bout de temps à expliquer ses rouages aux jurés ».
Cependant, entre un dossier non-spécifique jugé en CCD et un même dossier jugé aux assises, « il y a une différence de quelques heures seulement. Le premier mobilisera un jour et demi, le second deux jours pleins », reconnait-il. Si cette demi-journée ainsi économisée ne permet pas toujours d’aborder le dossier suivant, elle permet en revanche un temps de repos pour le président. « Aux assises, chaque journée d’audience est une journée pleine. On peut terminer à 22h et recommencer le lendemain à 9h. Cette demi-journée est donc un temps de confort pour la greffe et les magistrats ».
Ailleurs en Europe, la place du jury populaire ne fait l’objet d’aucune unanimité. La Belgique par exemple a drastiquement réduit son usage, quand la Suisse l’a purement et simplement abandonné. Le pays a en effet promulgué une loi limitant le principe d’oralité : les discussions n’ont plus lieu d’être pendant l’audience.
Tandis qu’au Royaume-Uni les jurés décident seuls de la culpabilité de l’accusé, avant que le magistrat qui préside l’audience ne décide, seul, de la peine. En Allemagne, trois juges professionnels sont assistés de deux citoyens-assesseurs pour les crimes les plus graves.
L’Italie a, pour sa part, inscrit la participation du peuple à la justice dans sa constitution. Cette notion – toujours régie par la loi de 1951 – « manque de précision sur la forme qu’elle doit prendre », note Kévin Mariat, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université Lyon III, qui a étudié le système italien. Cette loi constituante organise néanmoins les modalités d’accès à la fonction de juré, la procédure de recrutement et la procédure de jugement devant la cour d’assises et la cour d’assises d’appel.
De ce modèle, l’universitaire retient avant tout l’importance politique du concept de juré, « au sens noble du terme », sans forcément trancher sur un modèle précis. « La suppression du jury en Italie ne semble être voulue ni par les juges professionnels, ni par les procureurs, ni par les jurys. C’est un principe politique fondamental. Parce que sa valeur symbolique et citoyenne prévaut sur l’utilité et la valeur technique », détaille-t-il.
A noter que les compétences des cours d’assises italiennes, qui accueillent les jurés, sont réduites : ce n’est pas forcément la seule qualification de crime qui ouvre droit à la cour d’assises Certains d’entre eux en sont exclus.
Concernant la réforme des CCD, Kévin Mariat alerte par ailleurs sur une potentielle perte de cohérence du système judiciaire français : « On généralise mais sans considération sur le modèle d’ensemble. Il serait plus juste de penser une vision globale, en prenant en compte la valeur du jury d’assises de l’intérieur ». Un constat que partage Hughes Bouthinon : « Cette réforme donne l’impression d’avoir déshabillé les cours d’assises pour habiller les CCD. Désengorger la justice criminelle grâce à elles, pourquoi pas, mais encore faut-il qu’elles aient les moyens de le faire. Sinon, on se retrouve avec les mêmes difficultés ».
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *